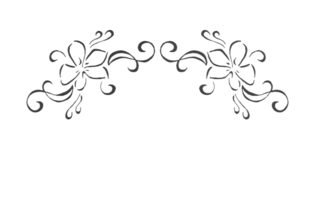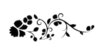Auteur : histoiresyaoi
Date de création : 31-05-2013
Âprefond, chapitre 1
C'est une fiction "historique", donc, même si j'aurais aimé pouvoir choisir "réaliste" ou même "crédible". Je ne suis pas docteur en histoire, autant vous prévenir tout de suite. Il n'est donc pas impossible que qu'il y ait quelques incohérences, et je m'en excuse platement. Mais j'essaie de coller au plus juste à la réalité de l'époque et j'espère que ça sera convaincant.
Le deuxième point de cette introduction comportera aussi des excuses, décidément. Je trouve génial les fictions qui proposent de la musique en début de chapitre. Et j'ai pensé que ça pourrait être sympa de vous faire découvrir de belles musiques tsiganes par le biais de cette fiction. Mais autant vous prévenir tout de suite : je n'ai absolument pas l'oreille musicale. Et c'est vraiment pas évident de trouver une musique qui collera aux différents passages des chapitres. Donc j'espère ne pas tomber totalement à côté de la plaque. Si c'est le cas, s'il vous plait, dites-le moi, histoire que je ne sois pas trop ridicule.
Suggestion de musique : Bratsch - Avenasto Trapezimou
Bonne lecture à tous et à toutes !
Les bières sont posées sans douceur sur la longue table de bois brut, constellée de rayures et de ronds blancs. Le liquide ambré, dégoulinant des chopes en ferraille, vient encore en assombrir le plateau. Je feins de m'y intéresser, le temps que l'aubergiste s'en aille sans avoir prononcé un seul mot.
Dès que nous avons franchi les portes de sa gargote, cet homme rubicond, à la panse plus que généreuse, nous a dardé de son regard mauvais. Et même en présentant la somme due, bien avant de voir la couleur de la bière, il a rechigné à nous servir. Mais nous sommes allés nous asseoir, sans un mot plus haut que l'autre. Question d'habitude. C'est à contrecœur qu'il nous a servi, je le sais, et c'est avec impatience qu'il attend de nous voir quitter son auberge.
Le printemps cèdera bientôt sa place à l'été et nul feu ne brûle dans la cheminée. Son crépitement aurait alors été le seul son audible dans cette grande salle en terre battue, hérissée de tables et de bancs bancals. Les autres clients nous observent, nous jaugent, dans le silence le plus complet. Même l'aubergiste nettoie les chopes avec un chiffon d'un brun douteux sans le moindre bruit. Les conversations ne reprennent pas. Les regards restent figés sur nous. On boit en silence la plus mauvaise bière qu'il a daigné nous offrir, tiédasse. Question d'habitude ou non, nous sommes pressés de repartir.
Nous aurions pu nous en passer facilement. Nous ne sommes pas exigeants, en termes de besoins. Mais la rencontre avec le conseiller du Seigneur du fief, et la longue route que nous avons fait plus tôt, rendaient une bière tentante. Et nous allons rester plusieurs jours. Quel est le meilleur endroit pour juger d'un village que l'antre où les hommes viennent se ressourcer après une journée de dur labeur ?
Les premiers chuchotements se font entendre, comme si leur examen était terminé. Ou comme si, bon gré mal gré, ils acceptaient cette présence, faute de raison suffisante pour nous mettre dehors. A ce signal tacite, les autres tablées se mettent à leur tour à chuchoter, et c'est un étrange bruissement qui se fait entendre entre les murs aux pierres grossièrement taillées. Je me détends quelque peu. Notre présence n'est jamais acceptée immédiatement, il leur faut toujours du temps. Et elle n'est jamais acceptée totalement, mais pour ça, le temps n'arrange rien.
Ce village et ce fief ne sont jamais qu'une étape dans notre voyage sans fin. Un amas de masures et une poignée de visages burinés par le soleil, aux yeux méfiants et curieux. L'arrêt à l'auberge, ou ce qui s'en approche, est un moyen comme un autre pour juger si notre présence sera tolérée ou non. Car si certains viennent se repaître de nos histoires, le soir, au coin du feu, non loin de notre campement, ce sont souvent les mêmes à recompter le nombre de leurs poules après notre départ. Sans même parler de ceux qui nous rejettent en bloc. Mais certains se laissent tenter par ce que nous leur proposons : contes, chants, tours de force ou d'habilité. Nous égayons leur quotidien le temps d'une semaine ou deux, puis nous reprenons notre route. Et malgré les soirées partagées, ils sont soulagés de nous voir partir. Nous avons appris à nous méfier de ceux qui acceptent trop bien notre présence. Souvent des femmes. Qui, sans subtilité, veulent s'acoquiner avec les hommes les plus musclés, frisson d'interdit. Et qui vont, ensuite, pleurer dans les chemises de leurs maris, hurlant au viol.
Les Seigneurs aussi aiment notre présence. Nos récits devenus d'ailleurs, nos chansons exotiques. Juste le temps de se distraire, de casser la routine confortable dans laquelle ils baignent. Ensuite, eh bien, eux aussi estiment que notre présence a suffisamment duré. Et ils nous font clairement comprendre que nous serions mieux ailleurs. N'importe où mais ailleurs.
Mon regard parcourt les hommes, assis autour des tables, qui discutent comme si nous n'étions pas là, laissant même parfois échapper un rude éclat de rire. A quoi bon continuer ? A quoi bon parcourir chaque maudite route de ce maudit royaume, pour croiser, toujours, cette même méfiance, cette même haine ?
Une ombre furtive accroche mon regard. Derrière le comptoir émerge une tignasse hirsute et deux grands yeux curieux. Le sourire revient sur mes lèvres. C'est pour ça. Parce que les yeux émerveillés des gamins, leurs éclats de rires et leurs mines effrayées sont la plus belle récompense au monde. Parce qu'embarquer un enfant dans un conte, le faire frémir et sourire, c'est bien plus important que toutes les menaces des adultes. Et parce que certains adultes, eux aussi, ont gardé une âme d'enfant et une même propension à s'émerveiller. Mon cistre à la main, apportant nouvelles du royaume et récits fantastiques, ma vie est ainsi faite. Je ne la conçois qu'ainsi. Je l'aime ainsi.
C'est un brouhaha sonore qui règne désormais dans l'auberge, tandis que nos chopes se vident peu à peu. Personne n'est venu nous parler, mais ils ne le font guère devant leurs amis. Ils attendent le soir, pour se faufiler entre les maisons et s'approcher discrètement de notre campement. Là, enfin, ils osent avouer leur curiosité. Jamais devant les autres. Devant les autres, comme en ce moment, ils rient, de nous peut-être, se vantent et se montrent durs. Mais soudain, la porte qui grince fait taire le bourdonnement.
Le gamin a disparu. L'aubergiste a lâché son chiffon sale et se tient droit derrière le comptoir. Il ne souhaite pas la bienvenue avec un sourire ou un visage avenant, pas plus qu'il ne darde un regard mauvais. Il reste figé, les mains tremblant légèrement et ses prunelles fixant intensément son chiffon. Les autres clients gardent le silence, et soudain, c'est comme une chape de plomb qui s'abat sur la pièce, la rendant suffocante.
Le nouveau venu fait deux pas sur le sol en terre battue avant de s'immobiliser. Tandis que son regard parcourt lentement la salle, je l'observe. Ce n'est pas un villageois. Tout de noir vêtu, il ne cache pas les deux longues dagues qui pendent à sa ceinture. Des cheveux mi-longs, bruns, encadrent un visage fermé, sans expression, n'invitant certainement pas à la sympathie. Un glapissement effrayé s'échappe d'un gros bonhomme, assis à une table, sur qui le regard de l'homme s'est arrêté. Le nouveau venu s'approche de lui d'un pas souple, presque félin, plein d'assurance. Les visages se font blêmes, dans la tablée, mais personne ne se lève, personne ne bouge, personne ne souffle un mot. Comme des proies cernées par le chasseur, ils restent immobiles, pétrifiés. Sans hésitation, le nouveau venu vient se placer tout près du gros bonhomme, se penche vers lui, main sur la garde de sa dague et lui souffle quelques mots à l'oreille.
Tous les regards sont rivés sur eux, et je devine dans beaucoup du soulagement. Soulagement de ne pas être la proie de ce prédateur qu'ils redoutent tous. Les bajoues du gros bonhomme tremblent lorsqu'il acquiesce au chuchotement, et sa main tâtonne nerveusement avant d'extraire de sa bourse une poignée de piécettes qu'il fait choir sur la table. A grands gestes maladroits, il réunit une somme qu'il remet à l'homme en noir. Lorsque ce dernier se détourne, après avoir empoché l'argent et soufflé quelques mots supplémentaires à l'homme frémissant, il nous examine un instant. Juste le temps pour nous d'apercevoir, sur toute sa joue gauche, un énorme H de chair boursouflée qui part de la mâchoire et s'arrête juste sous l'œil. Son visage et ses yeux sont indéchiffrables. En quelques souples enjambées, il quitte l'auberge sans un regard derrière lui.
Nous sentons distinctement la tension retomber, dans la grande salle. Le gros bonhomme reste prostré sur son banc et ses compagnons n'osent souffler mot. Le silence perdure, lourd. Voel se lève, d'un geste lent, et comme un seul homme, nous l'imitons. Les villageois que nous rencontrons considèrent régulièrement Voel comme notre chef, et nous ne leur donnons pas tort. C'est qu'il est grand, Voel, et fort en plus. Il n'est guère âgé, ses cheveux mi-longs n'ont pas commencé à grisonner, mais sur son visage tanné par le soleil se lisent maturité et responsabilité. Mais il est tellement plus que ça, pour nous, à la fois père, mentor, confident. Il est le pilier qui nous donne la force d'avancer et la foi en ce que nous faisons.
Il se contente d'un geste de la main pour prendre congé. Si nous avons l'habitude d'être mal reçus, nous ne poussons pas le vice jusqu'à les remercier de leur accueil. Nous étions quatre dans l'auberge, les autres étant restés au campement avec les femmes et les enfants. Nous marchons de front, prenant toute la largeur de la rue. Les habitants interrompent leurs activités pour nous dévisager. Nous ne passons pas inaperçus et ils ne peuvent manquer de savoir qui nous sommes. Nos tenues, parfois aux couleurs éclatantes, nos bijoux de bronze et nos cheveux agrémentés de perles crient notre appartenance au cercle des saltimbanques. Voel, Gabor et Ysayo discutent de l'installation et de nos besoins dans ce village. Jamais ils ne parlent de leurs premières impressions dans la rue, trop d'oreilles traînent. Je les écoute distraitement, sur mes gardes. L'homme en noir est parti depuis peu, et il doit être tout proche. Malgré nos bijoux en bronze, nous ne sommes pas riches, mais il ne peut pas le savoir. S'il a osé s'en prendre, devant tous les clients de l'auberge, au gros bonhomme, il n'hésitera sans doute pas à s'attaquer à nous. Voire à attaquer le camp.
Nulle trace de l'homme en noir, sur notre route, mais c'est avec soulagement que je retrouve notre campement. Les éclats de rire des enfants qui jouent, courant entre nos maisons ambulantes, les femmes qui s'affairent, en pleine discussion, les hommes qui installent rondins et grosses pierres autour du futur feu de la veillée, c'est mon quotidien et il est rassurant. Voel a décidé d'installer le campement sur la berge de la rivière, assez éloigné du point d'accès principal, pour que les villageois n'aient pas à se plaindre de nous voir tous les matins. Assez proche, pourtant, pour ne pas empiéter sur les champs, et pour éviter tout problème.
Nos maisons ambulantes sont en réalité des charrettes aménagées par Ysayo, notre menuisier attitré. A partir de simples plateformes en bois, sur quatre roues, il a bâti des cloisons, un toit étanche. Puis l'intérieur a été aménagé. Des lits, des coffres pour nos quelques possessions, des tissus pour se préserver du froid hivernal. Ce ne sont pas des palais, mais je m'y sens chez moi, en sécurité. Les bœufs ont été libérés de leurs attelages et placés dans un parc sommaire, fait de cordes et de pieux. Les poules picorent l'herbe dans leur cage, tandis que les chiens sont laissés en liberté. Le cuir tanné qui sert de porte laissé ouvert, je vais prendre mon ballot de linge sale, du savon et une brosse. Puis, après avoir fait signe à Voel que j'allais à la rivière, je m'éloigne du campement.
La lessive est un travail de femme. Si j'étais marié, je n'aurais pas à m'en occuper. Filippia s'en charge parfois pour moi mais je perds une excuse pour m'isoler un moment. A genoux au bord de la rivière, je regarde les vêtements s'imbiber d'eau. Puis mes pensées vagabondent. Nous devons faire vite. Djidjo a négocié avec les paysans pour avoir blé, choux, raves et viande séchée. Il faudra du temps pour qu'ils réunissent tout ce dont nous avons besoin. Et puis, surtout, les essieux et les moyeux sont chez le forgeron du village, les réparations payées d'avance, comme toujours. Nous n'avons pas eu besoin de lui demander de s'en charger rapidement : il sait très bien que tant qu'il a ces pièces, nous ne pourrons pas repartir. Et à son regard, j'ai compris qu'il avait envie que nous repartions au plus vite. Deux roulottes sont immobilisées. Nous détestons cette contrainte, ce sentiment d'être coincés, comme pris au piège. Notre vie, c'est également d'être prêts à partir dans l'heure. Question de sécurité.
C'est que le regard désapprobateur du conseiller qui nous a reçu, un peu plus tôt dans la journée, nous a enlevé toute illusion. Notre présence est tolérée en attendant le retour du Seigneur du fief qui prendra la décision finale. Quelques jours, tout au plus. Le château, tout en angles et pierres grises, sans la moindre fioriture ni décoration, est bien plus accueillant que cet homme. Je me demande pourquoi il nous a autorisé à rester. Je suis convaincu que, si ça ne tenait qu'à lui, nous serions déjà loin. Et pourtant, à en croire ce château, le Seigneur des lieux n'est pas homme à apprécier l'originalité ou le changement. Je redoute qu'à son retour, nous devions quitter les lieux au plus vite.
J'espère que les réparations seront terminées. Et j'espère que nous aurons suffisamment de succès pour nous procurer des provisions. Nous avons déjà reçu pire accueil. Peut-être qu'ils seront nombreux, les villageois, à oser s'approcher. Je ne doute pas un seul instant que toute la vallée d'Âprefond est désormais au courant de notre présence. Ceux qui sont intéressés viendront, nul besoin d'invitation. Et comme le veut la coutume, ils nous laisseront, pour le spectacle offert, de la nourriture, des bibelots, des aiguilles ou du tissu. Nous prenons tout, nous ne somme pas vraiment en position de faire la fine bouche. Voel aime raconter le temps où nous ….
- Yoshka ? Yoshka ?
Je me redresse vivement. Gabor se tient face à moi, sourcils froncés. Les battements affolés de mon cœur se calment peu à peu et je lui adresse un faible sourire. D'un geste du menton, il me désigne le tas de linge qui baigne dans la rivière et lâche :
- Je crois que cette chemise est assez propre.
J'ai frotté chaque pièce de tissu mais la dernière chemise porte les marques visibles de la brosse. Sans doute ai-je inconsciemment fait durer un peu trop, pour ne pas interrompre mes pensées. Je lui adresse un petit sourire contrit, hausse les épaules et essore les vêtements. Il éclate de rire et je me surprends à l'imiter. Nous nous connaissons depuis toujours. Certains seraient surpris de voir ce colosse rire comme un enfant. Ses cheveux toujours emmêlés, ses habits toujours débraillés, son sourire pétillant lui confèrent beaucoup de charme, malgré sa carrure impressionnante. Il le sait, en use et en abuse. Il aime trop butiner à droite et à gauche pour se poser sérieusement avec une femme. C'est pour ça que nous habitons tous deux dans la même roulotte. Les deux seuls célibataires de notre troupe. Je le connais aussi bien qu'il me connaît, et c'est pour cette raison qu'il est venu me chercher. Il ne craignait pas que je me sois noyé mais que je perde toute notion du temps. Et il n'avait pas tort.
- Je ne vois pas pourquoi tu t'obstines à faire ta lessive.
- Ce n'est pas parce que toi, tu trouves toujours une jolie femme prête à nettoyer tes vêtements pour tes beaux yeux que je dois en faire autant.
- Tu pourrais, pourtant. Question beaux yeux, tu n'as rien à m'envier.
Je ne relève pas sa remarque. Il a raison, mes yeux sont mon principal atout de séduction : très clairs, étrangeté pour mon peuple, ils varient du bleu au vert en fonction de la couleur du ciel. Je sais qu'ils plaisent. Un visage au traits réguliers les entoure, classique, ni beau ni laid, qui ne ruine pas leur effet. Mais ça ne change rien à l'histoire. Tandis que nous marchons lentement en directement du camp, je hausse les épaules et rétorque, d'un ton faussement fâché :
- Je ne me prostituerais pas pour qu'une garce récure mes fonds de caleçon.
- Tout de suite les grands mots ! Il s'agit simplement d'exploiter au mieux les capacités naturelles des femmes.
Je lui jette un regard en coin, le sourire sur les lèvres. Ni lui ni moi ne pensons la moindre parole prononcée. Mais hors de question de le laisser avoir le dernier mot. Alors je lâche, provocateur :
- Si Filippia était là, tu n'oserais pas dire un tiers de ce que tu viens de dire.
Ma réplique a fait mouche, et il marmonne une vague excuse pour s'éloigner de moi et se précipiter au campement. Je suis un imbécile. Je n'ignore rien des sentiments qu'il éprouve pour Filippia. Seulement il est incapable de cesser de séduire et de se contenter d'une seule femme. Et Filippia, malgré des sentiments réciproques, est incapable d'accepter cela de la part de son mari. Elle en a épousé un autre. Et lui cherche vainement à l'oublier dans les bras de femmes anonymes. Sur la corde tendue entre deux roulottes, j'étends soigneusement mes chausses et chemises, songeur.
Gabor aussi s'est aventuré sur un terrain glissant. Il sait très bien pourquoi je ne fais pas les yeux doux à une femme pour ma lessive. Il le sait car nous nous connaissons comme deux frères. Et même s'il ne me rejette pas pour ça, même s'il semble s'en moquer, il ne manque jamais une occasion de me taquiner à ce sujet. Il est le seul, avec Voel, à savoir. Ce serait trop …
- Yoshka ?
Je sursaute et me retourne d'un bond. Voel me fait face, soucieux, et décrète :
- Tu crois que les fixer du regard les fera sécher plus rapidement ?
Voyant que je peine à comprendre ses propos, il me désigne d'un geste de la tête mes vêtements étendus sur la corde. Je hausse les épaules, passe une main dans mes cheveux, faisant cliqueter les perles de verre coloré qui les parsèment.
- Il fallait bien que je j'infirme cette théorie.
Il marque un temps d'arrêt avant de me donner une grande claque sur l'épaule en riant. Je grimace un sourire tandis qu'il m'annonce :
- Nous allons bientôt dîner. Tu as une nouvelle histoire à nous raconter, pour ce soir ?
- Oui, tout récente.
D'un geste vague, je désigne ma tempe, et il comprend que je l'ai inventée dans la journée, tandis que nos roulottes s'avançaient au creux de la vallée d'Âprefond, inspiré par les paysages verdoyants.
- Bien. Très bien. Que penses-tu de ce fief ?
Je m'avance à pas lents vers ma roulotte, tête baissée. Voel aime avoir nos impressions lorsque nous arrivons dans un nouvel endroit. C'est un signe de grande humilité, je trouve, alors je prends toujours le temps d'y réfléchir avant de lui donner mon avis. Il m'a emboîté le pas et n'a donc pas de mal à entendre ma sentence :
- On a déjà reçu pire accueil. Et meilleur. Il faudra se tenir prêts à partir au plus vite. Et puis, il y a cet homme en noir.
- Oui, il m'inquiète aussi.
Nous n'avons pas besoin d'en dire plus. Voel m'a côtoyé chaque jour de mes vingt-cinq années de vie. Il connait le fond de ma pensée, et la réciproque est vraie. Alors il hoche simplement la tête, me tape à nouveau sur l'épaule, et s'éloigne.
Je ne traîne pas plus que de nécessaire dans ma roulotte, et je me hâte de rejoindre les autres. Djidjo est parvenue, comme toujours, à nous préparer des merveilles à partir de rien. Aidée de quelques femmes, elles nous ont cuisiné des tubercules dans un bouillon de poule, assaisonnés d'herbes cueillies au bord de la route. Ce n'est pas un repas pantagruélique, mais il est savoureux et les portions copieuses.
La nuit succède au crépuscule, et désormais, seul le feu crépitant illumine le campement. Les reliefs du repas sont rangés et la vaisselle lavée. Les villageois arrivent par petits groupes, tenant leurs enfants impatients par la main, s'installant timidement sur les rondins de bois. Nous les attendions, nos instruments sortis, pour partager avec eux la musique qui réchauffe les cœurs et les récits qui emmènent loin d'ici. Je marque la mesure en tapant dans mes mains, encourageant les villageois à en faire autant. Les musiques endiablées, portées par les voix magnifiques de nos femmes, font fourmiller les corps et invitent à danser. Peu s'y risquent, toutefois, malgré Filippia qui, tel un feu follet, va de l'un à l'autre pour se faire offrir une danse. Voilà en vérité ce qui me fait affronter les regards méfiants : cet instant de communion où, qu'importe la provenance des gens, nous partageons la même joie grâce à la musique. Les enfants du village jouent avec nos enfants, les hommes et les femmes se mêlent pour danser, et les rires ont tous la même intensité.
Un mouvement dans l'ombre attire soudain mon attention. Il est presque illusion, silhouette toute de noir vêtue dans l'obscurité. Mais le feu dansant se reflète dans ses prunelles et la clarté de son visage est bien visible. L'homme en noir de la taverne. Nos regards se croisent pendant une fraction de seconde. Je détourne bien vite les yeux, le cœur battant la chamade. La surprise m'a fait perdre le tempo, et je peine à revenir à la fête. Voel me jette un regard interrogateur et je m'empresse de le rassurer d'un léger sourire. Puis, me faisant violence, je me concentre sur le rythme de la musique. Comme si de rien n'était. La fête doit continuer.