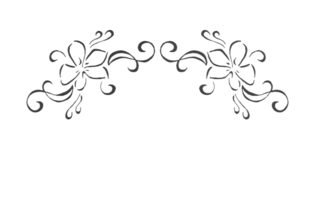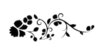Auteur : histoiresyaoi
Date de création : 31-05-2013
Âprefond, chapitre 2
Voici donc un nouveau chapitre, et je propose comme musique : Gari, gari, brûle brûle (le son n'est pas terrible, mais la chanson, si!)
Comme toujours, le temps file lorsque nous sommes autour du feu. Quand les premiers villageois partent, emmenant dans les bras leurs enfants endormis, minuit est déjà passé depuis longtemps. Nous poursuivons un moment, avec des chants moins festifs, plus nostalgiques. Même s'ils n'en comprennent pas les paroles, ceux qui restent sont captivés : la musique parle à l'âme et n'a pas besoin de langage pour ce faire.
Et puis, j'entre en scène. Accompagné de mon cistre, pour donner du rythme à mon récit, je raconte l'histoire que j'ai inventé, parlant de preux chevalier découvrant un havre de bonheur dans une vallée verdoyante isolée de tout. L'accueil est plutôt bon, même si les villageois peinent à réaliser que je parle de leur vallée. Et qu'elle n'a rien d'un havre de paix. Mes compagnons, eux, se laissent porter par les intonations de ma voix, par le débit lent de mes paroles, que j'accélère juste aux moments opportuns, et aiment cette histoire. C'est le plus important pour moi.
Finalement, ils quittent le campement, l'air un peu ailleurs, comme s'ils avaient du mal à revenir à leur quotidien. Comme s'ils peinaient à réaliser à que la vie continue, que dans quelques heures, ils devront être dans leurs champs, à semer pour l'année à venir. Nous aussi, nous avons du mal à nous éloigner du feu. Épuisés, pourtant, nous nous levons chacun à notre tour, pour prendre un repos bien mérité. Mais alors que je m'avance vers ma roulotte, Voel m'intercepte :
- Yoshka ?
Il n'a pas besoin d'en dire plus. Les dernières lueurs du feu me permettent de voir son air soucieux. Je passe une main dans mes cheveux avant de lui dire, à voix basse :
- L'homme en noir était là, contre la roulotte de Djidjo.
Il me dévisage quelques secondes, sans me demander si je suis sûr de moi. Il sait bien que je n'aurais pas inventé tout ça. Puis il hoche doucement la tête et poursuit sa pensée :
- Il a vu que tu l'avais repéré ?
- Oui.
- Il est resté, ensuite ?
- Je ne l'ai plus vu, non.
Il hoche encore la tête puis, d'une claque sur l'épaule, m'envoie me coucher. Gabor est déjà allongé et nous n'échangeons pas beaucoup de paroles pendant que je me prépare pour la nuit. La chandelle soufflée, je reste de longues minutes à fixer, sans le voir, le plafond de bois. Les villageois semblaient contents de leur soirée, c'est un bon présage pour les jours qui viennent. Mais il y a cet homme en noir, qui ne cesse de titiller ma conscience. Qui est-il ? Et quel danger représente-t-il pour nous ?
Les mêmes inquiétudes troublent sans doute le repos de Voel. Mais lui peut sentir, contre son corps, la douce chaleur d'Andronica, son épouse. Je me tourne entre les draps froids, refusant d'imaginer ce que ça ferait si, moi aussi, j'avais un corps contre lequel me blottir.
La matinée est déjà avancée lorsque je me réveille. Je suis l'un des premiers à émerger : de nombreuses roulottes sont encore fermées, et le feu est éteint. Sous le regard inexpressif des bœufs, les poules caquètent dans leurs cages et les chiens terminent leur nuit sous les roulottes. J'en profite pour me rendre à la rivière et me baigner longuement.
Lorsque je retourne au campement, les flammes dansent joyeusement et le petit déjeuner est prêt. Nous mangeons en silence, encore embrumés par le sommeil. Puis Voel nous répartit les tâches. Je serai avec Filippia et Gabor, aujourd'hui. Je leur souris, heureux de passer du temps avec eux.
Filippia, ce petit bout de femme mince, tient une place particulière dans notre grande famille. C'est elle qui, malgré son jeune âge, maîtrise le mieux le secret des plantes. Elle tient ce talent de sa mère, un talent qui nous permet à tous de rester en bonne santé. Aujourd'hui, elle va se rendre dans les bois tout proches, pour y ramasser diverses herbes médicinales qu'elle fera sécher. Gabor et moi l'accompagnons, sous prétexte de ramasser du bois. Nous pourrons ainsi veiller à sa sécurité. Et si jamais du gibier nous passait sous le nez, nous pourrions agrémenter le repas du soir.
Filippia chantonne tandis que nous nous longeons, par habitude, la rivière pour ne pas nous perdre. Et bon nombre de plantes médicinales poussent près de l'eau vive. Tandis qu'elle remplit sa besace, sans jamais la quitter du regard, nous rassemblons le bois sec que nous pouvons trouver. Puis nous nous enfonçons entre les arbres.
C'est une belle petite forêt, à l'entêtante odeur d'humus. Le gibier semble y abonder, car il y a de nombreuses pistes qui semblent exclusivement utilisées par les animaux. Filippia mêle son chant à celui des oiseaux tandis qu'elle scrute le sol à la recherche de plantes. Gabor et moi, nous aussi, examinons les lieux avec attention : ici, le terrier de lapins, là-bas, un nid de grives, plus loin, le chant d'un faisan qui fait la cour à sa belle. Nous sommes aux aguets, pourtant, de crainte d'être surpris : les villageois n'aiment guère qu'on rôde sur les terres qu'ils exploitent, même s'ils n'en sont pas propriétaires. Et même si nous nous éloignons toujours plus du village, le risque d'en croiser quelques-uns n'est pas à exclure.
Filippia ramasse de la saponaire, tandis que je pose un collet devant un terrier. Gabor monte la garde. Mais ça ne suffit pas. Car alors que je contemple mon travail, satisfait, un toussotement se fait entendre dans mon dos. Je me retourne d'un bond. Filippia laisse échapper un cri d'effroi et se cache derrière moi. Gabor, prudemment, va rejoindre notre guérisseuse.
Je me retrouve donc en première ligne face à l'homme en noir, les mains sur les gardes de ses dagues.
Je suis tétanisé. Mes entrailles semblent se liquéfier alors qu'il porte sur moi un regard glaçant. Je déglutis péniblement, essayant d'ignorer, derrière moi, les deux qui tremblent. Je n'ai pas à rougir de ma carrure, je suis loin d'être frêle, même si je ne ressemble à pas un colosse. Mais je ne suis pas armé. Et l'homme en noir est plus grand que moi et armé. Mon esprit s'affole, à la recherche de quelque chose à dire, n'importe quoi qui pourrait briser ce silence sépulcral. Mais j'ai bien conscience qu'un « Salutations, messire ! » ou qu'un « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ? » ne serait pas des plus pertinents.
Il demeure immobile, dardant sur moi ce regard qui me transperce. Je sens que mes lèvres vont laisser échapper un gémissement pitoyable, au lieu d'une répartie intelligente. C'est à ce moment-là qu'il prend la parole. Dans cette forêt qui semble retenir son souffle, sa voix tombe comme un couperet.
- La chasse est interdite ici. Rentrez chez vous.
J'acquiesce péniblement, incapable de prononcer un mot. Gabor et Filippia se précipitent loin de l'inconnu. Et je suis sur le point de prendre mes jambes à mon cou quand il déclare, glacial :
- Vous oubliez quelque chose.
Je lui jette un regard à la fois étonné et interrogateur. D'un mouvement du menton, il désigne le collet, preuve de notre forfait. Je tombe à genoux, répugnant à l'idée de lui tourner le dos. Mais d'un geste vif, à l'aide de mon couteau, je tranche le lien de cuir et empoche le piège. Je me relève d'un bond et m'éloigne instinctivement de lui. Et je détale, comme un lapin, gardant à l'esprit l'image de cet homme, immobile au milieu du sentier.
Nous nous arrêtons devant le tas de bois mort que nous avions constitué, à l'aller. Nul besoin de se concerter : nous rentrons au campement. Filippia nous aide à hisser sur notre dos les deux paniers à lanière. Puis elle les remplit, sans un mot, ses gestes brusques et maladroits trahissant son émoi, du bois collecté. Nous ne marchons plus le nez au vent, Filippia ne chante plus : nous sommes pressés de retrouver la sécurité du campement.
En nous voyant revenir, Voel devine immédiatement que nous avons eu un souci. Cette fois encore, je suis proclamé porte-parole, et c'est donc moi qui lui résume notre rencontre. Sa seule réaction est de nous demander si nous sommes blessés, avant de tourner les talons. Voel est ainsi : il prend toujours son temps pour réfléchir. Gabor va aider Filippia à ranger les herbes qu'elle a ramassé tandis que je m'occupe du bois mort. J'essaie de chasser de mes pensées le souvenir de cette rencontre mais il revient, encore et encore, à la charge.
Je n'ai pas honte de l'avouer : je ne suis pas un héros. Je ne sais pas me battre, j'arrive tout juste à me défendre lors d'une bagarre de taverne. Je ne manie ni dague ni épée : un simple bâton de bois est bien suffisant, ça évite que je me mutile stupidement. Gabor et moi sommes faits du même moule, à ce sujet : nous ne savons pas nous battre, et nous n'aimons pas ça. C'est déjà arrivé que l'un de nos femmes soit importunée par un indélicat. Ou que l'un d'entre nous soit pris à partie par un ivrogne. Nous ne restons pas les bras croisés, nous intervenons. Mais c'est sans technique ni grâce, uniquement avec l'énergie du désespoir et des gestes maladroits.
Le seul qui sache se monter digne d'un combat, c'est Voel. Et je tremble à l'idée qu'il doive, un jour, affronter cet homme en noir. Parce qu'il est comme un père pour moi, mon cœur se serre à l'idée de le perdre. Que deviendrons-nous, tous, s'il venait à disparaître ? Comment pourrions-nous poursuivre sans lui ? La mort fait partie de la vie, bien sûr, mais certaines sont plus douloureuses que d'autres. C'est Ostelinda qui m'extirpe de mes idées noires. De sa petite voix fluette, elle me prévient que le repas est prêt.
Son sourire désarmant fait fuir toutes mes pensées funestes et je la suis bien volontiers, bercé par le froufrou de ses jupes miniatures, sa menotte calée dans ma main. Les mines sont réjouies autour du feu et les plaisanteries fusent. Djidjo, la mère d'Ostelinda, verse de belles portions dans les écuelles tendues, au rythme des éclats de rire. Mais lorsque nous sommes tous servis et installés pour le repas, Voel prend la parole et leur annonce notre rencontre sinistre dans la forêt, changeant l'ambiance du tout au tout.
Puis de sa voix implacable, il déclare que nous devrons toujours nous déplacer par trois, quel que soit l'endroit où l'on se rend. Avec un regard appuyé dans ma direction, il précise que c'est également valable pour la rivière.
Il annonce ensuite que nous ne devons pas pénétrer dans la forêt, et tant pis pour le gibier. Pour le bois mort, nous nous contenterons de suivre le cours de la rivière. Toute personne apercevant l'homme en noir, dont il donne une description précise, doit l'en informer dans les plus brefs délais.
Pour finir, il nous demande la plus grande prudence et nous souhaite un bon appétit. Le déjeuner se fait dans un silence relatif, uniquement troublé par le chahut des enfants. Les adultes sont plus graves : ce n'est pas la première fois qu'ils sont confrontés à une telle menace mais ça ne la rend pas plus plaisante pour autant.
Je termine rapidement mon écuelle et, sur un signe de tête de Ysayo, je le suis jusqu'à sa roulotte. Notre menuisier m'a pris comme aide et il a besoin de moi cet après-midi. Ysayo est de la même génération que Voel, même si le temps l'a plus marqué. Son visage buriné par le soleil est sec et ridé, ses bras musculeux, sans un gramme de graisse. Il n'est pas très grand, mais l'habitude de manier le bois l'a rendu fort comme un bœuf. Je ne suis pas sûr de lui être d'une grande utilité, je l'aide à tenir les chevrons de bois, je fais des petites découpes. Pour l'assemblage, je me contente de placer la pièce et de ne plus bouger : il paraît que je ne sais pas planter un clou droit. Par contre, j'aime faire les finitions. J'aime poncer le bois, sentir la matière chaude sous mes doigts devenir aussi douce que le velours. Je peux y passer des heures, perdu dans mes pensées, à peaufiner les derniers détails. Et puis, je ne suis pas très causant, et je crois bien que Ysayo apprécie de travailler dans le silence.
L'après-midi passe ainsi, dans un silence troublé par le frottement de la scie et la musique lointaine. Le soleil est déjà bas à l'horizon quand je me redresse, le dos crispé d'être resté trop longtemps penché sur mon ouvrage. Je plie et déplie mes doigts tétanisés par la tâche que m'a confié Ysayo. Mais son sourire, lui qui en est si avare, est une belle récompense : il est content de mon travail.
C'est que nous avons tous un rôle, dans notre grande famille. Le travail ne manque pas, lorsque nous nous arrêtons : refaire les provisions, nettoyer nos affaires, entretenir nos roulottes, nos seules et précieuses possessions, soigner les bêtes, planifier la suite du voyage.
Je ne peux me rendre à la rivière pour me rafraîchir, mais pendant que nous travaillions, certains ont amené des tonneaux près des roulottes, et les ont rempli d'eau. J'en profite donc pour faire quelques ablutions avant de passer à table.
La soirée est à nouveau bercée de musiques, de chants et de contes. Nous ne pouvons pas nous arrêter à cette menace sourde qu'il représente. Nous faisons bonne figure et jouons le rôle que les villageois attendent de nous. Notre musique, la danse effrénée de nos femmes, le bonheur d'être ensemble m'aident à retrouver le sourire.
Un sourire qui disparaît à l'instant où, dans l'ombre des roulottes, j'aperçois deux prunelles brillantes. L'homme en noir. Par défi, par folie, je soutiens son regard. Entouré des miens, porté par cette musique qui est toute ma vie, je me sens fort. Il n'osera pas s'attaquer à nous ici, nous sommes trop nombreux. Alors j'ose cet affrontement visuel, j'ose ce défi.
Il cède le premier, détourne le regard avant de s'enfoncer dans les ombres. Je frissonne malgré la douce tiédeur de la soirée. J'espère avoir réussi à le faire partir, à lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu ici. J'espère encore plus fort ne pas m'être fait un ennemi mortel par ce simple échange de regards.
Lorsque je reviens à la fête, cessant d'observer l'ombre de la roulotte, je découvre que Voel me dévisage gravement. Lui aussi, il a dû voir l'homme en noir. Il hoche doucement la tête, sourit un peu, rassurant. Puis je me laisse emporter par les tourbillons des jupes et la musique endiablée.
Les heures passent comme un éclair, les violons s'apaisent, les souffles sont trop courts pour poursuivre encore. Alors je prends mon cistre, je m'installe sur un rondin près du feu, et c'est illuminé par les flammes dansantes que je commence mon histoire.
Les temps dont je vais vous parler sont si anciens que seule une poignée d'hommes et femmes de par le monde s'en souvient encore. A dire vrai, mes braves gens, cette histoire est si ancienne qu'elle est devenue légende...
Elle était là, nichée entre les falaises, cette ville fortifiée dont les vagues venaient lécher les pieds des remparts. Un voile de brouillard ne la quittait jamais, la parant comme les femmes se parent de leurs plus beaux atours. Les habitants vivaient heureux de la pêche, des récoltes des champs avoisinants. Il y avait toujours du passage, dans cette ville, car elle était réputée en Bretagne et même au-delà. Les instruments jouaient nuit et jour pour faire danser les jeunes femmes et même les hommes. Cette ville, elle se situe tout près, entre Saint Pol et Triguier. Enfin... se situait.
Il y avait, dans cette ville, une vieille femme. La vie ne l'avait pas gâtée, loin de là : son mari était parti pêcher en mer, mais n'en était jamais revenu. Ses enfants, elle les avait tous enterré, du moins, ceux dont on retrouva les corps. Maladie, disparition en mer, chute mortelle. Rien ne lui avait été épargné. Et pourtant, elle était toujours disponible, prête à aider quiconque viendrait lui demander de l'aide. Car elle avait été bénie par les Dieux à sa naissance, et elle avait un don. En vérité, je vous le dis, brave gens, elle avait un don formidable ! Elle connaissait toutes les plantes, tous les onguents et tous les breuvages qui pouvaient guérir. Et il lui suffisait de poser les mains sur la poitrine d'un enfant souffrant pour qu'il soit rétabli. Il lui suffisait de masser le ventre d'une femme pleine pour que l'accouchement soit sans douleur. Elle savait soulager les douleurs d'un murmure, et panser les plaies de telle manière qu'en quelques jours, il n'en restait plus aucune trace. Oui, tout le monde aimait cette vieille femme et personne ne l'oubliait jamais quand la disette faisait rage. Elle trouvait toujours, sur le pas de sa porte, un présent, modeste ou généreux en fonction des possibilités de chacun.
Et puis, un jour, ils sont arrivés.
Ils allaient dans les villages et hameaux, dans les villes et dans les ports, apporter la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, qu'ils disaient. Funeste nouvelle, je vous le dis.
Oh, bien sûr, au début, ils faisaient profil bas. Vantaient les mérites de cette ville aux multiples facettes, envoûtante comme une tsigane en robe rouge qui danse autour du feu. Mais il fallait se méfier des apparences. Ils vinrent, et peu à peu, insinuèrent dans l'esprit des gens que les croyances des Bretons étaient hérésie. Que les Dieux qu'ils vénéraient n'étaient que chimères. Ils étaient fort habiles, je vous le jure ! Ils organisèrent d'immondes mises en scène, pour faire croire à tous les miracles divins qu'ils prônaient. Ils flattaient les plus faibles, laissant les gens parler, douter, se convaincre les uns les autres. Ils proclamaient à qui voulait l'entendre, et à ceux qui ne le voulaient pas aussi d'ailleurs, qu'il n'existait qu'un seul Dieu. Un Dieu Unique, tout puissant.
Et la vieille femme, dotée par les Dieux de pouvoirs exceptionnels, s'éleva contre ces mensonges. Elle lutta, avec ses mots, avec ses dons, pour prouver aux autres que les Dieux existaient, qu'ils n'étaient que des charlatans, des imposteurs. Une lutte féroce s'était engagée. Une lutte sans merci.
Et toute la bonne foi de la vieille femme,
tous ses talents furent bien faibles face à la malice des étrangers.
Ceux qu'elle avait aidé, ces enfants qu'elle avait sauvé et ces vieux
qu'elle avait soulagé de leurs douleurs se mirent à douter de sa parole.
C'est pourquoi personne n'osa se révolter quand les étrangers
décrétèrent qu'elle était hérétique, qu'elle affabulait et qu'elle était
dangereuse. Et si certains protestèrent contre la décision, leurs
murmures se perdirent dans les cris de la foule en colère.
Personne n'empêcha les étrangers de dresser un bûcher sur la place. Personne n'osa se manifester quand ils la ligotèrent au pieu. Et personne ne pipa mot quand ils enflammèrent les fagots de bois.
Le visage de la vieille femme était serein, aussi surprenant que cela puisse paraître. Elle regardait les habitants se masser autour d'elle, ivres de colère, manipulés, et eu de la peine pour eux. Oui, elle avait de la peine pour ces êtres faibles pour qui les croyances se changent aussi facilement qu'une chemise. Elle avait de la peine pour ces esprits faibles qui ne se souvenaient que de ce qui les arrangeait.
Et
ses croyances à elle lui assuraient de retrouver son mari, ses enfants,
et tous ceux qu'elle avait aimé. Alors ... partir de ce monde hypocrite
ne lui semblait pas si terrible...
Mais la Déesse Airmed, fille du dieu-médecin Diancecht, qui avait pourvu la vieille femme de ses dons, s'indigna.
Elle
s'indigna d'avoir donné la vie, la santé, et l'espoir à de si viles
créatures. Elle trembla de colère en voyant ces imposteurs monter ainsi
les gens les uns contre les autres.
De voile, le brouillard devint linceul. Puis il fut chassé par des pluies torrentielles, qui éteignirent le bûcher, ruisselèrent dans les ruelles en les transformant en rivières déchaînées. Puis, un vent violent se leva. Si violent qu'il arracha les toits de chaume, les ardoises et les tuiles. Les vagues venaient s'écraser de plus en plus violemment contre les murs d'enceinte, projetant leurs embruns loin dans les terres.
Et la ville fut engloutie par la mer, avalée par le courroux divin, et disparut à tout jamais. Nul ne revit jamais les étrangers, ni aucun habitant. Il se murmure que, parfois, leurs âmes errantes s'attaquent aux navires égarés. Mais j'ignore si c'est la vérité.
Ce que
je sais, par contre, avec certitude, c'est que cette histoire ne doit
jamais être oubliée. Et qu'avant de renoncer à ce que vous croyez au
plus profond de vous-même, réfléchissez et assurez-vous que personne ne
cherche à vous manipuler.
Les mots meurent sur mes lèvres et le silence perdure. Je ne suis pas fier de la chute, mais les villageois semblent réfléchir à cette histoire : une partie est gagnée. C'est une histoire délicate, que je ne raconte pas souvent. Même si je sais que mon public ne fait pas partie des plus bigots, le risque est grand que ce récit déplaise à l'Église. Mais j'ai toujours eu beaucoup de chance, choisissant avec soin les villages où je la raconte, et j'arrive à m'en sortir avec une pirouette. Après tout, puisque l'Église a réussi à convaincre le brave peuple que les Dieux ne sont que foutaises, je plaide en leur faveur. Si un olibrius s'amusait à prétendre que Dieu n'existe pas, alors les fidèles réagiraient par de la méfiance.
A dire vrai, je crois plus aux Dieux qu'à un Seigneur tout-puissant. Il va de soi que cette croyance est enfouie au plus profond de mon cœur. Nous sommes déjà assez mal vus comme ça, inutile de rajouter hérésie à notre liste de forfaits, réels ou imaginaires. Ils n'ont pas besoin de ça pour nous détester et pour vouloir nous …
- Excusez-nous.
Je redresse vivement la tête pour me retrouver face à un couple de jeunes villageois, elle tenant un nouveau-né dans ses bras, lui tenant un jeune garçon par la main. Ils me sourient, compréhensifs, tandis que je jette un rapide regard autour de moi. Les villageois se sont enhardis et discutent, ça et là, avec nous. Je me lève, détestant rester assis quand mes interlocuteurs sont debout. L'homme s'éclaircit la gorge avant de déclarer, comme s'il avait répété cette phrase plusieurs fois avant d'oser m'approcher :
- On voudrait vous remercier pour cette magnifique histoire. Pour sûr, elle donne à réfléchir.
- C'est un plaisir. Tout l'intérêt des contes et légendes réside dans le message qu'ils transportent : si nous y parvenons, alors nous avons accompli notre travail.
- C'est marrant que vous parliez de travail, c'est beaucoup moins difficile que faucher un pré ou pétrir du pain.
- Ce n'est certes pas un travail physique. Mais je vous assure qu'il réclame beaucoup de labeur.
La jeune femme souriante prend soudain la parole, tandis qu'elle pousse doucement le jeune garçon vers moi :
- A ce sujet, puisque tout travail mérite salaire... Jehan voudrait vous offrir quelque chose.
Je me penche pour être à sa hauteur, mes perles cliquetant dans mes cheveux. Il tente un sourire timide, ses grands yeux marrons reflétant les lueurs du feu, avant de me tendre un simple cailloux. Et d'une voix hésitante, il m'explique :
- C'est un caillou de la rivière, messire, que j'ai trouvé tout à l'heure. Il est très beau !
- On n'est vraiment pas riches, rajoute la mère, et on ne peut pas vous donner mieux. Mais on aime vraiment les soirées que vous nous laissez partager avec vous.
Je souris de toutes mes dents, heureux. Je ne cherche pas de richesses. Ce caillou ne vaut rien, mais il vient du cœur et ça le rend inestimable. Le plus sincèrement du monde, je réponds, tout en faisant tourner la pierre entre mes doigts :
- C'est un très beau présent, Jehan, je suis très touché par cette attention. Le conte de demain soir parlera du preux chevalier Jehan qui, jadis, sauva notre Royaume de l'invasion barbare.
Le gamin tape dans ses mains, ravi comme seuls les enfants peuvent l'être. Je n'ai pas le temps de m'adresser aux parents : le motif de la pierre attire soudain toute mon attention. C'est une pierre grise, toute simple d'apparence. Mais elle est veinée de blanc et ces lignes forment un H grossier mais parfaitement reconnaissable.