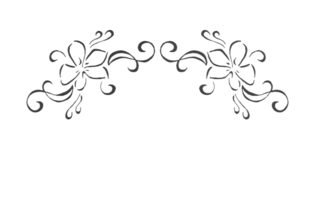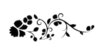Auteur : histoiresyaoi
Date de création : 31-05-2013
Âprefond, chapitre 4
Voici donc un nouveau chapitre ! Je vous propose, comme musique d'accompagnement, bratsch - sari siroun yar. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente lecture !
Je suis incapable de bouger ou même de respirer. Les grains de poussière qui dansaient dans les rayons du soleil filtré par le feuillage du chêne centenaire, au centre de la place, se sont figés. Le chien qui dormait sur le seuil d'une maisonnette a redressé la tête, alarmé. Dans le calme inquiétant de la place, la voix glaciale de l'homme en noir semble résonner comme un coup de tonnerre :
- Je m'en occupe.
Sa déclaration me fait l'effet d'un coup de fouet. J'ignore ce qu'il entend par « s'en occuper » mais je redoute le pire. Je l'imagine mal compréhensif ou délicat : je le vois plus tabasser puis poser les questions ensuite. Un rapide coup d'œil à Filippia et Gabor et nous nous remettons en chemin : les premiers villageois rebroussent chemin, sans doute aussi impressionnés que nous. Inutile de se faire voir. Nous nous engageons dans la première ruelle venue et nous nous éloignons à grand pas, oublieux de notre chargement et de la douleur aux pieds. Nous restons silencieux alors que les maisonnettes aux volets usés par le temps défilent. Nous ne croisons que quelques chiens, des chats qui cessent leur toilette pour nous regarder passer. J'ignore où sont passés tous les gens mais j'apprécie ce calme : qui sait ce qu'ils pourraient faire s'ils nous voyaient là ?
Situé à la sortie du village, l'atelier du forgeron n'a pas sombré dans la torpeur générale. Je m'immobilise devant l'entrée, marquée par un portillon en piteux état. Contre l'avis de Gabor, qui devine mes intentions, je pousse l'assemblage de bois et je m'avance dans l'atelier. Le théâtre de marionnettes est resté dehors, sous la surveillance de Gabor et Filippia, et je sais que je dois être rapide.
C'est une montagne de muscles, ruisselante de sueur, qui m'accueille d'un regard peu engageant. L'homme n'est plus tout jeune mais encore bâti comme un taureau. Il poursuit son ouvrage, frappant de grands coups de marteau sur la pièce rougeoyante. La forge est installée sous un auvent, à l'abri des intempéries mais au grand air. Le temps qu'il finisse, j'observe les nombreux instruments soigneusement alignés contre le mur du fond, les articles déjà forgés, ceux en attente de réparation. Mais je n'arrive pas à voir nos essieux. Il n'interrompt son travail que lorsqu'il a terminé de façonner ce qui ressemble à un socle de charrue et qu'il le jette dans une cuve d'eau.
Tandis que l'eau crépite et dégage des nuages de vapeur, il se tourne un regard noir vers moi. Je déglutis, pas vraiment rassuré mas je dois savoir, alors je m'éclaircis la gorge et demande d'une voix ferme :
- Bonjour. Je voudrais savoir où en est la réparation des essieux.
Je ne me présente pas, il n'ignore pas qui je suis. Il a parfaitement compris de quoi je voulais parler, puisqu'il me répond d'une voix rocailleuse :
- Pas terminée. Et la réparation est en suspens.
Je plante mon regard surpris dans le sien. J'entr'ouvre la bouche pour lui demander des explications mais il me devance. Dans un grognement, il continue :
- Tu crois que je ne suis pas au courant ? Je ne reprendrai pas la réparation tant que nous n'aurons pas retrouvé cette vache.
Je referme la bouche : son raisonnement est plein de bon sens, même si c'est à nos dépens. Je tente tout de même :
- Vous ne pourriez pas au moins terminer ? Et nous ne viendrons les chercher que lorsque cette vache sera retrouvée ?
- Pour que vous veniez les voler à la nuit tombée ? Pas question. Je garde les essieux en l'état.
Il va appuyer sur l'énorme soufflet et les braises rougeoient de plus belle. Puis il attrape une pièce de métal qu'il jette dedans. Sa manière à lui de m'annoncer que la discussion est close. Je devine que je n'ai aucun intérêt à essayer de la relancer, ni à expliquer que ce ne serait pas du vol, si nous les reprenions, puisqu'ils sont à nous et que les réparations sont payées d'avance. Comme je le disais, je ne suis pas un héros.
Je quitte donc l'atelier, rejoins Gabor et Filippia. Je leur résume, à voix basse, les paroles du forgeron. Ils ne font aucun commentaire, se contentent d'une moue qui veut tout dire, et nous reprenons notre chargement. Nous quittons enfin le village et, alors que nous marchons sur la route de terre, je me perds dans mes pensées. Le village est juché sur un promontoire et cerné par des champs verdoyants. Des haies soigneusement entretenues, faites de buissons et de petits arbres, délimitent les cultures. La route principale, rendue chaotique par le passe régulier des hommes et des charrettes, serpente à travers les prés en une pente douce jusqu'à la rivière. Non loin, notre campement est parfaitement visible, dernier rempart humain avant l'immense forêt qui couvre une bonne partie des terres. Seule ombre au tableau, le château, sombre et menaçant, qui domine les lieux, loin sur ma gauche. Ce fief est un écrin de verdure, bercé par le chant des oiseaux, un endroit où je me serais bien vu rester plusieurs jours, voire quelques semaines. Mais la rumeur enfle déjà, et je pressens que ce paysage qui s'étale sous mes yeux ne sera bientôt qu'un beau souvenir.
Quittant la route, nous foulons l'herbe haute pour rejoindre nos roulottes, installées en un cercle approximatif. Au centre, le feu n'est pas encore allumé, mais tous sont en train de déjeuner, assis sur des rondins de bois, quelques chaises sorties des roulottes ou encore sur des pierres. Les enfants se précipitent vers nous en piaillant, réclamant un récit complet de notre matinée. Filippia les renvoie gentiment à leur repas, tandis que Gabor et moi allons poser la caisse vers notre roulotte. Filippia remet à Voel la recette de la matinée, puis nous allons nous servir dans la marmite posée à même le sol.
Nous arrivons tard, alors nous nous dépêchons d'engloutir le ragoût de truite mitonné par Djidjo, appréciant à peine les saveurs qui régalent pourtant nos papilles.
Les écuelles vides, nous nous approchons de Voel pour lui rapporter ce que nous avons vu et entendu. Alors, en quelques phrases, il explique la situation à l'ensemble du campement. Puis il donne ses consignes : nous devons absolument terminer nos réparations cet après-midi. Les femmes et les enfants se chargent de ranger tout ce qui n'est pas indispensable à notre quotidien. Et tous doivent se préparer à recevoir des visites, pas forcément amicales.
Nous terminons toujours nos repas par quelques discussions ou plaisanteries poussives. Mais les consignes de Voel ont jeté un froid, et nous nous dispersons tous pour vaquer à nos occupations.
Gabor et moi allons ranger le théâtre dans la roulotte puis nous nous rendons à nos postes respectifs. Gabor va aider Voel à réparer les coussinets et les jointures des jougs. Nos bœufs nous sont très précieux et nous prenons grand soin des jougs qui leurs permettent de tirer nos roulottes. Le travail du cuir demande force et précision, ce qu'à eux deux, ils réunissent.
Je me rends à la roulotte de Ysayo, où des tréteaux supportent les nombreuses pièces de bois à réparer et entretenir. Je ne me perds pas dans mes pensées cet après-midi : le travail doit être terminé et il n'est pas question de gaspiller la moindre minute. Ysayo en est bien conscient et me donne des ordres bref, que j'exécute sans tergiverser.
Notre labeur est interrompu quelques heures après avoir commencé, lorsqu'une étrange tension parcourt le camp. Nous nous redressons dans un même ensemble et je frissonne en voyant l'homme en noir s'avancer au milieu de nos roulottes. Il pénètre dans notre intimité, foulant l'herbe haute, sous des dizaines de regards. Et pourtant, il fait preuve de la même assurance et de la même détermination que lorsqu'il est rentré dans la taverne l'autre jour. Il n'hésite pas, ne regarde pas autour de lui. Il marche droit vers Voel, les bras le long du corps, prêt à se saisir de ses dagues. Les mots qu'il prononce sont inaudibles d'où je suis, mais je vois Voel acquiescer et se diriger vers l'enclos des bœufs.
Je connais assez Voel pour deviner, à travers ses gestes, son intimidation. L'homme en noir examine nos animaux, observe les poules, puis échange encore quelques paroles avec Voel. Puis il repart comme il est venu, sûr de lui et ne craignant rien ni personne.
Voel retourne à ses occupations : c'est la fin de l'intermède. Nous en saurons plus à la veillée. Jusqu'à la tombée de la nuit, nous scions, ponçons, ajustons, clouons et fixons du bois. Et lorsque la lueur dansante du feu ne nous permet plus de poursuivre, Ysayo me sourit. Nous avons quasiment terminé. Épuisés, nous dînons dans un silence inhabituel. Voel ne nous apprend pas grand-chose. L'homme en noir est venu, a examiné nos animaux et les a comptés, a interrogé Voel sur nos activités puis s'en est allé.
Ce soir-là, je ne raconte pas l'histoire de Jehan le preux chevalier. Parce qu'aucun villageois n'a osé nous rejoindre. Nous passons une soirée calme, rythmée par une musique mélancolique qui parle de contrées lointaines où nous sommes toujours les bienvenus. Où personne ne nous regarde de travers. Où la fête, les rires, les chants et les danses sont permanents.
Minuit est encore loin quand toutes les roulottes sont fermées pour la nuit. Lorsque je retire mes bottes, je découvre sans surprise mon gros orteil violacé et gonflé. Demain, je demanderai à Filippia un peu de son baume contre les contusions. Pour l'heure, même si j'ai pas la tête à ça, je dois me reposer. Ysayo, Voel, et Isaï, le mari de Filippia, se relayeront pour monter la garde et s'assurer que personne ne vient mettre le feu à notre campement.
Ce serait un mensonge de dire que j'ai bien dormi. Mon sommeil a été troublé par des visions cauchemardesques, remplies de feu et de silhouettes noires hostiles. Je me réveille en sueur, à la pointe du jour. Je quitte rapidement les draps chiffonnés pour apaiser mes angoisses sous le soleil matinal. Je suis loin d'être le premier levé, et je ne suis pas le seul à avoir la mine brouillée.
Je me change et fais un brin de toilette pour chasser les derniers vestiges de mes cauchemars. Mon orteil me fait mal, mais Filippia est en train de s'occuper de la vieille Illmiya et je n'ose pas me plaindre d'une douleur aussi ridicule : notre doyenne est en fin de vie et Filippia l'apaise comme elle peut. Je leur adresse un petit sourire réconfortant avant d'aller rejoindre les autres autour du feu.
Le petit-déjeuner se fait dans le silence. Même les enfants, conscients de la tension, restent auprès de leurs mères sans chahuter. Nous ne nous attardons pas et chacun reprend ses activités, la mine sombre. Ysayo me fait savoir qu'il n'a pas besoin de moi, pour ce matin, et qu'il pourra bien terminer tout seul. Filippia, par contre, a vraiment besoin de plus de plantes, notamment de houx, de bardane et d'un autre nom étrange, pour Illmiya. Nous ne savons pas quand nous pourrons partir et ça peut être dans plusieurs jours. Et d'expérience, nous nous attendons à ce que la tension augmente encore. Nous n'y sommes pour rien, dans ce vol, et ils ne trouveront pas la vache chez nous. Et comme nous ne pouvons pas repartir tant qu'ils ne l'auront pas récupérée, leur hostilité va aller crescendo. C'est donc maintenant ou jamais que nous devons ramasser ce dont nous avons besoin hors du campement. Plus tard, ça sera sans doute trop dangereux. Et même une fois partis, nous ne pourrons pas nous arrêter dans le prochain fief. Si nous sommes, dans le meilleur des cas, innocentés de ce vol, la rumeur se sera répandue au-delà des frontières d'Âprefond.
Voel le sait, et c'est pour ça qu'il nous missionne, Gabor, Filippia et moi, pour aller chercher autant de bois mort et d'herbes que nous pouvons. Nous devons être rentrés pour le déjeuner et faire preuve de la plus grande prudence. Interdiction formelle de s'approcher du village ou des champs cultivés et interdiction formelle de s'enfoncer trop profondément dans la forêt.
Nous progressons donc lentement, remplissant nos paniers de bois au fur et à mesure, surveillant le chant des oiseaux qui nous avertira des dangers. Filippia est concentrée et empressée. Tellement empressée, même, qu'elle s'entaille l'index en coupant une poignée de saponaire. Elle laisse échapper un petit cri alors que le sang ruisselle le long de son doigt. Gabor, protecteur, se précipite pour évaluer les dégâts, bien qu'il soit parfaitement incompétent dans le domaine. Je m'approche aussi, inquiet pour notre guérisseuse.
Sa coupure ne semble pas profonde, bien qu'elle saigne beaucoup. Filippia tente de nous rassurer, nous expliquant que c'est normal avec les doigts. Gabor ne semble pas convaincu et je dois avouer que je ne le suis pas beaucoup plus. Filippia enroule un morceau de tissu autour de son doigt et nous presse de terminer notre récolte au plus vite.
Mais soudain, je réalise que les oiseaux ne chantent plus. Une fraction de seconde plus tard, un craquement sonore résonne entre les troncs d'arbres. Puis tout va très vite. Je leur hurle qu'il faut partir. Je crois même que je pousse Gabor, comme pour lui donner de l'élan. Mais c'est trop tard. La première pierre m'atteint à la poitrine, tandis que des beuglements hostiles se font entendre. Les villageois nous ont trouvé, ils émergent par petits groupes entre les arbres. Nous courrons. Nous détalons comme des lapins, zigzaguant entre les bosquets, sous une pluie de pierres. Instinctivement, nous nous séparons : nous serons une cible moins facile. J'ai laissé mon panier sur place. Tandis que je galope sur l'humus, je pense, bêtement, qu'il faudra revenir le chercher, plus tard. Je ne vois plus Gabor ni Filippia. Je perçois juste leur présence, non loin. Je m'étonne de la présence des villageois ici, comme s'ils nous attendaient. Mais je ne cherche pas à en connaître la raison, je fuis. Des ronces se prennent dans mes chausses, des branches basses fouettent mon visage. Je ne ralentis pas. Les villageois ont soif de sang et je préfère savoir le mien dans mes veines.
Je ne vois pas la racine de l'arbre qui me fait trébucher. Je sais juste que, emporté par mon élan, je m'écroule au sol et qu'une douleur fulgurante explose dans mon épaule. Je me relève tant bien que mal. J'ai l'impression de sentir le souffle des villageois sur ma nuque. Dans mon esprit, ils se sont transformés en une horde sanguinaire et impitoyable. Je sens leur haine me cerner, chercher à me retenir. La panique me fait perdre le souffle et fait danser des points noirs devant mes yeux. Ou peut-être est-ce la douleur à l'épaule. Une autre pierre m'atteint au bas du dos, me faisant glapir.
Je glisse soudain. Des feuilles mortes, peut-être. Je ne sais pas. Ma tête cogne violemment contre le sol. Je dois me relever. Je dois fuir. Je dois …
J'émerge difficilement. Mes paupières se soulèvent lentement, comme si elles étaient lestées de plomb. Je dois les faire cligner plusieurs fois avant de comprendre ce qu'il se passe. L'obscurité est totale. J'essaie de porter ma main aux yeux mais je m'arrête dans un gémissement. Des élancements de douleur partent de mon épaule, gagnent mon cou, mon bras. Puis la tête, la poitrine, le bas du dos, les genoux, le gros orteil se rappellent à mon bon souvenir. Tout mon corps est douloureux, à des degrés divers.
Je ferme les yeux, avale ma salive. Lentement, je fais le point. Ce ne sont que des hématomes, contrecoup des chocs reçus. Rien de bien grave. Mon épaule m'inquiète un peu plus, car j'ai vraiment du mal à bouger le bras. Quant à ma tête... Précautionneusement, je lève la main gauche jusqu'au point le plus sensible. Je sens déjà une bosse énorme, mais pas de sang. Est-ce pour ça que je suis aveugle ?
Je laisse retomber ma main, qui se pose sur une matière rêche. Je la palpe, l'examine du bout des doigts. Ça craque un peu mais c'est assez malléable. Mon esprit peine assembler les informations que recueillent mes doigts. Puis soudain, c'est le déclic. Je suis allongé sur une paillasse.
Les battements de mon cœur s'affolent mais je tente de garder la tête froide. Je passe en revue toutes nos roulottes, toutes nos possessions. Non, nous n'avons rien de semblable, au campement. Et puis, ce silence, lourd, absolu, ne correspond pas. Il y a toujours une poule pour caqueter, un chien pour japper, un gamin pour brailler, un instrument pour chanter. Mais là, rien. Le choc à la tête m'aurait-il rendu sourd également ?
Où suis-je ?
Je bascule lentement sur mon séant. La douleur pulse dans mon crâne. Les perles dans mes cheveux résonnent comme un grondement de tonnerre. Je suis à même le sol, libre de mes mouvements. Je garde toutefois le bras droit contre mon torse, pour épargner mon épaule. Le gauche se tend et mes doigts entrent en contact avec le sol. Lisse, doux, froid et un peu humide. Je sollicite mon esprit pour qu'il l'identifie, mais c'est visiblement trop lui en demander. Alors je porte mes doigts jusqu'au nez, renifle. De la terre battue. Mon odorat semble enfin vouloir se montrer coopératif et m'indique que toute la pièce sent la terre et l'humidité.
Où suis-je, bon sang ?
Si je suis dans des geôles, pourquoi n'y-a-t-il pas la moindre lumière ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas entendre des éclats de voix de gardiens, des cliquetis de clefs ou de chaînes ? Et pourquoi ai-je le sentiment d'être enterré vivant ? J'essaie de juguler la panique qui monte en moi. Je veux me lever, je veux connaître la taille de la pièce. Mais la sentence de mon corps est sans appel : ce n'est pas possible. Alors je me traîne tant bien que mal par terre, grimaçant lorsque le sol frotte trop contre mes contusions. Un obstacle se dresse soudain contre moi. Ma main gauche, avide, part à sa rencontre pour le palper. Une matière douce, comme polie, sans aspérités ni rainures. Je pose mon front contre, c'est frais et agréable. J'inspire de toutes mes forces. Mais je n'arrive pas à identifier la matière.
Mais où suis-je, ventre-dieu ?
Soudain, un bruit se fait entendre. Il me vrille les oreilles, habituées au silence. Un cliquetis. Une clef qui tourne dans une serrure. Un grincement léger. Puis une lumière insoutenable me brûle les yeux.
Je me recroqueville contre ce mur étrange, protège mes yeux de l'agression avec le bras gauche.
Le silence, à nouveau.
Lentement, je baisse mon bras. Quelques secondes encore et la lumière intense m'apparaît comme ce qu'elle est réellement : une lampe à huile, à la flamme chiche et vacillante. Elle pend à un crochet fixé dans le cadre de la porte. Une porte en bois plein, usé par le temps.
Un mouvement sur ma droite me fait sursauter. L'homme en noir vient de déposer un pichet au sol et s'apprête à partir.
- Où suis-je ?
Ma voix n'a jamais été aussi rauque et faible. J'avale à nouveau ma salive. Je suis sur le point de poser à nouveau la question, de crainte qu'il ne l'ait pas entendue, quand il tourne lentement sur lui-même. Il se tient dans l'encadrement de la porte, immobile, le visage sévère et les yeux assassins. Et d'une voix dénuée de toute émotion, il m'indique :
- Tu es en état d'arrestation.
Ses mots se frayent lentement un chemin dans mon esprit. Trop lentement. Je fonctionne au ralenti, je n'ai pas les idées claires. Il tend la main vers la lanterne, considérant la discussion close. Je ne veux pas qu'il parte avec la lumière. Je ne veux pas être à nouveau enterré vif. Alors je demande, un peu plus fort :
- En état d'arrestation ?
- Oui. Comme je l'ai dit.
- Pour la vache ?
Il s'immobilise, s'adosse au chambranle de la porte, croise les bras sur sa poitrine. Puis il me dévisage pendant de longues secondes, agacé, avant de répondre :
- Pour enlèvement.
- Pour enlèvement de vache ?
Un frémissement agite sa lèvre supérieure, signe de contrariété, je suppose. Il laisse le silence s'étendre entre nous avant de s'expliquer :
- Pour l'enlèvement de Mélisende, jeune fille de quatorze printemps, qui a disparu depuis hier au soir.
Cette déclaration me fait l'effet d'un coup de fouet. Je me penche vivement vers lui, soudain parfaitement lucide, oublieux de mes douleurs et débite :
- Quoi ? Une jeune fille ? Non. Non, non, non ! Ce n'est pas possible ! Je n'y suis pour rien, je vous jure. Autant une vache, je pourrais comprendre, mais une jeune fille …
- Tu avoues avoir volé la vache ?
- Non. Je n'ai rien volé. Rien du tout. Je vous le jure sur la Sainte Croix. Mais... une jeune fille, sérieusement ? Au moins, la vache servirait à quelque cho...
Je me mords les lèvres tandis qu'il hausse un sourcil. Je ne suis peut-être pas aussi lucide que ça, finalement. Il reste de marbre, silhouette silencieuse et sévère. Alors, en pesant chacun de mes mots, j'essaie de me rattraper :
- Je n'ai rien volé. Nous n'avons rien volé. Pourquoi aurions-nous enlevé une pauvre jeune fille ? Pourquoi l'arracher à l'amour tendre de ses parents ?
- Pour la marier de force à l'un d'entre vous ? Toutes les femmes de votre groupe sont prises. Il n'y a que deux célibataires, parmi vous. Il vous faut de la chair fraîche.
J'ouvre la bouche, prêt à rétorquer, à me justifier. Et je la referme tout aussi vite, avant de dire une connerie plus grosse que moi. Il se détache du chambranle, attrape la lanterne et, sans me regarder, m'annonce :
- J'ai à faire. Je reviens plus tard.
Et sans attendre, il quitte la pièce et referme la porte derrière lui, me replongeant dans le noir. Je ne le retiens pas. Ses explications m'ont assommé. Et comment pourrais-je le retenir, de toute façon ?
Il me faut du temps pour pouvoir réfléchir à nouveau. Je me souviens de la poursuite dans la forêt, de la chute. J'ignore pourquoi ils étaient dans la forêt à nous attendre. J'imagine qu'ils ont délaissé les travaux aux champs pour aider les parents de la jeune fille et organiser une battue pour la retrouver. Ou peut-être qu'ils ont organisé une battue pour nous attaquer et se venger. Qu'importe, le résultat est le même, ils étaient là-bas, et nous aussi. Je suppose que les villageois m'ont rattrapé et, après m'avoir frappé à loisir, m'ont remis à l'homme en noir. De là, je me suis retrouvé, inconscient, dans ces geôles. Des geôles souterraines, situées dans des grottes. Car grâce à la lumière, j'ai pu voir les murs luisants, polis par l'humidité. Je sais quasiment où je suis.
L'homme en noir m'a dévoilé une information très importante : je suis en état d'arrestation. Pas « vous êtes ». Donc normalement, Gabor et Filippia ont pu fuir jusqu'au campement. Je l'espère de tout mon cœur. Ils ont pu se placer sous la protection de Voel. Et nous sommes trop nombreux pour que les villageois osent s'en prendre directement au campement. Du moins, j'espère que leur désespoir ne les conduira pas à une telle extrémité. Et j'espère que les miens ne commettrons pas de folie pour me récupérer.
L'homme en noir a visiblement mené son enquête. Il sait beaucoup de choses sur nous, beaucoup trop à mon goût. Il a dû aller au campement, poser ses questions, fouiner dans nos affaires. Et peut-être même a-t-il annoncé à Voel que j'étais en geôles. Je prie pour qu'il l'ait fait. Voel s'inquiètera pour mon sort, mais il ne se retournera pas les sangs en m'imaginant à la merci des villageois, loin de toute autorité. Car même si je n'arrive pas à déterminer le rôle exact de cet homme en noir, je suis désormais convaincu qu'il représente une forme d'autorité. Il semble être impliqué dans les affaires qui nous concernent, quasiment comme un enquêteur. Et s'il a employé ce terme, « état d'arrestation », c'est bien qu'il a les pouvoirs pour arrêter quelqu'un. Non ?
Je prends de longues inspirations pour essayer de me calmer. Ces déductions étaient apaisantes, elles me permettent de savoir où j'en suis. Mais elles ne résolvent pas le problème principal : je suis accusé d'enlèvement de jeune fille.
Une vache est une denrée précieuse. Elle coûte très cher à l'achat mais offre, à son propriétaire, du lait, des veaux parfois, et de la viande. Voler une vache est un crime et le châtiment est de couper une main du voleur. Je réalise que j'aime bien mes deux mains, sans distinction. Elles me sont précieuses pour jouer du cistre, pour poncer le bois, pour manipuler les marionnettes. Mais si la situation devenait inextricable, si être reconnu coupable pouvait ôter la suspicion qui règne sur nous tous et si ça nous permet de quitter cette fichue vallée, alors je suis prêt à perdre une main.
Mais un enlèvement de jeune fille... Elle est vierge, à tous les coups, et ça ne fera qu'aggraver la sentence. Les braves gens vont imaginer cette Mélisende aux prises à un groupe de tsiganes, battue, violée, engrossée sans répit. Ils vont s'indigner, réclamer justice. Réclamer ma tête.
Et que puis-je dire pour ma défense ? Que je suis innocent ? Ils ne me croiront pas. Nous ne sommes pas seulement des voleurs, nous sommes aussi des menteurs, c'est bien connu. Alors non, ils ne me croiront pas si je leur dis que je n'ai pas touché cette fille et que j'ignore où elle est. Et si par malheur, je leur disais que non, jamais je n'enlèverais une femme, parce qu'ils n'y a que les hommes que j'ai envie de couvrir de caresses, alors je serais condamné pour bougrerie. Je serais torturé, au mieux. Et ils chercheront un autre coupable parmi les miens.
Le silence oppressant et l'obscurité se liguent pour attiser ma panique. Mon errance va prendre fin ici, à Âprefond, charmante petite vallée luxuriante, dans des souffrances inimaginables. La torture du bougre, à laquelle nous avions assisté contre notre gré il y a des années, me revient à l'esprit. Je chasse de toutes mes forces ces images qui hantent encore mes cauchemars, mais elles reviennent inlassablement. Je me bouche les oreilles pour ne pas entendre ses hurlements, je ferme les yeux pour évincer les images. En vain.
La terreur me submerge. Mon ventre se noue douloureusement, ma gorge semble être prise dans un étau. Ma poitrine est si compressée, soudain, que je peine à respirer. Je hoquète, sanglote, m'étrangle. L'air n'arrive plus dans mes poumons. Et je me sens partir.