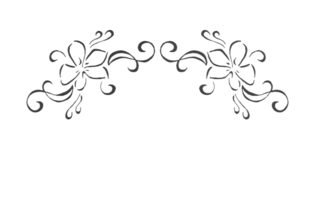Auteur : histoiresyaoi
Date de création : 31-05-2013
Âprefond, chapitre 5
Pour la musique, je vous propose : šaban bajramović - geljan dade
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente lecture !
On me transporte. Des formes et des couleurs passent devant mes yeux. On m'emmène subir la question, c'est sûr. Le bourreau sera là. Il va m'interroger, me faire subir le fouet et l'écartèlement jusqu'à ce que j'avoue. Et j'avouerai, c'est sûr. Alors il m'attachera, dans la cour du château, nu devant des spectateurs avides. Il me fera castrer, devant tout le monde, et mes souffrances seront indicibles. Dans le meilleur des cas, je survivrais, mutilé à jamais, l'infamie gravée dans ma chair. Sinon, je me viderais de mon sang, devant des villageois ravis que justice soit me débats désespérément en protestant à cette idée mais le manque d'air me rend faible comme un chaton. Je suffoque. Ma vie est finie.
Et puis, soudain, je suis dans l'herbe. Vautré de tout mon long dans une herbe d'un vert magnifique, je sanglote en hoquets douloureux. Je crois que je supplie, aussi, mais mes paroles n'ont aucun sens à mes propres oreilles. Seul le silence me répond.
J'ignore combien de temps je reste comme ça. Mais mes larmes se tarissent et ma respiration devient plus facile. Je ne suis pas entravé, étrange. Je relève un peu la tête : le souffle de la brise effleure mon visage, caresse aimante. Le ciel s'est paré de ses nuances orangées, annonciatrices du crépuscule. Une de mes mains s'agrippe à l'herbe, comme pour se rattacher à la vie. Ma poitrine est douloureuse mais je suis en vie. Une main se pose sur mon épaule, légère. L'homme en noir, accroupi, me dévisage en silence, impassible.
Les minutes qui passent rendent ma respiration plus régulière et les battements de mon cœur moins affolés. Si le Dieu miséricordieux, auquel ils croient si fort, est réellement bienveillant, alors qu'Il fasse que je meurs ici et maintenant, dans la quiétude de cette clairière.
Lui aussi doit avoir une dent contre les tsiganes, car je ne meurs pas. L'homme en noir se redresse, fait les cent pas, me faisant comprendre que je ne peux pas rester comme ça, vautré dans l'herbe. Je me redresse, m'assois, vacille. Mes vêtements sont déchirés, tachés de sang et de boue. J'ai souillé mes chausses marron, qui s'ornent désormais d'une large auréole foncée autour de l'entrejambe. Tout mon corps est douloureux. Et l'homme en noir ne cesse de me regarder. Mais je suis libre de mes mouvements, et aucun bourreau n'est visible.
Je tourne lentement la tête, malgré la douleur qui pulse à mes tempes. Je ne suis pas tout à fait dans une clairière. Si l'herbe rase fait bien une percée dans la forêt, une partie de mon horizon est constituée d'une falaise. Elle n'est pas très large, pas très haute, mais c'est bien une falaise, contre laquelle est adossé un bâtiment. Une porcherie, en réalité, avec un grand enclos devant, des auges pour l'eau et la nourriture, et quatre magnifiques cochons bien gras. Mais quel genre de geôles est-ce là ?
- Ne t'avise pas de raconter ce que tu verras ici. Et lève-toi, la nuit tombe.
Sa voix est tombée comme un couperet. Je lui obéis, du moins, j'essaie. Alors il m'attrape par le col et me redresse sans douceur. Et il reste à mes côtés, le temps que je me stabilise. Sans me lâcher, il m'entraîne à l'intérieur de la porcherie, où l'odeur est entêtante. Sur ma droite, un petit mur, d'un mètre cinquante environ, sépare le petit couloir et le plus gros de la pièce. De la paille, des auges, tout est prévu pour les animaux et c'est bien entretenu. Mais déjà il pousse une porte, au fond, qui s'ouvre sur une cuisine, me traînant à sa suite. Hébété, je découvre les lieux que j'ai déjà dû traverser deux fois, si mon intuition est juste. Un feu dans la cheminée, un billot de boucher contre le mur de la porcherie, une table et des chaises au centre, quelques meubles contre le mur du fond ornent la pièce.
Il ne s'y arrête que le temps de prendre la lanterne allumée, posée sur la table, et poursuit son chemin. Au fond de la cuisine, une arche irrégulière, creusée dans la falaise, laisse entrevoir un couloir sombre et d'autres pièces. C'est dans la première sur la droite qu'il me conduit. Un lit, une malle, un nécessaire de toilette la meublent. J'ai l'impression de sentir, sur mes épaules, tout le poids de la roche au-dessus de nous. L'homme en noir a aménagé une chambre dans une grotte. Il n'y en a pas qu'une, c'est un réseau de grotte, où il a installé des geôles privatives. Je frissonne des pieds à la tête et manque de défaillir. Sa voix dure n'apaise pas mes craintes lorsqu'il m'ordonne :
- Déshabille-toi complètement. Et ne touche à rien, je reviens.
Il me lâche soudainement et je manque de m'écrouler. Il s'éloigne d'un pas rapide après avoir laissé la lanterne et je me trouve là, au milieu de cette chambre, complètement désorienté. Mes chausses humides me collent désagréablement à la peau. Je sens mauvais, je m'en rends compte. Alors, avec mille précautions, grimaçant de douleur, j'ôte un à un mes vêtements, jusqu'à me retrouver parfaitement nu au milieu de la pièce. Je ne suis pas pudique, comment l'être quand on vit constamment en groupe, mais je ne suis pas très l'aise. J'aurais pu refuser, m'insurger contre ce traitement. J'aurais dû, sans doute. Mais je suis seul avec cet homme et Dieu seul sait de quoi il est capable si on ne lui obéit pas. Alors autant faire profil bas et ne pas le mécontenter pour si peu. D'autant que, bien que j'ignore quels sévices m'attendent, m'aurait-il réellement amené dans une chambre pour me torturer ?
Il revient avec un seau d'eau fumante et un linge propre, me faisant sursauter. Machinalement, je place ma main gauche devant mes attributs, mais il ne m'accorde pas un regard quand il dépose le récipient près de moi. Et sa voix sèche retentit encore :
- Lave-toi.
Au campement, personne ne donne d'ordre à personne. Nous suggérons, nos proposons, nous faisons. Nous savons ce qui doit être fait et nous nous entraidons toujours. Les seuls ordres auxquels j'ai eu à faire venaient tous de personnes extérieures à notre clan. Et je ne m'y suis jamais plié de bonne grâce.
Ce soir, ce n'est pas de meilleure grâce que j'obéis. Je redoute sa réaction, si jamais je refusais. J'ai peur qu'il me colle encore dans ce réduit sombre et silencieux, qu'il m'y oublie. Et je me sens sale. Alors j'utilise le savon, l'éponge et l'eau chaude pour me laver, faisant ainsi un inventaire de mes contusions, puis je me sèche soigneusement.
Il réapparaît soudain, alors que je n'avais même pas remarqué son absence. Il me tourne autour, lentement, scrute mon corps avant de me tendre un pot.
- C'est pour les bleus.
Je le prends, surpris par son attention. Je suis son prisonnier, mais il me permet de me laver, de me soigner. Je dévisse machinalement le couvercle et l'odeur d'arnica vient chatouiller mes narines. Mais sa main passe devant mon visage pour plonger les doigts dans l'onguent, puis il se glisse dans mon dos et étale le baume sur mon omoplate gauche. Je peine à me concentrer sur ma tâche, je sens son souffle sur ma peau nue et ça me trouble un peu trop.
Pire encore, ses doigts descendent jusqu'au bas de mes reins. La zone est douloureuse, c'est là qu'une des pierres m'a atteint, ce matin. Il agit avec douceur pour appliquer le baume mais sans que ses gestes ne prêtent à confusion : il m'aide juste à soigner des parties inaccessibles de mon corps. Et pourtant, mon sexe se redresse un peu, soudain intéressé.
La panique s'empare à nouveau de moi. Je suis fini s'il s'en rend compte. J'essaie de me calmer, de ne laisser libre cours ni à ma panique, ni à mon excitation.
Il s'affaire dans mon dos puis balance sur la malle quelques vêtements noirs. Il ne me jette pas un regard lorsqu'il s'éloigne de moi en disant :
- Je te laisse terminer avec le baume. Quand tu auras fini, mets ces habits propres et amène les autres à la cuisine. Et ne touche à rien ici.
Il me faut quelques minutes pour reprendre le contrôle de mes nerfs. Lorsque je termine d'appliquer l'onguent, en enduisant généreusement mon orteil qui vire au bleu sombre, mes doigts tremblent et je suis heureux qu'il ne soit plus là. Puis j'enfile ses vêtements. J'ai beaucoup de mal à passer l'épaule blessée, et je m'y prends avec énormément de délicatesse. Ils me vont parfaitement, à part que je dois retrousser un peu les extrémités des chausses et de la chemise.
Je me sens mieux. Physiquement, je me sens mieux : la douleur s'estompe un peu, à part l'épaule, et je me sens propre et au chaud. Mais je baigne toujours dans une étrange hébétude. Les événement s'enchaînent trop vite et je ne comprends plus bien où j'en suis.
A vrai dire, je ne comprends absolument pas ma situation, si ce n'est que je suis un mort en sursis.
Gardant mon bras droit contre le corps, je récupère ma bourse, lourde de cet étrange caillou et la passe à la ceinture, je ramasse mes oripeaux, la lanterne et le pot d'onguent. Puis je me rends dans la cuisine pour affronter mon geôlier. Deux écuelles en bois sont posées sur la table et l'homme en noir s'affaire près de la marmite. Je toussote poliment et il se retourne. Il m'observe quelques instants avant de désigner, du menton, une cuvette en bois. J'hésite un moment, avant de décider que c'est pour mes vêtements, et je les laisse tomber dedans. Sur le billot de boucher, je pose le pot d'onguent. Sur la table, je dépose la lanterne allumée, qui se joint la lumière des flammes de la cheminée pour éclairer la pièce. Et alors que je m'immobilise, indécis quant à la suite des évènements, il me dit :
- Assieds-toi, on va manger.
Cette fois encore, je lui obéis sans broncher. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre, de toute façon ? Je ne suis pas en position de jouer au fanfaron. Il me rejoint avec une marmite de potage, qu'il verse dans nos écuelles. Il coupe de larges tranches de pain et nous sert du vin coupé à l'eau. Puis il se met à manger. Je l'observe, ne sachant pas comment me comporter. J'ai faim et j'ai soif mais la situation est tellement surréaliste que je suis perdu.
- Tu n'as pas faim ?
- Si.
- Alors mange.
Je bois d'une traite mon verre, ce qui apaise un peu ma soif. Mais je n'arrive pas à manger. Alors, tenant maladroitement ma cuillère de la main gauche, je laisse échapper :
- Je suis en état d'arrestation.
- Je te l'ai déjà dit.
- Mais je ne suis pas dans les geôles du château.
- Non.
- Je suis chez vous.
- Oui.
Il s'interrompt à peine de manger pour me répondre du bout des lèvres. A ce rythme, je ne suis pas près de découvrir le fin mot de l'histoire. Alors j'insiste :
- Je ne suis pas entravé, ni même enfermé.
- Tu as failli mourir étouffé, tout à l'heure. Je n'ai pas envie d'avoir à m'occuper de ton cadavre. Quant aux entraves, je te surveille donc ce n'est pas nécessaire, surtout vu ton état. Mais si tu y tiens, je peux arranger ça.
Je nage dans l'incompréhension la plus totale. Il me sort de ce tombeau, me permet de me nettoyer, de porter ses vêtements, je dîne à sa table. Mais dans un même temps, sa voix glaciale, son manque évident de compassion, ses propos blessants me déstabilisent. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'en apprendre plus, alors je continue mon interrogatoire.
- Pourquoi je ne suis pas dans les geôles du château ?
- Pas assez de preuves pour ça.
Je suis sidéré. Sa réponse déclenche tant de nouvelles questions dans mon esprit que je ne sais pas par où commencer. Mon silence doit être révélateur, car il délaisse son potage pour me regarder et me dire :
- Les geôles du château, ça veut dire un registre à remplir, des informations à fournir.
Je cède à la tentation et commence à manger le potage, qui s'avère être savoureux. Je l'écoute pourtant attentivement mais je laisse le silence faire son office : il a l'air d'être plus causant quand on ne lui pose pas de questions. Et effectivement, il poursuit dans un bougonnement :
- Il leur faut des preuves. On ne peut pas engeôler quelqu'un comme ça.
- Vous n'avez aucune preuve contre moi, puisque je n'ai rien fait.
Il ne répond rien et j'enrage intérieurement. Je prends cependant son silence comme un aveu et je poursuis sur ma lancée :
- Vous m'avez arrêté de manière totalement arbitraire.
Je retiens à grand peine un sourire victorieux. Il reconnaît lui-même, enfin presque, qu'il n'a aucune preuve contre moi. L'espoir est encore permis. Je pourrais peut-être m'en tirer.
Encore du silence, jusqu'à ce qu'il lâche, du bout des lèvres :
- Il fallait une arrestation pour calmer les villageois.
La cuillère s'immobilise à mi-chemin de ma bouche et je le dévisage, pantois. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, cette déclaration sibylline ? Cette charogne termine tranquillement son écuelle alors que, sous mon crâne, espoir et cynisme se livrent une bataille impitoyable. Je décide de l'imiter, par défi, pour ne pas lui montrer à quel point je suis frustré par ses paroles. Lorsqu'il a fini son assiette, il repose sa cuillère, se lève et remplit deux bols d'un liquide fumant. Puis il les ramène sur table, avec une belle portion de fromage qu'il dépose entre nous. Et là, enfin, il déclare :
- Les villageois auraient fini par s'en prendre à vous. Le fait que ni la vache, ni la fille ne s'y trouvent n'est pas une preuve. Si vous êtes un peu malins, vous les avez laissées loin de votre campement, pour qu'on ne puisse pas vous accuser. Les villageois peinent à faire confiance à la justice, ils veulent qu'on retrouve ce qui a disparu immédiatement. Les belles paroles ne leur suffisent pas. Les esprits allaient s'échauffer jusqu'à ce qu'un drame arrive.
- Alors vous avez profité qu'ils me livrent à vous pour m'accuser.
- Ils ne t'ont pas exactement livré à moi. Je suis arrivé au moment où ils allaient te lyncher et je leur ai demandé ce qu'il se passait. Quand ils ont prétendu que tu étais le coupable, je leur ai dit que je t'arrêtais et que je t'emmenais en geôles.
- En geôles au château. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez ramené chez vous. Vous n'avez pas peur qu'ils découvrent la vérité ?
- Ils n'oseront pas aller au château. Ils vont attendre que le verdict tombe.
Je le dévisage longuement. Il est toujours aussi impassible, mais ses propos sont éloquents. Il coupe deux parts de fromage et poursuit lentement :
- Les villageois ont leur coupable, ce qui me laisse le temps de découvrir ce qu'il s'est passé et ..
- Vous ne me croyez pas coupable, alors ?
Il plonge son regard dans le mien et je réalise, pour la première fois, à quel point ses iris sont sombres. Il décrète d'une voix lente :
- Mes convictions personnelles n'ont aucune importance. Je vais découvrir ce qu'il s'est passé. S'il s'avère que tu es coupable, je t'aurais sous la main. Si ce n'est pas le cas, je te relâcherais.
- Et moi, alors, dans tout ça ? Je reste dans cette geôle qui s'apparente plus à une tombe, à devenir aveugle et à imaginer mille manières de mourir, le temps que vous arriviez à découvrir la vérité ?
Je ne l'aurais pas cru possible, mais son regard se fait encore plus dur quand il me fixe. Et sa voix est une lame glaciale quand il me répond :
- Toi, tu t'estimes heureux d'être encore en vie ce soir, parce que les villageois t'auraient volontiers achevé ce matin. Tu profites du répit que je vous accorde, à toi et aux tiens. Et tu finis ton repas en silence.
Sa réponse me cloue le bec. Par défi, je lui dirais bien ma façon de penser mais je devine que ce n'est pas le moment de le titiller davantage. Croquant ma part de fromage, je tente de réfléchir à ses propos malgré mon indignation. J'étais au sol, assommé par ma chute, une horde de villageois à mes trousses. Enfin, je ne sais pas combien ils étaient, mais qu'importe. Oui, je le crois quand il dit qu'ils m'auraient bien volontiers achevé. Gabor et Filippia au loin, je me retrouvais à leur merci, sans défense. Nul ne peut prédire ce qui aurait pu se passer, mais ils n'avaient pas d'intentions amicales, c'est certain.
Quant à mon répit... J'ignore ce qui m'attends pour la suite. Le temps que j'ai passé dans cette pièce obscure et silencieuse n'était certainement pas du répit. Définitivement pas. Mais la toilette et le repas sont les bienvenus. Alors si le reste de ma captivité se passe comme ça, oui, ça sera une sorte de répit. Même si j'ai l'impression d'abandonner les autres. Auront-ils réellement la paix, le temps que ces mystères soient résolus ?
Le liquide brûlant est en réalité une infusion à base de thym, de bourrache et de sauge. Je la sirote en silence, savourant la chaleur qui se diffuse en moi. Que se passera-t-il si la vache et la jeune fille ne sont jamais retrouvées ? Combien de temps pourrais-je rester en état d'arrestation, sans preuve, si l'enquête ne mène nulle part ?
Il termine son infusion, s'installe plus confortablement contre le dossier de sa chaise, croise les bras sur la poitrine et me dévisage. J'ai la terrible impression qu'il peut lire dans mes pensées et deviner toutes les questions qui m'assaillent. J'évite soigneusement de regarder la cicatrice qui le défigure et lui rend son regard. Puis, même si je n'ai pas tout à fait terminé mon repas, je lui demande :
- Est-ce que Voel sait où je suis ?
- Il sait que tu es arrêté pour l'enlèvement de Mélisende. Mais il ignore que tu es ici.
- Pourquoi ne lui avez-vous pas dit ?
- Pourquoi je lui aurais dit ?
Parce que c'est Voel. Je me rends compte que, si c'est une évidence pour moi, lui ne le connait pas. Il vit seul, apparemment, et il est autant vulnérable à une attaque de villageois qu'à une attaque de tsiganes. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de noter qu'il sait parfaitement qui est Voel. A quel moment se sont-ils présentés l'un à l'autre ? Voel a-t-il pu apprendre quoi que ce soit concernant cet homme ? Et pourquoi …
- Je suis allé voir Voel après t'avoir ramené ici. Je devais l'interroger concernant la disparation de Mélisende. Et j'en ai profité pour l'informer de ton arrestation.
- Est-ce que tu sais si Gabor et Filippia ont pu rejoindre le campement ?
Le tutoiement n'est pas une maladresse de ma part. Il me tutoie bien, lui, sans se gêner, alors je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire. Les informations qu'il m'envoie, par son comportement et ses paroles, sont tellement contradictoires que j'ai besoin de le tester, d'en savoir plus sur lui. S'il me hurle après et me jette à nouveau dans cette cave lugubre, je saurai qu'il n'apprécie pas le tutoiement. Et avec un peu de chance, je mourrai étouffé au lieu d'être torturé. Sinon, eh bien, ça sera toujours ça de pris, ça mettra de lier un début de semblant de complicité. Son visage ne montre rien de sa réaction et il répond, comme si de rien n'était :
- J'ignore de qui tu parles.
- Les deux personnes qui m'accompagnaient quand tu nous as surpris en train de nous balader dans la forêt.
- Vous balader, hein ? Tu veux dire « poser des collets sur un territoire de chasse interdit », plutôt, non ?
Je pince les lèvres. Ce n'est pas comme ça que je vais réussir à le convaincre de mon honnêteté. Mais il passe outre ce détail sémantique et reprend :
- Oui, j'ai vu le grand costaud au campement. Voel ne s'inquiétait que de ta disparition, de toute façon, donc je suppose que tu étais le seul disparu.
- Et comment a-t-il réagi quand tu lui as annoncé mon arrestation ?
- Il m'a regardé. Pendant longtemps. Puis il m'a remercié.
- Tu crois qu'il a compris que tu l'as fait pour nous protéger ?
- Je ne vous protège pas. Je cherche juste à éviter que la situation s'envenime encore plus.
Je fronce les sourcils, perplexe. Mais je me garde bien de poursuivre sur ce sujet, j'ai mille autres choses à apprendre. Il hésite un court instant avant de me dire :
- Mais oui, je crois qu'il a compris pourquoi j'avais agi de la sorte.
- Est-ce qu'il t'a donné un message à me transmettre ?
- Non.
J'opine lentement. C'est normal. Cet homme ne fait pas confiance à Voel, ce qui peut se comprendre. Mais la réciproque est vraie. Voel ignore son rôle exact, il n'allait pas lui confier quoique ce soit. Moi aussi, d'ailleurs, j'ignore qui est cet homme en face de moi. Je prends une grande lampée d'infusion avant de me lancer :
- Je m'appelle Yoshka.
- Je sais.
J'attends qu'il poursuive, en vain. Je n'ai pas vraiment le temps de peser le pour et le contre, ma langue se met en mouvement toute seule, ma bouche s'ouvre, et je rétorque :
- La réponse correcte, entre personnes civilisées, c'est de répondre par une autre présentation.
Pour la première fois, il détourne le regard. Il ne se fâche pas, ne m'envoie pas paître, mais il détourne le regard pour le fixer sur le rebord de la table. Je l'ai touché. Mais je n'arrive pas à m'en réjouir. J'essaie de trouver un moyen correct pour me rattraper quand j'entends :
- Louh, je m'appelle Louh.
J'incline doucement la tête, amusé par le ton soudain gêné de sa voix. Je mesure pleinement ma chance : il m'a laissé le rabrouer sans broncher. Je poursuis sur ma lancée :
- Je suis conteur.
- Je suis boucher.
Il a mis un peu de temps à répondre, mais il l'a fait. Je suis convaincu qu'il voit clair dans mon petit jeu de présentations, destiné surtout à apprendre plus de choses sur lui. Sa réponse, pourtant, me fait frissonner. Les porcs, dans l'enclos dehors, le billot de boucher creusé par des années de découpe, tendent à prouver sa sincérité. Mais un boucher ne mène pas une enquête, un boucher ne vole pas les gens en taverne, et un boucher ne traque pas les braconniers. Un boucher, par contre, s'occupe de la torture et des châtiments, quand il n'y a pas de bourreau à demeure.
Il accepte de répondre à mes questions qui n'en sont pas mais il élude celles qui m'importent vraiment. Je prends trop de risques, c'est évident, mais cette discussion apaise mes angoisses. Cet homme menaçant, boucher et peut-être bourreau, qui fait trembler tous les villageois, parle avec moi. Et je suis toujours vivant. Alors peut-être que j'arriverais à l'amadouer. Peut-être que s'il me connaît mieux, il comprendra que je ne peux pas être coupable. Jouant maladroitement avec ma cuillère, je poursuis :
- Je suis aussi marionnettiste.
- Je suis l'homme de main du Seigneur du fief.
Il a mis encore plus longtemps à me répondre. Et s'il est toujours adossé à sa chaise, l'air nonchalant, je vois bien qu'il est plus tendu. Et pourtant, ça ne m'avance pas beaucoup. Ce rôle, bien que j'en comprenne les grandes lignes, ne m'est pas familier. Il faut que j'en découvre plus à ce sujet. Mais si je commence à l'interroger de but en blanc, il risque de m'opposer un silence buté. Et je veux m'assurer qu'il ne cache pas un lapin dans son chapeau. Après avoir bu la dernière lampée de mon infusion, je termine :
- Et je suis également un peu menuisier à mes heures perdues.
Il ne répond rien. N'a-t-il donc pas d'autre corde à son arc ? Quoiqu'il en soit, j'ai déjà bien assez à réfléchir avec ce qu'il m'a dit. Je suis sur le point de lui demander plus de précisions sur ce qu'il appelle « homme de main » quand il lâche du bout des lèvres :
- Et je suis également un peu assassin à mes heures perdues.
Le sang se fige dans mes veines. J'ignore s'il y avait de l'ironie dans le fait de répéter presque mot pour mot ma phrase. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est parfaitement sérieux. Et du peu que je sais de lui, je ne doute pas de son affirmation.
Il se lève souplement en évitant de me regarder, disparaît par la porte de la porcherie. Je me suis fait avoir. Les attentions qu'il a eu pour moi ne valent pas grand-chose. J'avais espéré pouvoir l'amadouer, me le mettre dans la poche. Lui faire comprendre que je suis bien trop gentil pour enlever une fille. Mais il n'est pas homme qu'on peut amadouer.
Je dois fuir. Il me laisse suffisamment de libertés pour que je puisse m'échapper. Il le faut. Je ne peux pas rester à la merci d'un assassin. J'ai bien conscience des conséquences d'un tel geste, mais la panique revient à la charge. Il n'est pas simple geôlier qui se contente de garder des portes closes en attendant de toucher sa solde.
Je cherche du regard une issue. Deux minuscules fenêtres, presque au ras du plafond, apportent un peu de lumière quand il fait jour dehors. Mais elles sont trop étroites pour qu'un homme puisse s'y glisser, sans parler de mon épaule blessée. Seules l'arche dans la falaise et la porte de la porcherie se présentent à moi. Y a-t-il une autre issue, au fond du réseau de grottes ?
Parce que foncer à travers la porcherie, avec lui dedans, serait une folie. Mais je peux toujours attendre qu'il vaque à ses occupations pour prendre la poudre d'escampette.
Tant pis pour la susceptibilité des villageois. Je ne peux pas rester seul, enfermé avec un assassin, alors que personne n'est au courant de ma présence ici.
Je suis au milieu de nulle part, sans aucune idée de l'emplacement de cette clairière par rapport au village. Mais je l'ai dit, je ne suis pas héros, je ne ferais pas face à Louh juste pour apaiser les tensions.
J'ignore si c'est possible mais je dois endormir sa méfiance. Je lui dois présenter le visage d'un homme inoffensif, prêt à l'aider dans son enquête. Lorsqu'il revient de la porcherie, je suis en train de débarrasser la table. Je gémis de temps en temps et ce n'est pas tout à fait de la comédie : mon épaule me fait mal. Comme je ne sais pas où il s'occupe de la vaisselle, j'ai tout posé sur le billot. Et forcément, il le remarque :
- La vaisselle sale ne va pas là.
Bon sang, il est encore plus froid et distant que tout à l'heure. Je me recule contre la table tandis qu'il déplace écuelles et couverts. Je gémis un peu plus fort. Il hausse un sourcil en me dévisageant.
- Tu ne peux pas bouger ton bras ?
- Non. C'est mon épaule.
- Et les doigts ?
Je remue un peu les doigts, difficilement mais sans que ce soit si douloureux que ça. Pourtant, je laisse échapper une plainte qui se veut déchirante. Il claque la langue contre le palais et assène :
- N'en rajoute pas.
Je reste silencieux. Ça ne va pas être facile. Il délaisse la vaisselle non loin de la cheminée et se dirige vers la chambre en disant :
- On va dormir maintenant. Viens.
Je réprime de toutes mes forces l'envie de regarder vers la porte de la porcherie. C'est trop tôt pour fuir, il ne me fait pas assez confiance. Et dehors, il fait nuit. Je ne suis pas déjà certain d'être capable de fuir dans la forêt en plein jour, alors en pleine nuit …
Je lui suis donc sans rechigner. Il a récupéré la lanterne et nous passons devant plusieurs grottes, comme je l'avais deviné : ici une réserve pour la nourriture, là-bas une réserve pour le bois, au fond, un doux bruissement me fait penser à la présence d'un point d'eau.
Il s'arrête devant une porte en bois, qu'il ouvre en me regardant. Un seul coup d'œil à l'intérieur me fait comprendre qu'il s'agit de la pièce où j'étais enfermé plus tôt. Je m'immobilise et les mots jaillissent spontanément de ma bouche :
- C'est vraiment obligé ?
- Oui.
- Cette pièce me met vraiment mal à l'aise. C'est tellement sombre et …
- Tu es en état d'arrestation, ne l'oublie pas. A moins que tu ne préfères que je te ficèle comme un saucisson et que tu dormes dans l'enclos des cochons.
- Je préfèrerais.
Je n'ai pas réfléchi à ma réponse, elle est sortie toute seule. Dans le silence qui suit, je réalise que je suis sincère : je préfèrerais encore dormir avec les cochons, ligoté, au risque de me faire dévorer, plutôt que de passer une nuit entière dans cette tombe. Il me dévisage. La flamme vacillante de la lanterne fait naître des reflets dans ses cheveux bruns mi-longs et dans ses iris si sombres. Sa cicatrice semble encore plus visible ainsi. Il reste immobile et silencieux, sans doute le temps de réfléchir. Ou de tester ma détermination.
- Très bien. Va chercher la paillasse, que tu puisses dormir dessus.
- Non. Tu vas en profiter pour m'enfermer à l'intérieur.
Je tente de masquer l'horreur que m'inspire cette idée. Je sais qu'il en serait capable. Et je ne veux pas revivre l'enfermement dans cette pièce. Je suis conscient, pourtant, des risques que je prends en m'opposant si franchement à lui. Et je n'ignore pas qu'il lui suffirait d'user de la force pour me contraindre à passer la nuit là-bas dedans. Je suis prêt à en assumer les conséquences. Si je n'ai qu'une infime chance de le voir accéder à ma requête, je dois tenter, quitte à ce qu'il s'énerve et fasse usage de violence. Mais il hausse les épaules sans piper mot, referme la porte puis regagne la cuisine. Je le suis à petits pas rapides, le cœur battant la chamade.
Je reste immobile, sous l'arche, tandis qu'il fouille dans son billot. Cette charogne va réellement me ligoter et me faire dormir avec les cochons. La peste soit cet homme.
Il extirpe une immense chaîne qui cliquète à n'en plus finir lorsqu'il la dépose sur la table de la cuisine. Il prend son temps, s'attendant sûrement à ce que je change d'avis et que je le supplie de le m'emmener dans cette geôle lugubre. Il peut toujours attendre.
Il dépose des cadenas sur la table, et une unique clef, ainsi qu'une longue barre en métal et deux anneaux. Je le regarde faire, comme un lapin piégé par un rapace et qui reste pétrifié. Il me fait m'approcher et j'obéis sans broncher. Il ramène mon poignet gauche juste au-dessus du droit, passe autour les anneaux en forme de U, puis fait coulisser la longue barre de métal dans les encoches prévues aux extrémités des anneaux. Il place un cadenas au bout de la barre en métal, le tout sans un mot. Je ne dis rien, moi non plus, j'en suis incapable. Mais j'ai conscience de ses précautions : il n'a pas touché à mon poignet droit, il sait que tout mon bras est douloureux. Et la barre métallique est à la verticale, alors que je l'ai toujours vue à l'horizontale. Je peux garder mon bras droit contre le corps, grâce à cette disposition. Et malgré ma situation pour le moins délicate, malgré les entraves qui me privent de ma liberté de mouvement, je me sens stupidement reconnaissant. C'est idiot, pourtant : je suis à la merci de cet assassin, vulnérable. Je n'aurais sans doute guère plus de chances si j'étais libre de mes mouvements, mais le poids de ces menottes me glace les sangs et me fait pleinement réaliser ma situation. Je dois le fuir. Je dois m'éloigner de lui avant qu'il ne finisse de poser ces entraves. Tant pis pour la nuit noire, tant pis si je reste à errer dans la forêt pendant des jours. Je dois fuir. Mais alors que mon regard se tourne vers la porte de la porcherie, il déclare de sa voix glaciale :
- Ne fais rien de stupide.
Il n'a pas besoin de rajouter une menace, je l'entends dans sa voix, je la lis dans sa posture. Il me toise un moment et je me retrouve à acquiescer vivement. Il laisse tomber la longueur de la chaîne sur les dalles irrégulières du sol. Puis il s'agenouille, entoure ma cheville gauche avec l'extrémité de la chaîne, place un cadenas dans les maillons, puis répète l'opération pour la cheville droite. Il s'écarte de moi, la chaine à la main, et va glisser l'autre extrémité dans un anneau scellé dans le sol, non loin de la cheminée.
Il quitte soudain la pièce sans un mot pour moi, lanterne à la main, me laissant seul avec la lumière vacillante du feu dans la cheminée pour toute compagnie. Il revient, quelques minutes plus tard, en traînant la paillasse derrière lui. Il la laisse tomber à mes côtés, toujours silencieux, rajoute une bûche dans la cheminée, et disparaît dans la chambre avec la lanterne.
Je reste immobile un long moment, me demandant s'il va revenir ou non. Mais le temps passe et il ne revient pas. Alors, tout doucement, je m'installe comme je peux sur la paillasse. Je n'ai pas beaucoup de liberté de mouvement mais c'est toujours mieux que cette pièce sordide. J'ai de la lumière. J'entends les cochons qui remuent, un peu, dans leur paille, de l'autre côté du mur. Les yeux rivés au plafond en bois, regardant les mouvements dansants de la lumière des flammes, je m'interroge. Sur mon avenir, sur les miens restés au campement. Et sur cet homme en noir qui ne cesse de me surprendre.