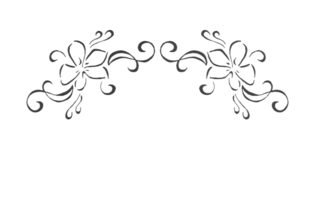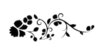Auteur : histoiresyaoi
Date de création : 31-05-2013
Âprefond, chapitre 8
Voici donc un nouveau chapitre, où nos deux compères apprennent encore à se connaître. En suggestion de musique, je vous propose deux titres (à force de faire des exceptions, il n'y aura plus de norme) de Bareh Droma : The Little Hut et Opai Dad.
Je vous souhaite une excellente lecture à tous et à toutes !
Je décide de passer outre les sentiments qui surgissent en moi face à cette réponse. S'il n'a pas de questions, moi, j'en ai encore beaucoup. Alors, tout en me massant la cheville, je lui demande :
- Pourquoi tu as cherché la vache avant Mélisende ?
- Je cherchais les deux en même temps. Après tout, si on peut cacher une vache quelque part, on peut tout autant y cacher une jeune fille.
- Tu penses qu'elle aussi, elle a été enlevée pour nous accuser ?
- Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il s'agit d'une coïncidence. Ou peut-être qu'elle est retenue quelque part dans votre campement.
- Non. Nous n'avons vu personne le soir de sa disparition. Nous sommes restés tous ensemble autour du feu, personne ne s'est éloigné. Je me demande d'ailleurs pourquoi tu ne m'as pas posé la question plus tôt. Je veux dire, quand tu enquêtes, comme ça, tu interroges bien les gens, non ?
- Est-ce que tu cherches à m'apprendre mon travail ?
Sa colère, qui semblait s'être apaisée, ressurgit soudain et j'opère un repli prudent, un sourire doux sur le visage :
- Mais non, voyons, pas du tout. Je suis juste curieux, c'est tout. Peut-être un peu trop.
Je hausse les épaules avant de grimacer de douleur, puis je lui lance un regard désolé, ponctué d'un sourire contrit. Il m'observe encore quelques instants avant de secouer doucement la tête et de me répondre, plus serein :
- Oui, tu es trop curieux. Mais je suppose que je vais devoir faire avec. Et oui, j'interroge des gens pour mes enquêtes. J'ai déjà questionné Voel à ce sujet, je te l'ai dit. Mais de toute façon je savais que vous n'aviez vu personne, et que personne n'avait quitté le camp.
- Tu nous observais encore ?
Cette fois non plus, il ne répond pas, et je considère son silence comme un aveu. Il était présent les deux premiers soirs, pourquoi pas le troisième ? J'en viens donc à la question qui coule de source :
- Pourquoi tu nous surveillais ?
C'est à croire que, soudain, quelques brins d'herbe flottant dans de l'eau sont bien plus intéressants que moi, car il fait mine de ne pas m'avoir entendu. Le silence perdure, uniquement brisé par le crépitement de la cheminée et les clapotis de l'infusion dans la marmite. Enhardi par les réactions plutôt positives qu'il a eu dans la journée, oubliant un peu vite que sa colère est encore toute proche, je laisse échapper :
- Ce n'est pas très poli, de ne pas répondre. Si tu ne veux pas parler, tu pourrais au moins me le dire.
Là encore, je m'attendais à de la colère ou des cris, mais certainement pas au « pardon » qu'il murmure quand il revient s'asseoir avec l'infusion. Il s'éclaircit la gorge et me répond d'une voix claire et audible :
- Non, je ne vous surveillais pas.
- Ah. C'est une bonne nouvelle, alors, parce que nous ne sommes pas une menace pour ton Sieur, ni pour les habitants de ce fief. Nous ne faisons qu'apporter un peu de joie et de dépaysement. Et puis, tu sais, c'est ça, aussi, apprendre à connaître les gens. On apprend à ne pas s'arrêter aux préjugés.
- Je sais, oui.
- Alors pourquoi tu nous observais ?
Il fait tourner le bol entre ses longs doigts et le silence dure si longtemps que je crains qu'il ne me réponde pas. Mais finalement, il laisse échapper du bout des lèvres :
- Parce que j'aime bien vous écouter.
- Tu... Tu aimes bien nous écouter ?
- Et pourquoi pas ?
Il délaisse l'observation intense de son bol et c'est du défi qui brûle dans son regard, désormais. Je lui souris de toutes mes dents, heureux de cette réponse inespérée et réponds prudemment :
- Un admirateur secret ! Voilà une bonne surprise !
À cet instant précis, lui avouer qu'il n'a pas spécialement le profil type de notre public habituel m'apparaît déplacé. Et ce n'est pas son défi à peine voilé qui me retient, mais l'intuition que cet aveu lui coûte beaucoup. Il hausse les épaules, reste silencieux quelques instants avant de s'expliquer :
- J'ai toujours aimé vos chants et vos musiques.
Mon silence stupéfait doit le mettre mal à l'aise, car il reprend, comme pour combler le vide de la conversation, d'un ton moins assuré :
- Il y a de la joie... et de l'espoir... et aussi un peu de nostalgie. On dirait que la vie est une fête permanente pour vous, que vous savez composer avec le quotidien et en tirer tout ce qui est beau. Et … j'aime beaucoup les histoires qui racontent des vies différentes et des paysages lointains.
Il s'est redressé sur la chaise, les yeux brillants. C'est à mon tour de rester silencieux : je prenais sa présence pour une menace, il n'était là que pour profiter du spectacle, comme tant d'autres. Je ne sais plus très bien qu'en penser, et me retrouve à lui dire :
- Tu aurais dû venir avec nous, au lieu de rester cacher ! Tout le monde est le bienvenu.
- Je n'en suis pas si sûr.
- Nous t'aurions accueilli les bras ouverts !
- Vraiment ? Vu les regards que tu me lançais, tu n'avais pas l'air ravi de me voir. Je vous aurais rendus nerveux. Et les villageois auraient été pétrifiés.
- Ça aurait été l'occasion de modifier le regard qu'ils portent sur toi.
Il laisse échapper un « tss » entre les dents, et je comprends que je viens de dire une bêtise. Quelques secondes de réflexion me suffisent pour réaliser que rendre les gens nerveux est sa spécialité, et qu'il l'entretient sciemment. Il s'éclaircit encore la voix, et se souvenant sans doute de ma douce remontrance, poursuit :
- Ce ne serait pas la meilleure chose à faire. Et de toute façon, mon sieur n'aime pas beaucoup les tsiganes.
- Et alors ? Quel rapport ?
Il me jette le même regard que Ysayo me jette parfois : à la fois patient et agacé de devoir expliquer l'évidence. Il prend une longue gorgée d'infusion et je l'imite. Puis, dans le silence dans la cuisine, il m'explique l'évidence :
- Mon sieur n'aime pas les tsiganes. Il vous tolère parfois, mais exige des nouvelles du royaume et des chansons classiques. Si je montre, moi, que j'aime vos musiques nouvelles, je désavoue mon sieur, je donne l'impression que je suis en désaccord avec lui. Il n'a, bien évidemment, pas besoin de mon accord pour prendre ses décisions, mais je dois montrer que je suis ses ordres sans contester. Tu comprends ?
Je hoche doucement la tête. Son monde est très éloigné du mien, mais je comprends ce qu'il essaie de me dire. Son rôle est de faire appliquer les décisions de son Seigneur, quelles qu'elles soient. Et s'il montre, un seul instant, qu'il pense différemment, alors il perd toute crédibilité. Il hausse les épaules et se lève pour débarrasser la table, déclarant à sa manière que le temps des confessions est terminé. Je l'imite puis, gêné, je lui annonce :
- Il faut que j'aille … euh... dehors.
Il hausse un sourcil puis, après avoir jeté un coup d'œil dans le sceau d'aisance vide qu'il avait amené et face à ma mine penaude, il comprend. Il me regarde encore quelques secondes puis déclare :
- Pas dehors, non. Viens, suis-moi.
Je ne suis pas spécialement rassuré mais je lui obéis. Il m'a montré à plusieurs reprises qu'il avait de bonnes intentions à mon encontre et, peu à peu, je commence à lui faire confiance. Presque. Armé de sa lanterne, il s'aventure sous la falaise, jusqu'à une petite grotte aménagée. L'odeur de terre humide me prend à la gorge mais je m'y habitue vite, surtout que le spectacle me déconcentre. Une petite cascade s'échappe du cœur de la roche pour remplir une vasque creusée par des années de ruissellement. Puis l'eau se répand contre la paroi, jusqu'au sol, où elle poursuit sa course dans une petite rigole. Elle disparaît ensuite sous une boite en bois, avant de s'engager dans le ventre de la terre. La boîte en bois, dont le haut est percé d'un couvercle, s'avère être des latrines.
Louh accroche la lanterne à un crochet au plafond, tandis que j'admire les lieux. Ce ne sont que des latrines, certes, mais l'écoulement de l'eau est une douce mélodie, nimbée de cette lumière vacillante. Et l'installation est une véritable richesse : de l'eau courante à volonté, pure, et des latrines dans l'enceinte même de l'habitation ! Après avoir respecté mon silence, Louh déclare :
- Je te laisse te rafraîchir et faire ce que tu as à faire. Je t'attendrai dans la cuisine.
- Merci.
J'ai vraiment du mal avec une seule main, et je prends mon temps pour me rafraîchir, j'ai l'impression que ça m'éclaircit un peu les idées. Quand j'en ai terminé dans cette pièce, je récupère la lanterne qu'il m'avait laissé et le rejoins dans la cuisine.
La vaisselle est faite et sur la table m'attend le pot d'onguent de Filippia. Il termine de récurer la marmite de soupe puis se tourne vers moi en disant :
- Je vais défaire ton bandage pour y mettre de l'onguent, comme Filippia l'a demandé.
Je hoche doucement la tête et m'approche timidement de lui. J'espère de tout mon cœur que la proximité avec lui n'aura pas les mêmes effets qu'hier. Il ne doit pas voir qu'il me trouble. Surtout pas. Je défais mon pourpoint, la lanière de la chemise, les doigts tremblants, fuyant son regard que je devine posé sur moi. Je retire difficilement les vêtements et il ne fait pas un geste pour m'aider.
Je reste torse nu face à lui, les yeux rivés au sol. Un ange passe. Puis il m'annonce dans un chuchotement qui me fait frissonner :
- Je vais défaire le bandage, dis-moi si je te fais mal.
- D'accord.
L'émotion rend mon murmure à peine audible, mais il est déjà proche de moi et je ne doute pas qu'il l'ait entendu. Avec des gestes précis et doux, il enlève le tissu qui retient mon bras prisonnier. Lentement, je fais jouer les articulations de mes doigts et je retiens un soupir de soulagement quand je constate que c'est beaucoup moins douloureux que ce matin.
Mais ces considérations futiles disparaissent vite. Toute mon attention est focalisée sur la présence de Louh dans mon dos. Je peux sentir son souffle balayer ma peau. Quand ses doigts se posent sur mon épaule, je ne peux retenir un long frisson, qu'il ne rate pas. Lorsqu'il me demande s'il me fait mal, je me retrouve incapable de lui répondre et dois me contenter d'un signe de la tête cliquetant pour le rassurer. Mon ventre m'élance à nouveau étrangement tandis qu'il étale le baume sur ma peau. Et j'ai beau essayer de penser à tout autre chose, je n'arrive pas à oublier qu'il est si proche de moi que je peux percevoir sa chaleur corporelle. Et à mon plus grand désespoir, ça ne me laisse pas indifférent.
Je frissonne à nouveau. Il ne doit pas s'apercevoir de mon trouble. Surtout pas. S'il remarque la bosse qui déforme mes chausses, il comprendra tout de suite à qui il a affaire. En tant qu'homme de main, il ne pourrait pas éviter de le signaler. Et ce Seigneur inconnu, qui n'aime déjà pas beaucoup les tsiganes, se fera un plaisir de châtier un tsigane qui a l'outrecuidance de cumuler les tares et d'ajouter la bougrerie à la liste de ses crimes.
Ma gorge se noue mais mon ventre continue de m'élancer. J'ai beau songer à ma mort prochaine, je n'arrive pas à me défaire de cette excitation. Et je ne vois nulle échappatoire : si j'esquive les soins, il voudra savoir pourquoi, et il ne tardera pas à en voir la raison. Si je n'esquive pas, si je dois sentir encore ses doigts contre ma peau, je ne réponds plus de rien. Mes joues chauffent terriblement, irradiant ma gorge et ma nuque que je devine rouge brique. Je sens mes doigts se mettre à trembler et je serre les poings pour les cacher.
C'est à ce moment là qu'il s'écarte de moi pour aller chercher la bande qu'il avait posée sur la table. Son éloignement me soulage le temps que je réalise qu'il me verra de face et qu'il ne manquera pas de voir cette fameuse bosse. Je voudrais me frapper, de toutes mes forces, pour la faire disparaître. Je me contente de baisser la main gauche, naturellement je l'espère, pour qu'elle repose sur mon bas-ventre. Il me fait face, glisse ses doigts le long de ma peau pour enrouler la bande. Je dois relever le bras et je déglutis. Mes yeux restent fixés sur un point au sol. Je me demande soudain s'il peut ressentir les battements affolés de mon cœur quand ses mains passent sur mon torse. Il reste impassible, poursuit sa tâche, concentré. Je voudrais que ce soit déjà terminé et je voudrais que ça dure encore pour toujours.
Une fois la bande nouée, il m'ébouriffe les cheveux en me disant :
- Voilà, c'était pas si terrible, si ?
Je suis incapable de répondre. Je sens mes jambes vaciller et je vais prendre appui sur la table pour garder l'équilibre. Cette fois encore, je me contente de secouer doucement la tête en signe de dénégation.
- Je l'ai refait à l'identique, j'espère que ça ira.
- Merci.
Ma voix me paraît ridiculement frêle. Il ne relève pas. Il va se rincer les mains dans l'eau de la vaisselle avant de m'annoncer :
- Je vais aller me coucher. Tu dormiras ici ce soir. Je te remets la chaîne, par contre.
J'acquiesce d'un mouvement de tête, pétrifié. Je le laisse faire, immobile puis je me retrouve seul dans la pièce. D'un pas mal assuré, je vais m'allonger et me blottis sous la couverture. La lumière vacillante du feu dans l'âtre ne m'est d'aucun secours.
Je me déteste. À cet instant précis, je déteste cette partie de mon anatomie qui n'en fait qu'à sa guise, me mettant en danger. Je suis comme je suis, j'accepte cette fatalité qui m'a faite différent. Mais cette attirance, là, que je ressens pour lui, se fait au mépris de tout bon sens. Je risque ma vie avec l'enlèvement de Mélisende. Je ne dois pas en rajouter en m'excitant comme un puceau juste parce qu'il me frôle.
Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas eu l'occasion de partager un moment intime avec un homme. C'est tellement risqué que je me hasarde rarement à faire des avances à ceux qui me plaisent. Les rapports sont rapides, discrets. Silencieux, la plupart du temps. Rarement avec un homme qui m'attire : je m'estime déjà heureux de trouver un de mes semblables, je ne vais pas faire la fine bouche.
Quand la tension devient insupportable, je me soulage seul. Mais avec Gabor qui partage la roulotte, c'est compliqué de trouver le moment approprié. Je n'osais pas le fait pendant son sommeil, par gêne. Maintenant que je sais que ça le met mal à l'aise, je m'y risquerais encore moins.
J'essaie de me convaincre que c'est normal que mon corps réagisse après tant d'abstinence. J'essaie de me dire qu'un homme qui se ferait soigner par une femme séduisante réagirait pareil. Mais cet homme risquerait au pire une gifle, pas la torture ou la mort.
Mon corps me trahit. Même encore maintenant, allongé sur cette paillasse à l'odeur de terre humide, une chaîne à la cheville, je sens mon désir qui pulse entre mes jambes. Je ne peux l'assouvir, de peur d'être découvert. Mon corps me trahit et mon esprit est perdu. Je ne sais plus quoi penser de Louh. Il était une menace, au début. Une silhouette noire que nous devions éviter à tout prix. Maintenant que je suis coincé avec lui, maintenant que j'apprends à le connaître, je perçois sous son apparence hostile bien plus de nuances. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de voir ce qui se cache sous ce masque. Et j'ai terriblement envie de le voir sourire.
Mais s'il doit me soigner encore, si nous apprenons à nous connaître plus, il finira fatalement par découvrir cette partie de moi. Je suis surpris que ce ne soit pas encore le cas, d'ailleurs. Comment a-t-il pu manquer mon émoi ? L'a-t-il seulement manqué ? S'il s'en est rendu compte, il ne dira peut-être rien. Du moins jusqu'à ce qu'il m'envoie dans les geôles du château, avec de sérieux argument pour remplir le registre cette fois.
Mais est-ce qu'il m'aurait ébouriffé les cheveux en faisant cliqueter les perles, s'il avait deviné ? Ou est-ce que ça pourrait signifier qu'il est courant mais que ça ne le dérange pas ?
Les doutes et les questionnements sans réponse finissent par m'assommer et je plonge dans un sommeil sans rêve.
Ce sont des mouvements dans la pièce qui me réveillent. J'ai dormi recroquevillé contre le mur, blotti sous la couverture. J'ai la tête lourde et la bouche pâteuse mais mon épaule me fait moins mal. Je remue un peu, me redresse en me frottant les yeux. Louh s'approche de moi sans un mot et me délivre de ma chaîne. Puis, de toute sa hauteur, les bras croisés sur la poitrine, il déclare :
- Je croyais que tu n'avais presque rien touché, hier.
Je le dévisage, incrédule, encore ensuqué par le sommeil, et je ne comprends pas un mot de ce qu'il me dit. D'un geste du menton, il me désigne la petite fenêtre. Le soleil est déjà levé depuis peu et de la lumière filtre à travers la peau tendue. Bon sang, je n'y suis pour rien, dans le lever du soleil. Puis je regarde l'autre fenêtre et je comprends. La différence de luminosité est importante et ce n'est pas dû à leurs expositions respectives. Je me lève difficilement et je lui fais face. Et je marmonne :
- C'était presque rien.
Il hausse un sourcil et secoue doucement la tête, ses cheveux dansant autour de son visage sévère. Pourtant, je suis presque sûr de lire de l'amusement dans son regard. Il n'insiste pas et me fait signe de m'asseoir.
Le bouillon est avalé sans que nous ayons prononcé un seul mot. Il m'autorise ensuite à me rendre aux latrines, et il me suit dans les entrailles de la falaise, sauf qu'il bifurque avant moi. Lorsqu'en j'en ai terminé, je le retrouve dans la cuisine : il a déposé sur la table un panier bien rempli. Curieux, je m'approche et découvre tout un assortiment de légumes : poireaux, raves, panais, épeautre et fèves. Il laisse le panier sur la table et va décrocher la poitrine fumée qui pend au-dessus de la cheminée. Je l'observe découper de fines tranches de lard avec fascination, impressionné par sa dextérité avec un couteau, oubliant presque que cette même dextérité peut servir à mutiler ou à tuer un homme. Lorsqu'il en a terminé, il dépose ensuite, près du panier, un petit couteau et la marmite, y jette le lard, et m'annonce :
- Je vais aller faire un tour dans les hameaux, tu ne peux pas m'accompagner. Ton travail de ce matin sera de faire la soupe pour déjeuner. Tu vas t'en sortir ?
J'acquiesce avec enthousiasme et il semble satisfait. Je suis beaucoup moins confiant qu'en apparence, mais si je lui dis la vérité, je vais me retrouver à m'ennuyer toute la matinée. Il hésite un instant avant de rajouter :
- Tu laisseras les épluchures dans la bassine, on les donnera aux cochons tout à l'heure. Pour l'eau, prends celle du tonneau, j'en ai apporté de la fraîche tout à l'heure. Des questions ?
Environ mille mais je me garde bien de lui dire. Il m'annonce qu'il rentrera donc à midi, puis passe à nouveau la chaîne autour de ma cheville. Puis il s'en va et je l'entends encore s'occuper de faire sortir les porcs dans l'enclos avant que le silence retombe dans le repaire. Je m'assois lourdement sur la chaise. Bon sang.
Le travail des enfants au campement est assez rudimentaire et il consiste souvent à aider Djidjo à préparer le repas. Laver et éplucher les légumes, trier les lentilles, casser les noix sans trop en manger. Je l'ai fait, gamin, et j'y prenais beaucoup de plaisir parce que nous travaillions à plusieurs. Mais une fois les légumes prêts, Djidjo s'occupe toujours du reste. Comme par miracle, ces bouts de tubercules deviennent d'excellents potages dans nos écuelles.
J'observe les légumes, perplexe : je vais devoir m'occuper de cette phase miraculeuse et je ne sais pas comment je vais m'y prendre.
Je tergiverse un long moment avant de me décider à commencer par le commencement. Je nettoie soigneusement les légumes dans un peu d'eau que je laisse au fond de la cuvette qui m'a servi pour le linge hier.
Un nouveau problème se pose quand il faut éplucher les légumes : avec une seule main, je suis censé m'y prendre comment ? Après plusieurs essais infructueux, le légume calé sur la table et ma main gauche s'attaquant à la peau, j'avoue mon échec.
Je fais bouger mes doigts sous la chemise et je constate avec plaisir que ce n'est pas trop douloureux. Je retrousse donc le tissu jusqu'en haut de mon ventre et frissonne quand l'air frais vient caresser mon nombril. Ça devrait fonctionner.
La cuvette posée sur mes genoux, le couteau dans la dextre et ma victime dans la main gauche, je m'attelle à la tâche. Je fredonne doucement, l'une de ces chansons que nous chantons tout le temps au campement, et ça me permet de me détendre. C'est long et laborieux, cet épluchage, mais je parviens, après de longues minutes de bataille, à un résultat correct.
Et dire que c'était la partie la plus facile. Bien. Louh a parlé d'eau. Était-ce pour nettoyer les légumes, ou est-ce que je suis censé en mettre dans la marmite ?
J'hésite un long moment, avant de me décider à en mettre juste un peu. S'il n'en fallait pas, il ne le remarquera peut-être pas. S'il en fallait, eh bien, il y en aura.
Heureux d'avoir trouvé ce compromis, je m'exécute, avant de jeter pêle-mêle les poireaux, les raves, les panais, les fèves et l'épeautre. Les deux poireaux dépassent du rebord de la marmite et je me demande soudain si je n'aurais pas dû les couper. Bon sang, est-ce que Djidjo coupe les légumes avant de les faire chauffer ? Je voudrais tant aller lui demander conseil, qu'elle me dévoile l'inestimable secret de son miracle...
Je ne l'ai jamais vu couper les légumes. Certes, dès que nous étions libérés de notre corvée, nous nous dispersions comme des moineaux, sans chercher à savoir ce qu'elle faisait ensuite. Mais couper des légumes ?
Je décide que ça restera tel quel et de laisser la magie opérer. Dans un cliquetis de chaînes, je vais donc suspendre la marmite sur le feu que Louh a ravivé avant mon réveil. Je remets ma chemise en place, savourant la douce chaleur sur mon ventre. Je nettoie ensuite la table, le couteau, range ma paillasse et plie la couverture. Puis je tourne en rond un moment en comptant les minutes.
Mon cistre, soigneusement posé contre le mur, me fait soudain de l'œil. Si j'ai pu éplucher des légumes, est-ce que je pourrais faire courir mes doigts sur les cordes ? Cette fois, je n'hésite pas longtemps avant de m'emparer de mon instrument et de m'installer à la table. Je retrousse ma chemise sans sourciller et cale mon cistre contre moi.
Un sourire victorieux éclaire mon visage lorsque je constate que c'est légèrement douloureux, mais pas insupportable. Juste quelques notes. Je ne dois pas forcer, mais quelques notes ne peuvent pas faire de mal, si ?
Je ne suis pas un grand musicien. Je connais les notes, je sais reproduire une mélodie, mais je n'arrive pas à donner vie à la musique. Tout comme Gabor sait raconter ses péripéties, sans pour autant réussir à captiver un auditoire comme un conteur peut le faire.
La musique est un support pour mes histoires. C'est avec elle que j'ai grandi et elle est aussi rassurante qu'une mère pour moi. Alors, lorsque les premières notes s'élèvent dans la cuisine et envahissent l'espace, je me sens à nouveau vivant.
Je me contente de reprendre deux mélodies que j'aime tout particulièrement avant de reposer mon cistre. Je ne dois pas insister et je sens déjà mon épaule protester. Je me lève donc, traînant derrière moi la chaîne, et je vais jeter un regard à la mixture que j'ai préparée.
Les légumes n'ont pas encore fondu et on distingue parfaitement les formes de chacun. Je me demande combien de temps ça peut prendre, cette histoire. Il n'y a presque plus d'eau et j'en suis soulagé : s'il n'en fallait pas, Louh ne saura jamais qu'il y en a eu.
Je n'ai aucune idée de l'heure. Le temps me semble bien long, mais il ne faudrait pas Louh rentre maintenant, avec les légumes qui commencent tout juste à fondre. Je tire la chaise jusqu'à la fenêtre, l'ouvre en grand. Le vent s'engouffre et me fait frissonner. J'ai beau me tordre dans tous les sens, je n'arrive pas à voir la position du soleil. Je vois juste de lourds nuages blancs, bedonnant, qui s'avancent paresseusement dans le ciel. Mais je reste quand même perché sur la chaise, à savourer la caresse du vent et à observer un couple de merles qui transporte des brindilles pour le nid. Je me demande ce qui les anime. Le besoin de reproduction, bien sûr, celui d'avoir un endroit sûr et douillet pour leurs œufs si précieux. Mais peuvent-ils seulement planifier l'avenir, comme de jeunes mariés planifient l'arrivée de leur premier enfant ? Ont-il la possibilité de voir à long terme ce qui les attend ? Est-ce vraiment Dieu qui a voulu que tous les êtres vivants aient ce même instinct de reproduction, de sécurité, qu'ils soient doués de raison ou non ? Et moi alors, suis-je condamné à être malheureux, car incapable de procréer ?
Je secoue doucement la tête, un léger sourire sur les lèvres. Ysayo marmonne souvent que je réfléchis trop et que je pose des questions impossibles. J'ai l'impression de l'entendre, en ce moment même, l'esprit perdu dans d'étranges suppositions alors que je devrais être en train de réaliser un miracle. Finalement, je me secoue et me sors de ma contemplation rêveuse.
Lorsque je redescends, la marmite laisse échapper des veloutes de fumée. Je m'approche, penche le nez dessus et observe les légumes. Ils n'ont pas l'air bien différents de tout à l'heure. Je me demande à quoi correspond cette fumée. C'est peut-être comme la combustion du bois : une solide branche devient poussière après avoir laissé échapper une sorte de vapeur.
Rassuré, je m'éloigne et je mets la table. J'arpente la pièce, dans un bruissement de chaînes, pendant un temps interminable avant que la marmite ne m'inquiète. La vapeur est devenue une fumée noire. Je m'y précipite. Tout semble normal pourtant : les légumes sont toujours intacts, un peu luisant mais rien de grave. L'odeur ne vient pas de là. Les feuilles de poireaux, par contre, commencent à roussir. Mauvais signe, ça, il me semble. Est-ce que cette odeur de brûlé peut venir de là ?
Je cherche du regard un instrument qui me permettrait de replier les feuilles dans la marmite. Je trouve finalement une sorte de longue cuillère en bois. Délicatement, je plie les poireaux en deux, mais ça fait bouger toute la préparation et je me fige.
On remue bien le bois dans l'âtre, pour attiser les flammes. Est-ce que les légumes fondraient aussi si je les remue ? Ou est-ce qu'il faut éviter d'y toucher, comme bon nombre de préparations de poterie ou de menuiserie qui ont besoin de temps pour se concrétiser ?
Je suis penché au-dessus de la marmite, la cuillère à la main, indécis. Et c'est à ce moment-là que je réalise que je ne suis plus tout seul dans la cuisine.