Âprefond, chapitre 6
Pour la musique, je vous propose : Loyko - Good day gypsies
Bonne lecture à tous et à toutes
Je suis réveillé par un mouvement proche. Une couverture est apparue sur moi et je réalise avec horreur que je ne me suis rendu compte de rien. Louh est en train de faire chauffer de l'eau, visiblement perdu dans ses pensées. Je ne bouge pas, de peur d'attirer son attention, mais il a comme un sixième sens car il se tourne vers moi. Nos regards se rencontrent une fraction de seconde avant qu'il ne reporte son attention sur la marmite d'eau.
Dans un cliquetis de chaînes, je bouge autant que mes liens me le permettent, gémissant de douleur : tout mon corps est ankylosé. Mon épaule est encore plus douloureuse que la veille et désormais, même remuer les doigts me fait mal. La faible lumière qui perce à travers les deux minuscules fenêtres m'indique que le soleil est levé, depuis peu sans doute. Il abandonne sa surveillance pour venir s'accroupir à ma hauteur et me délivre des menottes et de la chaîne. Il m'aide ensuite à me relever et à m'asseoir sur la chaise. Et, sans avoir prononcé un mot, il nous sert un bouillon clair avec du pain.
Je mange avec appétit, l'observant du coin de l'œil. Il ne décroche pas une seule parole et, prudemment, je l'imite. Le liquide chaud semble apaiser un peu mes courbatures et mon estomac grogne de contentement. Je me lève en même temps que lui lorsque nous en avons terminé avec le petit-déjeuner mais, tandis qu'il se met à faire la vaisselle, je m'approche, l'air de rien, du billot de boucher. Et de la porte de la porcherie par la même occasion. Il ne bronche pas, visiblement concentré sur sa tâche. Je m'enhardis, m'approche plus près encore de l'issue. Un simple loquet ferme la porte, il n'y a aucune serrure ni aucun verrou. Je me doute, cependant, que la porte extérieure est plus sûrement fermée. Mais peut-être que si j'arrive à coincer quelque chose derrière la porte, je pourrais l'enfermer à l'intérieur et avoir le temps de m'occuper de …
- Je te déconseille de faire ça.
Je sursaute et me retourne d'un bond. Il me tourne toujours le dos, les manches retroussées et les mains dans une bassine d'eau. Comment diable a-t-il pu deviner mes projets ? Je m'éloigne nonchalamment de la porte. Mais je n'ose pas demander de quoi il parle d'un air détaché, je sais que je ne le duperai pas. Les battements de mon cœur se calment peu à peu et je finis par demander, d'une voix douce :
- Ça ne te manque pas, de ne pas voir la forêt qui t'entoure ?
Une espèce de grognement me fait comprendre qu'il ne voit pas de quoi je veux parler, enfin, je suppose. Alors je précise ma pensée :
- Il n'y a pas de fenêtre, tu vis complètement enfermé. Ça ne te dérange pas de ne pas voir l'extérieur ?
- On s'y habitue.
J'en doute fortement. Moi qui vis dans une roulotte, et qui suis toujours à l'extérieur, quel que soit le temps, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse s'ensevelir comme ça. Mais lorsqu'il poursuit, un ton plus bas, je comprends mieux :
- C'est plus sûr. Personne ne peut savoir qu'il y a une habitation derrière la porcherie. Et personne ne peut entrer sans que je sois au courant.
- Mais si l'entrée est condamnée, tu es coincé à l'intérieur.
- Non.
- Non ?
- Non, j'ai d'autres solutions. Mais n'y compte pas, je ne te dirai rien. Et ne t'avise pas de t'enfuir.
Je hoche doucement la tête. C'est vrai que je ne faisais pas la conversation de manière totalement désintéressée. Pour un conteur, je manque de subtilité. Mais je ne nie pas, c'est inutile, et je ne poursuis pas sur ce sujet. Je m'approche de lui, l'observe en train de laver les écuelles. Le H sur sa joue est parfaitement visible. Il ne ressemble pas à la cicatrice d'un coup de couteau ou d'épée. La chair boursoufflée fait plus penser à une marque au fer rouge et ça m'intrigue. Le plus intriguant, encore, c'est qu'il ne cherche pas à la cacher. Je ne l'ai jamais vu les cheveux attachés, certes, mais il ne s'en sert pas pour masquer cette marque. Pourquoi ? Si j'étais défiguré de la sorte, j'emploierais des artifices pour éviter que tout le monde le voit. Il est conscient de mon examen, j'en suis convaincu, mais il ne bronche pas, il doit en avoir l'habitude. Mais que peut bien représenter cette lettre pour lui ? Serait-ce … ?
- On s'occupera de tes vêtements plus tard, il faut y aller.
J'acquiesce lentement, machinalement, bien que je me demande pourquoi il me raconte tout ça. Depuis quand un geôlier prend la peine d'informer son prisonnier de ses plans ? Puis je réalise :
- Comment ça, « il faut y aller » ? Tu veux dire que je viens avec toi ?
- Oui.
- On va où ?
- Tu verras. Est-ce que je dois t'entraver ?
- Non. Je ne m'enfuirai pas, promis.
Il me dévisage en se séchant les mains, sceptique. Alors j'insiste :
- Je te jure. Je ne sais même pas où nous sommes. Et tu cours sans doute beaucoup plus vite que moi, en connaissant le moindre recoin de cette forêt. Et très franchement, je risque plus de tomber sur des villageois furieux plutôt que sur notre campement. Et même si j'arrive à le rejoindre, tu sauras parfaitement où me trouver. Alors je ne m'enfuirai pas, je te le jure. Et je suis heureux de t'aider dans l'enquête, vraiment. Si je peux participer à la découverte de preuves qui m'innocentent, c'est bien volontiers.
Il se contente de hocher la tête : rien, sur son visage impassible, ne me permet de savoir si je l'ai convaincu ou pas. J'ai prononcé ces paroles dans le but de lui paraître le plus inoffensif possible. C'était calculé, c'est vrai : c'est dans mon intérêt qu'il me considère comme un pauvre gars sans défense ni mauvaises pensées. Mais à vrai dire, si je ne l'ai pas convaincu, j'ai presque réussi à me convaincre moi-même : mes chances de réussir une évasion sont minces. Sans un mot, il s'avance vers la porte de la porcherie. Juste avant de l'ouvrir, il se retourne et lâche, en me fixant droit dans les yeux :
- Juste pour information. Si tu t'enfuis, je t'égorge et je te donne à manger aux cochons.
Même si nous n'en possédons pas, je sais que les cochons mangent absolument de tout. Il paraît même que les porcheries sont toujours épargnées par les rats, car les porcs se font un plaisir de les dévorer. Je déglutis bruyamment. Autant éviter de finir comme ça.
Il me laisse sortir avant de refermer soigneusement derrière lui. Puis nous nous enfonçons dans la forêt. Je lui demande quelques minutes pour aller satisfaire certains besoins parfaitement naturels, et il me les accorde sans broncher. Nous reprenons ensuite la marche. J'ai beau essayer de retenir des détails pour m'aider à me repérer, à mesure que nous avançons, je réalise que je serais même incapable de retourner à la porcherie. Je me demande s'il ne le fait pas exprès, pour protéger son repaire.
Nous marchons ainsi de longues minutes quand un mauvais pressentiment me serre soudain la gorge. Au détour d'un virage, face à nous, à moitié ensevelies par la végétation, des ruines émergent, noircies par les années. Ce devrait être un hameau, voire un petit village : les murs à moitié écroulés se dressent autour de ce qui devait être une route. Un bâtiment un peu mieux préservé, plus massif, devait tenir lieu de chapelle ou d'église. Mais là encore, il n'en reste pas grand-chose. Le silence est complet, tout juste troublé par l'herbe haute que nous écrasons sous nos pas. Même les oiseaux ont fui les lieux. Je frissonne malgré la tiédeur de l'air. J'ai presque l'impression de sentir les esprits des villageois me frôler.
Je dois parler. Je dois meubler ce silence oppressant. J'essaie de prendre un ton léger, mais je crois que c'est peine perdue, quand je lui demande :
- Tu crois que le voleur aurait caché la vache ici ? Ou tu penses plutôt qu'on y trouvera Mélisende ? En tout cas, c'est une excellente idée. Ce coin paumé et lugubre est parfait pour y cacher son butin, quel qu'il soit. Enfin, j'imagine, hein, je ne suis pas un voleur et je n'ai jamais eu à cacher un bu...
- Non. Personne ne vient jamais ici.
Il ne dit rien de plus et sa réponse sèche n'aide pas à se sentir un peu plus à l'aise. Je lui jette un rapide coup d'œil, mais il ne semble pas vouloir en dire plus. Alors j'insiste :
- Pourquoi ?
- C'est l'ancien village. Il a été abandonné quand presque toute la population a été décimée par la Grande Peste.
Je crois bien que je pâlis. La Grande Peste date de près de trois siècles, mais elle nous hante encore, tous autant que nous sommes. Comment imaginer que, lors de cette hécatombe, aucun esprit ne se soit trouvé coincé entre deux états, mort mais encore parmi les vivants ? Je frissonne : ses explications sont encore pires, car désormais, j'ai la quasi certitude que nous ne sommes pas tout à fait seuls ici.
Les rares traces, dans la végétation, montrent que ce sont de petits animaux qui s'y risquent. Aucune personne douée de raison n'irait de son plein gré. Même pour y cacher des monceaux d'or. Alors que diable faisons-nous ici ?
Louh s'avance jusqu'à la ruine la mieux conservée et, d'un geste de la tête, me fait signe de le précéder. Je secoue la tête, la gorge nouée. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais son regard se fait si dur que je cède. Les esprits sont peut-être moins dangereux que lui, après tout. Le bois de la porte a pourri avec le temps et il n'en reste plus rien, mais les quatre murs se dressent encore à hauteur d'homme. La végétation, a pris ses aises et quelques sureaux poussent au milieu de ce qui fut un lieu de vie. Je le vois s'approcher d'une trappe en bois, étrangement bien conservée. Lorsqu'il la soulève, dévoilant une cave, et qu'il me fait signe d'y entrer, je m'exclame :
- Non, Louh, non non non. Je ne descends pas là. C'est hors de question.
Il porte la main à la garde de sa dague. Je perds toute retenue :
- Je t'en prie, Louh, ne me fais pas rentrer là-dedans. Je t'en supplie. Je te jure, j'attendrais très sagement, je ne m'enfuirai pas. Je ferai le guet pour toi. S'il te plait, Louh.
Mais il ne veut rien entendre et, s'approchant de moi avec son air menaçant, me convainc d'emprunter les escaliers. Je descends un peu trop vite les quelques marches et manque de m'écraser au sol. Je retrouve mon équilibre de justesse. J'ai juste le temps d'entendre un « je reviens très vite » que la trappe se referme sur moi. Et j'ai beau hurler, le supplier, l'implorer, elle ne s'ouvre pas. Pire, j'entends distinctement qu'il pousse quelque chose pour la verrouiller.
Je me laisse tomber à genoux. Laborieusement, j'essaie de calmer mon souffle, de respirer régulièrement. Après quelques minutes de lutte contre moi-même, je perçois, malgré les larmes qui remplissent mes yeux, que les planches de la trappe ne sont pas parfaitement jointes. Elles me permettent d'avoir un peu de lumière, pas grand-chose, mais suffisamment pour que je puisse percevoir un peu où je suis. Les escaliers et les murs sont étonnamment en bon état, pour une ruine. Je me demande qui a pris la peine de les entretenir, et dans quel but.
Les dernières paroles de Louh me reviennent en mémoire et je me focalise dessus. Je devrais le détester. Je devrais le haïr pour m'avoir raconté cette histoire de Grande Peste, même si c'est moi qui ai insisté pour savoir. Je devrais le détester pour m'avoir emmené dans ce village maudit et pour m'avoir forcé à descendre là-dedans. Je devrais le haïr de prendre si peu en compte mes protestations, de ne pas daigner m'informer de ses agissements et de me laisser là, enfermé dans cette cave sordide. Oui, je le devrais. Si je n'étais pas son prisonnier, s'il n'était pas mon geôlier, si nous n'étions pas deux inconnus l'un pour l'autre, alors peut-être que j'en aurais le droit.
Je dois accepter mon sort, en espérant qu'il ne passe pas la journée à arpenter le fief en me laissant moisir ici. Parce qu'il reviendra, j'en suis sûr. S'il est prêt à m'égorger, c'est qu'il ne redoute pas de tuer quelqu'un directement. Ça ne serait pas logique qu'il veuille me laisser mourir ici.
J'éclate d'un rire dément. Je parle de logique, alors que je suis enfermé dans des ruines que tout le monde fuit, à la merci d'un assassin qui m'a arrêté sans aucune preuve. J'essaie de me rassurer, de me calmer, alors qu'il faudrait que je panique pour de bon, là.
Non. Non, pas de panique. De la réflexion. Je dois sortir de là, quitte à l'attendre bien sagement à côté de la trappe ouverte. Je ne peux pas rester ici, à nouveau enterré, je vais devenir fou. Je m'approche de la trappe et monte quelques marches puis, du bras gauche, j'essaie de la pousser. Comme je m'en doutais, elle est impossible à déplacer. Ce n'est certes pas mon bras le plus fort, mais j'y ai mis l'énergie du désespoir. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Alors j'examine les planches disjointes. Peut-être qu'en y glissant les doigts...
Je m'y attèle, sans vraiment réaliser que ça apaise ma panique. J'agis, ça m'évite de trop réfléchir. Le premier jour que je touche s'avère être juste un défaut de la planche. Le bois y est solide. Je passe au suivant. Et là, un sourire triomphant éclaire mon visage : le bois est vermoulu. Je le gratte un peu avec l'ongle et une fine poussière me tombe dessus. Alors j'y vais plus franchement, gratte furieusement du bout des doigts, et ce sont de petits morceaux de bois qui chutent.
Mon bras gauche devient douloureux à force d'être en l'air, mais je n'y prête pas attention. Avec un peu de persévérance, j'arriverais à creuser un espace suffisant pour …
Un bruit. Un raclement. Et soudain, la trappe s'ouvre sur Louh. Il m'examine, recouvert de débris de bois et fronce les sourcils. Puis, dans un silence désapprobateur, se recule hors de mon champ de vision.
Je me précipite hors de cette cave, prêt à l'invectiver. Mais la présence de Filippia me cloue le bec. Mon tout premier réflexe est de me jeter sur elle et de la serrer contre moi. Elle rit de mon enthousiasme tout en me rendant l'accolade et j'ai l'impression de revivre. Puis la réalité me rattrape et je lui demande :
- Bon sang, toi aussi, tu es arrêtée ?
- Non, je viens pour ton épaule.
Je m'écarte un peu d'elle, la dévisage. Elle perçoit mon incompréhension puisqu'elle explique :
- Louh est venu au campement pour trouver un guérisseur. Quand on a su que tu avais un problème à l'épaule, je me suis portée volontaire.
Bien sûr. Nous n'avons pas pour habitude de partager nos savoirs avec les villageois : ils ont leurs propres guérisseurs et ça ne leur viendrait pas à l'idée de nous demander ce genre de choses. Filippia est toujours prête à soigner, que ce soit l'un des nôtres ou un pauvre hère sur la route. Mais elle n'offre pas ses services sans une bonne raison : aujourd'hui encore, le savoir des plantes peut vite devenir la sorcellerie. Quand Louh est arrivé au campement, il a dû être accueilli avec méfiance et sa demande aurait été soldée par un refus poli s'il ne m'avait pas mentionné. Je hoche doucement la tête en lui souriant. Puis je regarde autour de nous : Louh n'est visible nulle part. Je lui chuchote :
- Tu es venue toute seule ?
- Oui, il a refusé que Gabor m'accompagne.
- Et Voel a accepté ?
- Oui. C'était moi, seule, ou personne.
- Pourquoi a-t-il accepté de te laisser partir seule avec cet assassin ? Il aurait pu te trancher la gorge, te violer dans la forêt sans que personne ne s'en rende compte !
- Je ne sais pas. Ils ont discuté un moment et Voel a donné son accord. Et il ne m'a pas touché, alors ne t'inquiète pas pour moi. Comment tu vas ?
- Je suis heureux de te voir, tu n'as pas idée ! Il va finir par me tuer, il n'arrête pas de m'enfermer dans des endroits obscurs, et silencieux, et morbides, et …
- Je lui ai dit que tu ne supportais pas d'être enfermé.
- Tu lui as dit ?
- Oui, bien sûr. Le temps qu'on vienne jusqu'ici, il fallait bien faire la conversation, même s'il n'est pas très causant. J'ai demandé de tes nouvelles, et il m'a dit que tu allais plutôt bien. A part cette crise de panique que tu as fait, hier. Alors je lui ai dit que tu ne supportais pas les lieux clos sans lumière.
- Et il a répondu ?
- Non, il n'a pas dit un mot.
- Tu dois être très prudente avec lui, Filippia. Ne le provoque pas, cet homme est capable de tout.
- Sans doute. Mais je devais lui dire et j'espère qu'il en tiendra compte à l'avenir. Et ton épaule, alors ?
La joie de la voir s'efface. Je grimace, penaud, et tandis qu'elle déblaie du plat de la main les débris de bois qui parsèment ma chemise, je lui explique :
- Je n'arrive plus à bouger le bras depuis que je suis tombé dessus, lorsqu'on a fuit les villageois. Ça me fait mal dans tout le haut du corps.
- Tes doigts ?
- J'évite de les bouger, c'est douloureux.
Elle hoche doucement la tête, commence à dénouer le lien de l'encolure. Observatrice, elle remarque :
- Ce ne sont pas tes vêtements ?
- Non, il m'en a prêté. Les miens sont dans un sale état. Entre la course dans les bois, les chutes... D'ailleurs, vous vous en êtes bien sortis ?
Elle retire avec beaucoup de précaution le vêtement, tout en me racontant :
- Oui, nous avons couru jusqu'au campement sans encombre. Nous ne nous sommes aperçus de ton absence que très tard, et nous ne pouvions plus faire demi-tour. Quand nous avons expliqué à Voel que tu avais disparu, il a aussitôt organisé un groupe pour partir à ta recherche. Mais il n'y avait plus personne. Ni villageois, ni Yoshka. On a passé du temps à fouiller les sous-bois, mais sans succès. Et puis, Louh est apparu et nous a expliqué qu'il t'avait arrêté.
Elle palpe mon épaule, me faisant gémir de douleur. Pour oublier qu'elle me manipule et parce que j'ai peur de manquer de temps, je lui demande :
- Tout le monde va bien, au campement ?
- Oui, même si nous sommes très inquiets pour toi. Les villageois nous laissent tranquilles. Nous n'avons plus personne, en soirée, cela dit. Mais je ne suis pas sûre que nous ayons le cœur à les accueillir. Tu as reçu de la visite, par contre. Un certain Jehan, qui te cherchait pour écouter une histoire de preux chevalier. Le fait est que …
Je hurle soudain de douleur. J'ai l'impression qu'elle vient de me casser l'épaule. Les yeux brouillés de larmes, je la vois qui s'éloigne de moi, impassible, tandis que la silhouette de Louh apparaît dans l'encadrement de la porte. J'entends Filippia lui dire, d'une voix légère :
- Ce n'est rien, je lui ai juste remis l'épaule en place.
Je voudrais bougonner que non, ce n'est pas rien, mais j'ai encore le souffle coupé par la douleur. Lorsqu'elle revient près de moi, elle dépose sur mon épaule un baume qui sent bon. Je me demande brièvement pourquoi je remarque cette odeur, alors que je suis à l'agonie. Elle masse doucement mon épaule endolorie tout en poursuivant, comme si de rien n'était :
- Ce garnement avait faussé compagnie à ses parents pour venir t'écouter. C'est Voel qui s'est occupé de lui quand il est arrivé, mais il a craint que s'il le ramenait à ses parents, ça empire la situation. Alors il a envoyé Ostelinda. Tu comprends bien que voir leur fils revenir avec une gamine était moins inquiétant pour les parents que …
Je comprends bien, oui, même si là, à cet instant, je m'en moque un peu. Le souvenir de la douleur me fait encore vaciller. Mais Filippia poursuit, imperturbable :
- Et devine qui nous avons vu arriver, ce matin ? Jehan ! Sauf que cette fois, il ne te cherchait pas, navrée de te l'apprendre : il voulait parler à Ostelinda.
Je secoue doucement la tête. Les enfants se soucient bien moins des rumeurs que les parents : si quelque chose leur plait, ils y vont, quoi qu'en disent les adultes. Filippia bande soigneusement mon épaule, et je réalise que son bavardage a rendu les soins moins pénibles. Et ça me fait du bien d'entendre à nouveau les histoires du camp. Pendant quelques instants, grâce à elle, j'oublie que je suis à la merci de Louh. Le haut de mon bras est immobilisé contre mon torse. Elle me laisse l'avant-bras libre en préconisant d'éviter au maximum les mouvements le temps que la douleur passe. Ensuite, elle me demande :
- Est-ce que tu as mal ailleurs ?
- Des bleus et des bosses, mais rien de bien grave je pense.
Elle se met sur la pointe des pieds pour palper la bosse qui orne mon crâne, l'enduit de baume, puis, profitant que je sois torse nu, examine mes divers bleus.
- Louh m'a donné un onguent à mettre dessus.
- Tu as pu en mettre dans ton dos, malgré ton épaule ?
- C'est Louh qui s'en est chargé.
- Vraiment ?
Je sens mes joues chauffer et je n'ose pas répondre, de peur que ma voix me trahisse. Elle poursuit d'une voix légère :
- C'est plutôt attentionné, pour quelqu'un qui cherche à te tuer en t'enfermant. Cette situation est temporaire, Yoshka, juste le temps qu'ils t'innocentent. Ne perds pas la foi.
Je bougonne un semblant de réponse et elle éclate de rire. Elle en a terminé de son examen, et je suis presque entièrement badigeonné de baume. Elle m'aide à remettre la chemise, coinçant mon bras sous le tissu et laissant la manche vide prendre. Puis de sa voix douce, elle appelle Louh, qui arrive aussitôt. Il devait nous attendre dehors, et peut-être même qu'il a entendu tout ce que nous disons. Mais ça ne la perturbe pas. Le fait qu'il soit un assassin, qu'il mesure une bonne tête de plus qu'elle ne la perturbe pas non plus lorsqu'elle lui dit :
- Il faudra refaire le bandage régulièrement, et y appliquer ce baume.
D'autorité, elle lui colle le pot dans les mains et de sa voix fluette, sans trembler, poursuit ses instructions :
- Et pas question de l'enfermer à nouveau : il n'est pas en bonne santé et c'est dangereux pour lui. Trouvez une autre solution.
Elle ponctue cet ordre avec un des sourires dont elle a le secret, qui fait fondre le cœur le plus endurci. Et Louh opine, peu touché par la manière dont elle lui parle. Sa jupe virevoltant autour d'elle, elle tourne les talons pour récupérer sa besace, où elle garde tous ses trésors. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je réalise :
- Tu as amené mon cistre !
- Oui, je sais à quel point il t'est précieux. Et je suis sûre que Louh veillera à ce qu'il ne lui arrive rien de fâcheux, n'est-ce pas ?
Cet homme si impressionnant hoche doucement la tête, sans piper mot, loup vaincu par une agnelle au sourire angélique. Sa besace portée en bandoulière, elle se plante devant lui et lui annonce :
- J'en ai terminé.
Je voudrais la contredire, prétendre que non, ce n'est pas terminé, qu'elle doit rester avec moi encore longtemps, très longtemps. Mais Louh tourne déjà les talons pour quitter la ruine, suivi par Filippia. Et comme il est hors de question que je reste dans cet endroit, je m'empresse de les suivre, mon cistre dans le dos. Mais je ne vais pas bien loin, car Louh s'est immobilisé au milieu de l'ancien village. Et nous regardant avec tout le sérieux du monde, il déclare :
- Je me suis engagé à ramener Filippia au campement mais tu ne peux pas trop t'en approcher, Yoshka. Nous nous arrêterons un peu avant. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit, à propos d'une éventuelle fuite.
- Comment oublier ?
Ma voix s'est faite grinçante mais il ne relève pas. Il se remet en marche et nous nous empressons de l'imiter. Avec Filippia, nous marchons deux pas derrière lui, en discutant avidement, comme s'il n'était pas là, profitant de nos derniers moments ensemble. Je lui demande des nouvelles de Djidjo, de Ysayo, de Gabor. Je n'ai quitté le campement que depuis une grosse journée, mais ils me manquent terriblement. Comprenant mon besoin de parler, Filippia se fait bon public et m'abreuve de détails drôles ou anodins. Finalement, le trajet s'avère très rapide et Louh fait déjà signe de s'arrêter, alors que j'ai l'impression que nous venons juste de partir. Je serre Filippia contre moi, de toutes mes forces, la remerciant pour les soins et pour mon cistre dans un murmure. A son tour, elle me chuchote que tous me soutiennent, que tout se passera bien, et que je ne dois pas perdre espoir avec Louh.
Sa dernière phrase me laisse franchement sceptique, mais nous n'avons plus le temps de discuter. Immobile sous les arbres, silencieux, resté seul avec mon bourreau, je la regarde s'éloigner.
Âprefond, chapitre 5
Pour la musique, je vous propose : šaban bajramović - geljan dade
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente lecture !
On me transporte. Des formes et des couleurs passent devant mes yeux. On m'emmène subir la question, c'est sûr. Le bourreau sera là. Il va m'interroger, me faire subir le fouet et l'écartèlement jusqu'à ce que j'avoue. Et j'avouerai, c'est sûr. Alors il m'attachera, dans la cour du château, nu devant des spectateurs avides. Il me fera castrer, devant tout le monde, et mes souffrances seront indicibles. Dans le meilleur des cas, je survivrais, mutilé à jamais, l'infamie gravée dans ma chair. Sinon, je me viderais de mon sang, devant des villageois ravis que justice soit me débats désespérément en protestant à cette idée mais le manque d'air me rend faible comme un chaton. Je suffoque. Ma vie est finie.
Et puis, soudain, je suis dans l'herbe. Vautré de tout mon long dans une herbe d'un vert magnifique, je sanglote en hoquets douloureux. Je crois que je supplie, aussi, mais mes paroles n'ont aucun sens à mes propres oreilles. Seul le silence me répond.
J'ignore combien de temps je reste comme ça. Mais mes larmes se tarissent et ma respiration devient plus facile. Je ne suis pas entravé, étrange. Je relève un peu la tête : le souffle de la brise effleure mon visage, caresse aimante. Le ciel s'est paré de ses nuances orangées, annonciatrices du crépuscule. Une de mes mains s'agrippe à l'herbe, comme pour se rattacher à la vie. Ma poitrine est douloureuse mais je suis en vie. Une main se pose sur mon épaule, légère. L'homme en noir, accroupi, me dévisage en silence, impassible.
Les minutes qui passent rendent ma respiration plus régulière et les battements de mon cœur moins affolés. Si le Dieu miséricordieux, auquel ils croient si fort, est réellement bienveillant, alors qu'Il fasse que je meurs ici et maintenant, dans la quiétude de cette clairière.
Lui aussi doit avoir une dent contre les tsiganes, car je ne meurs pas. L'homme en noir se redresse, fait les cent pas, me faisant comprendre que je ne peux pas rester comme ça, vautré dans l'herbe. Je me redresse, m'assois, vacille. Mes vêtements sont déchirés, tachés de sang et de boue. J'ai souillé mes chausses marron, qui s'ornent désormais d'une large auréole foncée autour de l'entrejambe. Tout mon corps est douloureux. Et l'homme en noir ne cesse de me regarder. Mais je suis libre de mes mouvements, et aucun bourreau n'est visible.
Je tourne lentement la tête, malgré la douleur qui pulse à mes tempes. Je ne suis pas tout à fait dans une clairière. Si l'herbe rase fait bien une percée dans la forêt, une partie de mon horizon est constituée d'une falaise. Elle n'est pas très large, pas très haute, mais c'est bien une falaise, contre laquelle est adossé un bâtiment. Une porcherie, en réalité, avec un grand enclos devant, des auges pour l'eau et la nourriture, et quatre magnifiques cochons bien gras. Mais quel genre de geôles est-ce là ?
- Ne t'avise pas de raconter ce que tu verras ici. Et lève-toi, la nuit tombe.
Sa voix est tombée comme un couperet. Je lui obéis, du moins, j'essaie. Alors il m'attrape par le col et me redresse sans douceur. Et il reste à mes côtés, le temps que je me stabilise. Sans me lâcher, il m'entraîne à l'intérieur de la porcherie, où l'odeur est entêtante. Sur ma droite, un petit mur, d'un mètre cinquante environ, sépare le petit couloir et le plus gros de la pièce. De la paille, des auges, tout est prévu pour les animaux et c'est bien entretenu. Mais déjà il pousse une porte, au fond, qui s'ouvre sur une cuisine, me traînant à sa suite. Hébété, je découvre les lieux que j'ai déjà dû traverser deux fois, si mon intuition est juste. Un feu dans la cheminée, un billot de boucher contre le mur de la porcherie, une table et des chaises au centre, quelques meubles contre le mur du fond ornent la pièce.
Il ne s'y arrête que le temps de prendre la lanterne allumée, posée sur la table, et poursuit son chemin. Au fond de la cuisine, une arche irrégulière, creusée dans la falaise, laisse entrevoir un couloir sombre et d'autres pièces. C'est dans la première sur la droite qu'il me conduit. Un lit, une malle, un nécessaire de toilette la meublent. J'ai l'impression de sentir, sur mes épaules, tout le poids de la roche au-dessus de nous. L'homme en noir a aménagé une chambre dans une grotte. Il n'y en a pas qu'une, c'est un réseau de grotte, où il a installé des geôles privatives. Je frissonne des pieds à la tête et manque de défaillir. Sa voix dure n'apaise pas mes craintes lorsqu'il m'ordonne :
- Déshabille-toi complètement. Et ne touche à rien, je reviens.
Il me lâche soudainement et je manque de m'écrouler. Il s'éloigne d'un pas rapide après avoir laissé la lanterne et je me trouve là, au milieu de cette chambre, complètement désorienté. Mes chausses humides me collent désagréablement à la peau. Je sens mauvais, je m'en rends compte. Alors, avec mille précautions, grimaçant de douleur, j'ôte un à un mes vêtements, jusqu'à me retrouver parfaitement nu au milieu de la pièce. Je ne suis pas pudique, comment l'être quand on vit constamment en groupe, mais je ne suis pas très l'aise. J'aurais pu refuser, m'insurger contre ce traitement. J'aurais dû, sans doute. Mais je suis seul avec cet homme et Dieu seul sait de quoi il est capable si on ne lui obéit pas. Alors autant faire profil bas et ne pas le mécontenter pour si peu. D'autant que, bien que j'ignore quels sévices m'attendent, m'aurait-il réellement amené dans une chambre pour me torturer ?
Il revient avec un seau d'eau fumante et un linge propre, me faisant sursauter. Machinalement, je place ma main gauche devant mes attributs, mais il ne m'accorde pas un regard quand il dépose le récipient près de moi. Et sa voix sèche retentit encore :
- Lave-toi.
Au campement, personne ne donne d'ordre à personne. Nous suggérons, nos proposons, nous faisons. Nous savons ce qui doit être fait et nous nous entraidons toujours. Les seuls ordres auxquels j'ai eu à faire venaient tous de personnes extérieures à notre clan. Et je ne m'y suis jamais plié de bonne grâce.
Ce soir, ce n'est pas de meilleure grâce que j'obéis. Je redoute sa réaction, si jamais je refusais. J'ai peur qu'il me colle encore dans ce réduit sombre et silencieux, qu'il m'y oublie. Et je me sens sale. Alors j'utilise le savon, l'éponge et l'eau chaude pour me laver, faisant ainsi un inventaire de mes contusions, puis je me sèche soigneusement.
Il réapparaît soudain, alors que je n'avais même pas remarqué son absence. Il me tourne autour, lentement, scrute mon corps avant de me tendre un pot.
- C'est pour les bleus.
Je le prends, surpris par son attention. Je suis son prisonnier, mais il me permet de me laver, de me soigner. Je dévisse machinalement le couvercle et l'odeur d'arnica vient chatouiller mes narines. Mais sa main passe devant mon visage pour plonger les doigts dans l'onguent, puis il se glisse dans mon dos et étale le baume sur mon omoplate gauche. Je peine à me concentrer sur ma tâche, je sens son souffle sur ma peau nue et ça me trouble un peu trop.
Pire encore, ses doigts descendent jusqu'au bas de mes reins. La zone est douloureuse, c'est là qu'une des pierres m'a atteint, ce matin. Il agit avec douceur pour appliquer le baume mais sans que ses gestes ne prêtent à confusion : il m'aide juste à soigner des parties inaccessibles de mon corps. Et pourtant, mon sexe se redresse un peu, soudain intéressé.
La panique s'empare à nouveau de moi. Je suis fini s'il s'en rend compte. J'essaie de me calmer, de ne laisser libre cours ni à ma panique, ni à mon excitation.
Il s'affaire dans mon dos puis balance sur la malle quelques vêtements noirs. Il ne me jette pas un regard lorsqu'il s'éloigne de moi en disant :
- Je te laisse terminer avec le baume. Quand tu auras fini, mets ces habits propres et amène les autres à la cuisine. Et ne touche à rien ici.
Il me faut quelques minutes pour reprendre le contrôle de mes nerfs. Lorsque je termine d'appliquer l'onguent, en enduisant généreusement mon orteil qui vire au bleu sombre, mes doigts tremblent et je suis heureux qu'il ne soit plus là. Puis j'enfile ses vêtements. J'ai beaucoup de mal à passer l'épaule blessée, et je m'y prends avec énormément de délicatesse. Ils me vont parfaitement, à part que je dois retrousser un peu les extrémités des chausses et de la chemise.
Je me sens mieux. Physiquement, je me sens mieux : la douleur s'estompe un peu, à part l'épaule, et je me sens propre et au chaud. Mais je baigne toujours dans une étrange hébétude. Les événement s'enchaînent trop vite et je ne comprends plus bien où j'en suis.
A vrai dire, je ne comprends absolument pas ma situation, si ce n'est que je suis un mort en sursis.
Gardant mon bras droit contre le corps, je récupère ma bourse, lourde de cet étrange caillou et la passe à la ceinture, je ramasse mes oripeaux, la lanterne et le pot d'onguent. Puis je me rends dans la cuisine pour affronter mon geôlier. Deux écuelles en bois sont posées sur la table et l'homme en noir s'affaire près de la marmite. Je toussote poliment et il se retourne. Il m'observe quelques instants avant de désigner, du menton, une cuvette en bois. J'hésite un moment, avant de décider que c'est pour mes vêtements, et je les laisse tomber dedans. Sur le billot de boucher, je pose le pot d'onguent. Sur la table, je dépose la lanterne allumée, qui se joint la lumière des flammes de la cheminée pour éclairer la pièce. Et alors que je m'immobilise, indécis quant à la suite des évènements, il me dit :
- Assieds-toi, on va manger.
Cette fois encore, je lui obéis sans broncher. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre, de toute façon ? Je ne suis pas en position de jouer au fanfaron. Il me rejoint avec une marmite de potage, qu'il verse dans nos écuelles. Il coupe de larges tranches de pain et nous sert du vin coupé à l'eau. Puis il se met à manger. Je l'observe, ne sachant pas comment me comporter. J'ai faim et j'ai soif mais la situation est tellement surréaliste que je suis perdu.
- Tu n'as pas faim ?
- Si.
- Alors mange.
Je bois d'une traite mon verre, ce qui apaise un peu ma soif. Mais je n'arrive pas à manger. Alors, tenant maladroitement ma cuillère de la main gauche, je laisse échapper :
- Je suis en état d'arrestation.
- Je te l'ai déjà dit.
- Mais je ne suis pas dans les geôles du château.
- Non.
- Je suis chez vous.
- Oui.
Il s'interrompt à peine de manger pour me répondre du bout des lèvres. A ce rythme, je ne suis pas près de découvrir le fin mot de l'histoire. Alors j'insiste :
- Je ne suis pas entravé, ni même enfermé.
- Tu as failli mourir étouffé, tout à l'heure. Je n'ai pas envie d'avoir à m'occuper de ton cadavre. Quant aux entraves, je te surveille donc ce n'est pas nécessaire, surtout vu ton état. Mais si tu y tiens, je peux arranger ça.
Je nage dans l'incompréhension la plus totale. Il me sort de ce tombeau, me permet de me nettoyer, de porter ses vêtements, je dîne à sa table. Mais dans un même temps, sa voix glaciale, son manque évident de compassion, ses propos blessants me déstabilisent. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'en apprendre plus, alors je continue mon interrogatoire.
- Pourquoi je ne suis pas dans les geôles du château ?
- Pas assez de preuves pour ça.
Je suis sidéré. Sa réponse déclenche tant de nouvelles questions dans mon esprit que je ne sais pas par où commencer. Mon silence doit être révélateur, car il délaisse son potage pour me regarder et me dire :
- Les geôles du château, ça veut dire un registre à remplir, des informations à fournir.
Je cède à la tentation et commence à manger le potage, qui s'avère être savoureux. Je l'écoute pourtant attentivement mais je laisse le silence faire son office : il a l'air d'être plus causant quand on ne lui pose pas de questions. Et effectivement, il poursuit dans un bougonnement :
- Il leur faut des preuves. On ne peut pas engeôler quelqu'un comme ça.
- Vous n'avez aucune preuve contre moi, puisque je n'ai rien fait.
Il ne répond rien et j'enrage intérieurement. Je prends cependant son silence comme un aveu et je poursuis sur ma lancée :
- Vous m'avez arrêté de manière totalement arbitraire.
Je retiens à grand peine un sourire victorieux. Il reconnaît lui-même, enfin presque, qu'il n'a aucune preuve contre moi. L'espoir est encore permis. Je pourrais peut-être m'en tirer.
Encore du silence, jusqu'à ce qu'il lâche, du bout des lèvres :
- Il fallait une arrestation pour calmer les villageois.
La cuillère s'immobilise à mi-chemin de ma bouche et je le dévisage, pantois. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, cette déclaration sibylline ? Cette charogne termine tranquillement son écuelle alors que, sous mon crâne, espoir et cynisme se livrent une bataille impitoyable. Je décide de l'imiter, par défi, pour ne pas lui montrer à quel point je suis frustré par ses paroles. Lorsqu'il a fini son assiette, il repose sa cuillère, se lève et remplit deux bols d'un liquide fumant. Puis il les ramène sur table, avec une belle portion de fromage qu'il dépose entre nous. Et là, enfin, il déclare :
- Les villageois auraient fini par s'en prendre à vous. Le fait que ni la vache, ni la fille ne s'y trouvent n'est pas une preuve. Si vous êtes un peu malins, vous les avez laissées loin de votre campement, pour qu'on ne puisse pas vous accuser. Les villageois peinent à faire confiance à la justice, ils veulent qu'on retrouve ce qui a disparu immédiatement. Les belles paroles ne leur suffisent pas. Les esprits allaient s'échauffer jusqu'à ce qu'un drame arrive.
- Alors vous avez profité qu'ils me livrent à vous pour m'accuser.
- Ils ne t'ont pas exactement livré à moi. Je suis arrivé au moment où ils allaient te lyncher et je leur ai demandé ce qu'il se passait. Quand ils ont prétendu que tu étais le coupable, je leur ai dit que je t'arrêtais et que je t'emmenais en geôles.
- En geôles au château. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez ramené chez vous. Vous n'avez pas peur qu'ils découvrent la vérité ?
- Ils n'oseront pas aller au château. Ils vont attendre que le verdict tombe.
Je le dévisage longuement. Il est toujours aussi impassible, mais ses propos sont éloquents. Il coupe deux parts de fromage et poursuit lentement :
- Les villageois ont leur coupable, ce qui me laisse le temps de découvrir ce qu'il s'est passé et ..
- Vous ne me croyez pas coupable, alors ?
Il plonge son regard dans le mien et je réalise, pour la première fois, à quel point ses iris sont sombres. Il décrète d'une voix lente :
- Mes convictions personnelles n'ont aucune importance. Je vais découvrir ce qu'il s'est passé. S'il s'avère que tu es coupable, je t'aurais sous la main. Si ce n'est pas le cas, je te relâcherais.
- Et moi, alors, dans tout ça ? Je reste dans cette geôle qui s'apparente plus à une tombe, à devenir aveugle et à imaginer mille manières de mourir, le temps que vous arriviez à découvrir la vérité ?
Je ne l'aurais pas cru possible, mais son regard se fait encore plus dur quand il me fixe. Et sa voix est une lame glaciale quand il me répond :
- Toi, tu t'estimes heureux d'être encore en vie ce soir, parce que les villageois t'auraient volontiers achevé ce matin. Tu profites du répit que je vous accorde, à toi et aux tiens. Et tu finis ton repas en silence.
Sa réponse me cloue le bec. Par défi, je lui dirais bien ma façon de penser mais je devine que ce n'est pas le moment de le titiller davantage. Croquant ma part de fromage, je tente de réfléchir à ses propos malgré mon indignation. J'étais au sol, assommé par ma chute, une horde de villageois à mes trousses. Enfin, je ne sais pas combien ils étaient, mais qu'importe. Oui, je le crois quand il dit qu'ils m'auraient bien volontiers achevé. Gabor et Filippia au loin, je me retrouvais à leur merci, sans défense. Nul ne peut prédire ce qui aurait pu se passer, mais ils n'avaient pas d'intentions amicales, c'est certain.
Quant à mon répit... J'ignore ce qui m'attends pour la suite. Le temps que j'ai passé dans cette pièce obscure et silencieuse n'était certainement pas du répit. Définitivement pas. Mais la toilette et le repas sont les bienvenus. Alors si le reste de ma captivité se passe comme ça, oui, ça sera une sorte de répit. Même si j'ai l'impression d'abandonner les autres. Auront-ils réellement la paix, le temps que ces mystères soient résolus ?
Le liquide brûlant est en réalité une infusion à base de thym, de bourrache et de sauge. Je la sirote en silence, savourant la chaleur qui se diffuse en moi. Que se passera-t-il si la vache et la jeune fille ne sont jamais retrouvées ? Combien de temps pourrais-je rester en état d'arrestation, sans preuve, si l'enquête ne mène nulle part ?
Il termine son infusion, s'installe plus confortablement contre le dossier de sa chaise, croise les bras sur la poitrine et me dévisage. J'ai la terrible impression qu'il peut lire dans mes pensées et deviner toutes les questions qui m'assaillent. J'évite soigneusement de regarder la cicatrice qui le défigure et lui rend son regard. Puis, même si je n'ai pas tout à fait terminé mon repas, je lui demande :
- Est-ce que Voel sait où je suis ?
- Il sait que tu es arrêté pour l'enlèvement de Mélisende. Mais il ignore que tu es ici.
- Pourquoi ne lui avez-vous pas dit ?
- Pourquoi je lui aurais dit ?
Parce que c'est Voel. Je me rends compte que, si c'est une évidence pour moi, lui ne le connait pas. Il vit seul, apparemment, et il est autant vulnérable à une attaque de villageois qu'à une attaque de tsiganes. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de noter qu'il sait parfaitement qui est Voel. A quel moment se sont-ils présentés l'un à l'autre ? Voel a-t-il pu apprendre quoi que ce soit concernant cet homme ? Et pourquoi …
- Je suis allé voir Voel après t'avoir ramené ici. Je devais l'interroger concernant la disparation de Mélisende. Et j'en ai profité pour l'informer de ton arrestation.
- Est-ce que tu sais si Gabor et Filippia ont pu rejoindre le campement ?
Le tutoiement n'est pas une maladresse de ma part. Il me tutoie bien, lui, sans se gêner, alors je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire. Les informations qu'il m'envoie, par son comportement et ses paroles, sont tellement contradictoires que j'ai besoin de le tester, d'en savoir plus sur lui. S'il me hurle après et me jette à nouveau dans cette cave lugubre, je saurai qu'il n'apprécie pas le tutoiement. Et avec un peu de chance, je mourrai étouffé au lieu d'être torturé. Sinon, eh bien, ça sera toujours ça de pris, ça mettra de lier un début de semblant de complicité. Son visage ne montre rien de sa réaction et il répond, comme si de rien n'était :
- J'ignore de qui tu parles.
- Les deux personnes qui m'accompagnaient quand tu nous as surpris en train de nous balader dans la forêt.
- Vous balader, hein ? Tu veux dire « poser des collets sur un territoire de chasse interdit », plutôt, non ?
Je pince les lèvres. Ce n'est pas comme ça que je vais réussir à le convaincre de mon honnêteté. Mais il passe outre ce détail sémantique et reprend :
- Oui, j'ai vu le grand costaud au campement. Voel ne s'inquiétait que de ta disparition, de toute façon, donc je suppose que tu étais le seul disparu.
- Et comment a-t-il réagi quand tu lui as annoncé mon arrestation ?
- Il m'a regardé. Pendant longtemps. Puis il m'a remercié.
- Tu crois qu'il a compris que tu l'as fait pour nous protéger ?
- Je ne vous protège pas. Je cherche juste à éviter que la situation s'envenime encore plus.
Je fronce les sourcils, perplexe. Mais je me garde bien de poursuivre sur ce sujet, j'ai mille autres choses à apprendre. Il hésite un court instant avant de me dire :
- Mais oui, je crois qu'il a compris pourquoi j'avais agi de la sorte.
- Est-ce qu'il t'a donné un message à me transmettre ?
- Non.
J'opine lentement. C'est normal. Cet homme ne fait pas confiance à Voel, ce qui peut se comprendre. Mais la réciproque est vraie. Voel ignore son rôle exact, il n'allait pas lui confier quoique ce soit. Moi aussi, d'ailleurs, j'ignore qui est cet homme en face de moi. Je prends une grande lampée d'infusion avant de me lancer :
- Je m'appelle Yoshka.
- Je sais.
J'attends qu'il poursuive, en vain. Je n'ai pas vraiment le temps de peser le pour et le contre, ma langue se met en mouvement toute seule, ma bouche s'ouvre, et je rétorque :
- La réponse correcte, entre personnes civilisées, c'est de répondre par une autre présentation.
Pour la première fois, il détourne le regard. Il ne se fâche pas, ne m'envoie pas paître, mais il détourne le regard pour le fixer sur le rebord de la table. Je l'ai touché. Mais je n'arrive pas à m'en réjouir. J'essaie de trouver un moyen correct pour me rattraper quand j'entends :
- Louh, je m'appelle Louh.
J'incline doucement la tête, amusé par le ton soudain gêné de sa voix. Je mesure pleinement ma chance : il m'a laissé le rabrouer sans broncher. Je poursuis sur ma lancée :
- Je suis conteur.
- Je suis boucher.
Il a mis un peu de temps à répondre, mais il l'a fait. Je suis convaincu qu'il voit clair dans mon petit jeu de présentations, destiné surtout à apprendre plus de choses sur lui. Sa réponse, pourtant, me fait frissonner. Les porcs, dans l'enclos dehors, le billot de boucher creusé par des années de découpe, tendent à prouver sa sincérité. Mais un boucher ne mène pas une enquête, un boucher ne vole pas les gens en taverne, et un boucher ne traque pas les braconniers. Un boucher, par contre, s'occupe de la torture et des châtiments, quand il n'y a pas de bourreau à demeure.
Il accepte de répondre à mes questions qui n'en sont pas mais il élude celles qui m'importent vraiment. Je prends trop de risques, c'est évident, mais cette discussion apaise mes angoisses. Cet homme menaçant, boucher et peut-être bourreau, qui fait trembler tous les villageois, parle avec moi. Et je suis toujours vivant. Alors peut-être que j'arriverais à l'amadouer. Peut-être que s'il me connaît mieux, il comprendra que je ne peux pas être coupable. Jouant maladroitement avec ma cuillère, je poursuis :
- Je suis aussi marionnettiste.
- Je suis l'homme de main du Seigneur du fief.
Il a mis encore plus longtemps à me répondre. Et s'il est toujours adossé à sa chaise, l'air nonchalant, je vois bien qu'il est plus tendu. Et pourtant, ça ne m'avance pas beaucoup. Ce rôle, bien que j'en comprenne les grandes lignes, ne m'est pas familier. Il faut que j'en découvre plus à ce sujet. Mais si je commence à l'interroger de but en blanc, il risque de m'opposer un silence buté. Et je veux m'assurer qu'il ne cache pas un lapin dans son chapeau. Après avoir bu la dernière lampée de mon infusion, je termine :
- Et je suis également un peu menuisier à mes heures perdues.
Il ne répond rien. N'a-t-il donc pas d'autre corde à son arc ? Quoiqu'il en soit, j'ai déjà bien assez à réfléchir avec ce qu'il m'a dit. Je suis sur le point de lui demander plus de précisions sur ce qu'il appelle « homme de main » quand il lâche du bout des lèvres :
- Et je suis également un peu assassin à mes heures perdues.
Le sang se fige dans mes veines. J'ignore s'il y avait de l'ironie dans le fait de répéter presque mot pour mot ma phrase. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est parfaitement sérieux. Et du peu que je sais de lui, je ne doute pas de son affirmation.
Il se lève souplement en évitant de me regarder, disparaît par la porte de la porcherie. Je me suis fait avoir. Les attentions qu'il a eu pour moi ne valent pas grand-chose. J'avais espéré pouvoir l'amadouer, me le mettre dans la poche. Lui faire comprendre que je suis bien trop gentil pour enlever une fille. Mais il n'est pas homme qu'on peut amadouer.
Je dois fuir. Il me laisse suffisamment de libertés pour que je puisse m'échapper. Il le faut. Je ne peux pas rester à la merci d'un assassin. J'ai bien conscience des conséquences d'un tel geste, mais la panique revient à la charge. Il n'est pas simple geôlier qui se contente de garder des portes closes en attendant de toucher sa solde.
Je cherche du regard une issue. Deux minuscules fenêtres, presque au ras du plafond, apportent un peu de lumière quand il fait jour dehors. Mais elles sont trop étroites pour qu'un homme puisse s'y glisser, sans parler de mon épaule blessée. Seules l'arche dans la falaise et la porte de la porcherie se présentent à moi. Y a-t-il une autre issue, au fond du réseau de grottes ?
Parce que foncer à travers la porcherie, avec lui dedans, serait une folie. Mais je peux toujours attendre qu'il vaque à ses occupations pour prendre la poudre d'escampette.
Tant pis pour la susceptibilité des villageois. Je ne peux pas rester seul, enfermé avec un assassin, alors que personne n'est au courant de ma présence ici.
Je suis au milieu de nulle part, sans aucune idée de l'emplacement de cette clairière par rapport au village. Mais je l'ai dit, je ne suis pas héros, je ne ferais pas face à Louh juste pour apaiser les tensions.
J'ignore si c'est possible mais je dois endormir sa méfiance. Je lui dois présenter le visage d'un homme inoffensif, prêt à l'aider dans son enquête. Lorsqu'il revient de la porcherie, je suis en train de débarrasser la table. Je gémis de temps en temps et ce n'est pas tout à fait de la comédie : mon épaule me fait mal. Comme je ne sais pas où il s'occupe de la vaisselle, j'ai tout posé sur le billot. Et forcément, il le remarque :
- La vaisselle sale ne va pas là.
Bon sang, il est encore plus froid et distant que tout à l'heure. Je me recule contre la table tandis qu'il déplace écuelles et couverts. Je gémis un peu plus fort. Il hausse un sourcil en me dévisageant.
- Tu ne peux pas bouger ton bras ?
- Non. C'est mon épaule.
- Et les doigts ?
Je remue un peu les doigts, difficilement mais sans que ce soit si douloureux que ça. Pourtant, je laisse échapper une plainte qui se veut déchirante. Il claque la langue contre le palais et assène :
- N'en rajoute pas.
Je reste silencieux. Ça ne va pas être facile. Il délaisse la vaisselle non loin de la cheminée et se dirige vers la chambre en disant :
- On va dormir maintenant. Viens.
Je réprime de toutes mes forces l'envie de regarder vers la porte de la porcherie. C'est trop tôt pour fuir, il ne me fait pas assez confiance. Et dehors, il fait nuit. Je ne suis pas déjà certain d'être capable de fuir dans la forêt en plein jour, alors en pleine nuit …
Je lui suis donc sans rechigner. Il a récupéré la lanterne et nous passons devant plusieurs grottes, comme je l'avais deviné : ici une réserve pour la nourriture, là-bas une réserve pour le bois, au fond, un doux bruissement me fait penser à la présence d'un point d'eau.
Il s'arrête devant une porte en bois, qu'il ouvre en me regardant. Un seul coup d'œil à l'intérieur me fait comprendre qu'il s'agit de la pièce où j'étais enfermé plus tôt. Je m'immobilise et les mots jaillissent spontanément de ma bouche :
- C'est vraiment obligé ?
- Oui.
- Cette pièce me met vraiment mal à l'aise. C'est tellement sombre et …
- Tu es en état d'arrestation, ne l'oublie pas. A moins que tu ne préfères que je te ficèle comme un saucisson et que tu dormes dans l'enclos des cochons.
- Je préfèrerais.
Je n'ai pas réfléchi à ma réponse, elle est sortie toute seule. Dans le silence qui suit, je réalise que je suis sincère : je préfèrerais encore dormir avec les cochons, ligoté, au risque de me faire dévorer, plutôt que de passer une nuit entière dans cette tombe. Il me dévisage. La flamme vacillante de la lanterne fait naître des reflets dans ses cheveux bruns mi-longs et dans ses iris si sombres. Sa cicatrice semble encore plus visible ainsi. Il reste immobile et silencieux, sans doute le temps de réfléchir. Ou de tester ma détermination.
- Très bien. Va chercher la paillasse, que tu puisses dormir dessus.
- Non. Tu vas en profiter pour m'enfermer à l'intérieur.
Je tente de masquer l'horreur que m'inspire cette idée. Je sais qu'il en serait capable. Et je ne veux pas revivre l'enfermement dans cette pièce. Je suis conscient, pourtant, des risques que je prends en m'opposant si franchement à lui. Et je n'ignore pas qu'il lui suffirait d'user de la force pour me contraindre à passer la nuit là-bas dedans. Je suis prêt à en assumer les conséquences. Si je n'ai qu'une infime chance de le voir accéder à ma requête, je dois tenter, quitte à ce qu'il s'énerve et fasse usage de violence. Mais il hausse les épaules sans piper mot, referme la porte puis regagne la cuisine. Je le suis à petits pas rapides, le cœur battant la chamade.
Je reste immobile, sous l'arche, tandis qu'il fouille dans son billot. Cette charogne va réellement me ligoter et me faire dormir avec les cochons. La peste soit cet homme.
Il extirpe une immense chaîne qui cliquète à n'en plus finir lorsqu'il la dépose sur la table de la cuisine. Il prend son temps, s'attendant sûrement à ce que je change d'avis et que je le supplie de le m'emmener dans cette geôle lugubre. Il peut toujours attendre.
Il dépose des cadenas sur la table, et une unique clef, ainsi qu'une longue barre en métal et deux anneaux. Je le regarde faire, comme un lapin piégé par un rapace et qui reste pétrifié. Il me fait m'approcher et j'obéis sans broncher. Il ramène mon poignet gauche juste au-dessus du droit, passe autour les anneaux en forme de U, puis fait coulisser la longue barre de métal dans les encoches prévues aux extrémités des anneaux. Il place un cadenas au bout de la barre en métal, le tout sans un mot. Je ne dis rien, moi non plus, j'en suis incapable. Mais j'ai conscience de ses précautions : il n'a pas touché à mon poignet droit, il sait que tout mon bras est douloureux. Et la barre métallique est à la verticale, alors que je l'ai toujours vue à l'horizontale. Je peux garder mon bras droit contre le corps, grâce à cette disposition. Et malgré ma situation pour le moins délicate, malgré les entraves qui me privent de ma liberté de mouvement, je me sens stupidement reconnaissant. C'est idiot, pourtant : je suis à la merci de cet assassin, vulnérable. Je n'aurais sans doute guère plus de chances si j'étais libre de mes mouvements, mais le poids de ces menottes me glace les sangs et me fait pleinement réaliser ma situation. Je dois le fuir. Je dois m'éloigner de lui avant qu'il ne finisse de poser ces entraves. Tant pis pour la nuit noire, tant pis si je reste à errer dans la forêt pendant des jours. Je dois fuir. Mais alors que mon regard se tourne vers la porte de la porcherie, il déclare de sa voix glaciale :
- Ne fais rien de stupide.
Il n'a pas besoin de rajouter une menace, je l'entends dans sa voix, je la lis dans sa posture. Il me toise un moment et je me retrouve à acquiescer vivement. Il laisse tomber la longueur de la chaîne sur les dalles irrégulières du sol. Puis il s'agenouille, entoure ma cheville gauche avec l'extrémité de la chaîne, place un cadenas dans les maillons, puis répète l'opération pour la cheville droite. Il s'écarte de moi, la chaine à la main, et va glisser l'autre extrémité dans un anneau scellé dans le sol, non loin de la cheminée.
Il quitte soudain la pièce sans un mot pour moi, lanterne à la main, me laissant seul avec la lumière vacillante du feu dans la cheminée pour toute compagnie. Il revient, quelques minutes plus tard, en traînant la paillasse derrière lui. Il la laisse tomber à mes côtés, toujours silencieux, rajoute une bûche dans la cheminée, et disparaît dans la chambre avec la lanterne.
Je reste immobile un long moment, me demandant s'il va revenir ou non. Mais le temps passe et il ne revient pas. Alors, tout doucement, je m'installe comme je peux sur la paillasse. Je n'ai pas beaucoup de liberté de mouvement mais c'est toujours mieux que cette pièce sordide. J'ai de la lumière. J'entends les cochons qui remuent, un peu, dans leur paille, de l'autre côté du mur. Les yeux rivés au plafond en bois, regardant les mouvements dansants de la lumière des flammes, je m'interroge. Sur mon avenir, sur les miens restés au campement. Et sur cet homme en noir qui ne cesse de me surprendre.
Âprefond, chapitre 4
Voici donc un nouveau chapitre ! Je vous propose, comme musique d'accompagnement, bratsch - sari siroun yar. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente lecture !
Je suis incapable de bouger ou même de respirer. Les grains de poussière qui dansaient dans les rayons du soleil filtré par le feuillage du chêne centenaire, au centre de la place, se sont figés. Le chien qui dormait sur le seuil d'une maisonnette a redressé la tête, alarmé. Dans le calme inquiétant de la place, la voix glaciale de l'homme en noir semble résonner comme un coup de tonnerre :
- Je m'en occupe.
Sa déclaration me fait l'effet d'un coup de fouet. J'ignore ce qu'il entend par « s'en occuper » mais je redoute le pire. Je l'imagine mal compréhensif ou délicat : je le vois plus tabasser puis poser les questions ensuite. Un rapide coup d'œil à Filippia et Gabor et nous nous remettons en chemin : les premiers villageois rebroussent chemin, sans doute aussi impressionnés que nous. Inutile de se faire voir. Nous nous engageons dans la première ruelle venue et nous nous éloignons à grand pas, oublieux de notre chargement et de la douleur aux pieds. Nous restons silencieux alors que les maisonnettes aux volets usés par le temps défilent. Nous ne croisons que quelques chiens, des chats qui cessent leur toilette pour nous regarder passer. J'ignore où sont passés tous les gens mais j'apprécie ce calme : qui sait ce qu'ils pourraient faire s'ils nous voyaient là ?
Situé à la sortie du village, l'atelier du forgeron n'a pas sombré dans la torpeur générale. Je m'immobilise devant l'entrée, marquée par un portillon en piteux état. Contre l'avis de Gabor, qui devine mes intentions, je pousse l'assemblage de bois et je m'avance dans l'atelier. Le théâtre de marionnettes est resté dehors, sous la surveillance de Gabor et Filippia, et je sais que je dois être rapide.
C'est une montagne de muscles, ruisselante de sueur, qui m'accueille d'un regard peu engageant. L'homme n'est plus tout jeune mais encore bâti comme un taureau. Il poursuit son ouvrage, frappant de grands coups de marteau sur la pièce rougeoyante. La forge est installée sous un auvent, à l'abri des intempéries mais au grand air. Le temps qu'il finisse, j'observe les nombreux instruments soigneusement alignés contre le mur du fond, les articles déjà forgés, ceux en attente de réparation. Mais je n'arrive pas à voir nos essieux. Il n'interrompt son travail que lorsqu'il a terminé de façonner ce qui ressemble à un socle de charrue et qu'il le jette dans une cuve d'eau.
Tandis que l'eau crépite et dégage des nuages de vapeur, il se tourne un regard noir vers moi. Je déglutis, pas vraiment rassuré mas je dois savoir, alors je m'éclaircis la gorge et demande d'une voix ferme :
- Bonjour. Je voudrais savoir où en est la réparation des essieux.
Je ne me présente pas, il n'ignore pas qui je suis. Il a parfaitement compris de quoi je voulais parler, puisqu'il me répond d'une voix rocailleuse :
- Pas terminée. Et la réparation est en suspens.
Je plante mon regard surpris dans le sien. J'entr'ouvre la bouche pour lui demander des explications mais il me devance. Dans un grognement, il continue :
- Tu crois que je ne suis pas au courant ? Je ne reprendrai pas la réparation tant que nous n'aurons pas retrouvé cette vache.
Je referme la bouche : son raisonnement est plein de bon sens, même si c'est à nos dépens. Je tente tout de même :
- Vous ne pourriez pas au moins terminer ? Et nous ne viendrons les chercher que lorsque cette vache sera retrouvée ?
- Pour que vous veniez les voler à la nuit tombée ? Pas question. Je garde les essieux en l'état.
Il va appuyer sur l'énorme soufflet et les braises rougeoient de plus belle. Puis il attrape une pièce de métal qu'il jette dedans. Sa manière à lui de m'annoncer que la discussion est close. Je devine que je n'ai aucun intérêt à essayer de la relancer, ni à expliquer que ce ne serait pas du vol, si nous les reprenions, puisqu'ils sont à nous et que les réparations sont payées d'avance. Comme je le disais, je ne suis pas un héros.
Je quitte donc l'atelier, rejoins Gabor et Filippia. Je leur résume, à voix basse, les paroles du forgeron. Ils ne font aucun commentaire, se contentent d'une moue qui veut tout dire, et nous reprenons notre chargement. Nous quittons enfin le village et, alors que nous marchons sur la route de terre, je me perds dans mes pensées. Le village est juché sur un promontoire et cerné par des champs verdoyants. Des haies soigneusement entretenues, faites de buissons et de petits arbres, délimitent les cultures. La route principale, rendue chaotique par le passe régulier des hommes et des charrettes, serpente à travers les prés en une pente douce jusqu'à la rivière. Non loin, notre campement est parfaitement visible, dernier rempart humain avant l'immense forêt qui couvre une bonne partie des terres. Seule ombre au tableau, le château, sombre et menaçant, qui domine les lieux, loin sur ma gauche. Ce fief est un écrin de verdure, bercé par le chant des oiseaux, un endroit où je me serais bien vu rester plusieurs jours, voire quelques semaines. Mais la rumeur enfle déjà, et je pressens que ce paysage qui s'étale sous mes yeux ne sera bientôt qu'un beau souvenir.
Quittant la route, nous foulons l'herbe haute pour rejoindre nos roulottes, installées en un cercle approximatif. Au centre, le feu n'est pas encore allumé, mais tous sont en train de déjeuner, assis sur des rondins de bois, quelques chaises sorties des roulottes ou encore sur des pierres. Les enfants se précipitent vers nous en piaillant, réclamant un récit complet de notre matinée. Filippia les renvoie gentiment à leur repas, tandis que Gabor et moi allons poser la caisse vers notre roulotte. Filippia remet à Voel la recette de la matinée, puis nous allons nous servir dans la marmite posée à même le sol.
Nous arrivons tard, alors nous nous dépêchons d'engloutir le ragoût de truite mitonné par Djidjo, appréciant à peine les saveurs qui régalent pourtant nos papilles.
Les écuelles vides, nous nous approchons de Voel pour lui rapporter ce que nous avons vu et entendu. Alors, en quelques phrases, il explique la situation à l'ensemble du campement. Puis il donne ses consignes : nous devons absolument terminer nos réparations cet après-midi. Les femmes et les enfants se chargent de ranger tout ce qui n'est pas indispensable à notre quotidien. Et tous doivent se préparer à recevoir des visites, pas forcément amicales.
Nous terminons toujours nos repas par quelques discussions ou plaisanteries poussives. Mais les consignes de Voel ont jeté un froid, et nous nous dispersons tous pour vaquer à nos occupations.
Gabor et moi allons ranger le théâtre dans la roulotte puis nous nous rendons à nos postes respectifs. Gabor va aider Voel à réparer les coussinets et les jointures des jougs. Nos bœufs nous sont très précieux et nous prenons grand soin des jougs qui leurs permettent de tirer nos roulottes. Le travail du cuir demande force et précision, ce qu'à eux deux, ils réunissent.
Je me rends à la roulotte de Ysayo, où des tréteaux supportent les nombreuses pièces de bois à réparer et entretenir. Je ne me perds pas dans mes pensées cet après-midi : le travail doit être terminé et il n'est pas question de gaspiller la moindre minute. Ysayo en est bien conscient et me donne des ordres bref, que j'exécute sans tergiverser.
Notre labeur est interrompu quelques heures après avoir commencé, lorsqu'une étrange tension parcourt le camp. Nous nous redressons dans un même ensemble et je frissonne en voyant l'homme en noir s'avancer au milieu de nos roulottes. Il pénètre dans notre intimité, foulant l'herbe haute, sous des dizaines de regards. Et pourtant, il fait preuve de la même assurance et de la même détermination que lorsqu'il est rentré dans la taverne l'autre jour. Il n'hésite pas, ne regarde pas autour de lui. Il marche droit vers Voel, les bras le long du corps, prêt à se saisir de ses dagues. Les mots qu'il prononce sont inaudibles d'où je suis, mais je vois Voel acquiescer et se diriger vers l'enclos des bœufs.
Je connais assez Voel pour deviner, à travers ses gestes, son intimidation. L'homme en noir examine nos animaux, observe les poules, puis échange encore quelques paroles avec Voel. Puis il repart comme il est venu, sûr de lui et ne craignant rien ni personne.
Voel retourne à ses occupations : c'est la fin de l'intermède. Nous en saurons plus à la veillée. Jusqu'à la tombée de la nuit, nous scions, ponçons, ajustons, clouons et fixons du bois. Et lorsque la lueur dansante du feu ne nous permet plus de poursuivre, Ysayo me sourit. Nous avons quasiment terminé. Épuisés, nous dînons dans un silence inhabituel. Voel ne nous apprend pas grand-chose. L'homme en noir est venu, a examiné nos animaux et les a comptés, a interrogé Voel sur nos activités puis s'en est allé.
Ce soir-là, je ne raconte pas l'histoire de Jehan le preux chevalier. Parce qu'aucun villageois n'a osé nous rejoindre. Nous passons une soirée calme, rythmée par une musique mélancolique qui parle de contrées lointaines où nous sommes toujours les bienvenus. Où personne ne nous regarde de travers. Où la fête, les rires, les chants et les danses sont permanents.
Minuit est encore loin quand toutes les roulottes sont fermées pour la nuit. Lorsque je retire mes bottes, je découvre sans surprise mon gros orteil violacé et gonflé. Demain, je demanderai à Filippia un peu de son baume contre les contusions. Pour l'heure, même si j'ai pas la tête à ça, je dois me reposer. Ysayo, Voel, et Isaï, le mari de Filippia, se relayeront pour monter la garde et s'assurer que personne ne vient mettre le feu à notre campement.
Ce serait un mensonge de dire que j'ai bien dormi. Mon sommeil a été troublé par des visions cauchemardesques, remplies de feu et de silhouettes noires hostiles. Je me réveille en sueur, à la pointe du jour. Je quitte rapidement les draps chiffonnés pour apaiser mes angoisses sous le soleil matinal. Je suis loin d'être le premier levé, et je ne suis pas le seul à avoir la mine brouillée.
Je me change et fais un brin de toilette pour chasser les derniers vestiges de mes cauchemars. Mon orteil me fait mal, mais Filippia est en train de s'occuper de la vieille Illmiya et je n'ose pas me plaindre d'une douleur aussi ridicule : notre doyenne est en fin de vie et Filippia l'apaise comme elle peut. Je leur adresse un petit sourire réconfortant avant d'aller rejoindre les autres autour du feu.
Le petit-déjeuner se fait dans le silence. Même les enfants, conscients de la tension, restent auprès de leurs mères sans chahuter. Nous ne nous attardons pas et chacun reprend ses activités, la mine sombre. Ysayo me fait savoir qu'il n'a pas besoin de moi, pour ce matin, et qu'il pourra bien terminer tout seul. Filippia, par contre, a vraiment besoin de plus de plantes, notamment de houx, de bardane et d'un autre nom étrange, pour Illmiya. Nous ne savons pas quand nous pourrons partir et ça peut être dans plusieurs jours. Et d'expérience, nous nous attendons à ce que la tension augmente encore. Nous n'y sommes pour rien, dans ce vol, et ils ne trouveront pas la vache chez nous. Et comme nous ne pouvons pas repartir tant qu'ils ne l'auront pas récupérée, leur hostilité va aller crescendo. C'est donc maintenant ou jamais que nous devons ramasser ce dont nous avons besoin hors du campement. Plus tard, ça sera sans doute trop dangereux. Et même une fois partis, nous ne pourrons pas nous arrêter dans le prochain fief. Si nous sommes, dans le meilleur des cas, innocentés de ce vol, la rumeur se sera répandue au-delà des frontières d'Âprefond.
Voel le sait, et c'est pour ça qu'il nous missionne, Gabor, Filippia et moi, pour aller chercher autant de bois mort et d'herbes que nous pouvons. Nous devons être rentrés pour le déjeuner et faire preuve de la plus grande prudence. Interdiction formelle de s'approcher du village ou des champs cultivés et interdiction formelle de s'enfoncer trop profondément dans la forêt.
Nous progressons donc lentement, remplissant nos paniers de bois au fur et à mesure, surveillant le chant des oiseaux qui nous avertira des dangers. Filippia est concentrée et empressée. Tellement empressée, même, qu'elle s'entaille l'index en coupant une poignée de saponaire. Elle laisse échapper un petit cri alors que le sang ruisselle le long de son doigt. Gabor, protecteur, se précipite pour évaluer les dégâts, bien qu'il soit parfaitement incompétent dans le domaine. Je m'approche aussi, inquiet pour notre guérisseuse.
Sa coupure ne semble pas profonde, bien qu'elle saigne beaucoup. Filippia tente de nous rassurer, nous expliquant que c'est normal avec les doigts. Gabor ne semble pas convaincu et je dois avouer que je ne le suis pas beaucoup plus. Filippia enroule un morceau de tissu autour de son doigt et nous presse de terminer notre récolte au plus vite.
Mais soudain, je réalise que les oiseaux ne chantent plus. Une fraction de seconde plus tard, un craquement sonore résonne entre les troncs d'arbres. Puis tout va très vite. Je leur hurle qu'il faut partir. Je crois même que je pousse Gabor, comme pour lui donner de l'élan. Mais c'est trop tard. La première pierre m'atteint à la poitrine, tandis que des beuglements hostiles se font entendre. Les villageois nous ont trouvé, ils émergent par petits groupes entre les arbres. Nous courrons. Nous détalons comme des lapins, zigzaguant entre les bosquets, sous une pluie de pierres. Instinctivement, nous nous séparons : nous serons une cible moins facile. J'ai laissé mon panier sur place. Tandis que je galope sur l'humus, je pense, bêtement, qu'il faudra revenir le chercher, plus tard. Je ne vois plus Gabor ni Filippia. Je perçois juste leur présence, non loin. Je m'étonne de la présence des villageois ici, comme s'ils nous attendaient. Mais je ne cherche pas à en connaître la raison, je fuis. Des ronces se prennent dans mes chausses, des branches basses fouettent mon visage. Je ne ralentis pas. Les villageois ont soif de sang et je préfère savoir le mien dans mes veines.
Je ne vois pas la racine de l'arbre qui me fait trébucher. Je sais juste que, emporté par mon élan, je m'écroule au sol et qu'une douleur fulgurante explose dans mon épaule. Je me relève tant bien que mal. J'ai l'impression de sentir le souffle des villageois sur ma nuque. Dans mon esprit, ils se sont transformés en une horde sanguinaire et impitoyable. Je sens leur haine me cerner, chercher à me retenir. La panique me fait perdre le souffle et fait danser des points noirs devant mes yeux. Ou peut-être est-ce la douleur à l'épaule. Une autre pierre m'atteint au bas du dos, me faisant glapir.
Je glisse soudain. Des feuilles mortes, peut-être. Je ne sais pas. Ma tête cogne violemment contre le sol. Je dois me relever. Je dois fuir. Je dois …
J'émerge difficilement. Mes paupières se soulèvent lentement, comme si elles étaient lestées de plomb. Je dois les faire cligner plusieurs fois avant de comprendre ce qu'il se passe. L'obscurité est totale. J'essaie de porter ma main aux yeux mais je m'arrête dans un gémissement. Des élancements de douleur partent de mon épaule, gagnent mon cou, mon bras. Puis la tête, la poitrine, le bas du dos, les genoux, le gros orteil se rappellent à mon bon souvenir. Tout mon corps est douloureux, à des degrés divers.
Je ferme les yeux, avale ma salive. Lentement, je fais le point. Ce ne sont que des hématomes, contrecoup des chocs reçus. Rien de bien grave. Mon épaule m'inquiète un peu plus, car j'ai vraiment du mal à bouger le bras. Quant à ma tête... Précautionneusement, je lève la main gauche jusqu'au point le plus sensible. Je sens déjà une bosse énorme, mais pas de sang. Est-ce pour ça que je suis aveugle ?
Je laisse retomber ma main, qui se pose sur une matière rêche. Je la palpe, l'examine du bout des doigts. Ça craque un peu mais c'est assez malléable. Mon esprit peine assembler les informations que recueillent mes doigts. Puis soudain, c'est le déclic. Je suis allongé sur une paillasse.
Les battements de mon cœur s'affolent mais je tente de garder la tête froide. Je passe en revue toutes nos roulottes, toutes nos possessions. Non, nous n'avons rien de semblable, au campement. Et puis, ce silence, lourd, absolu, ne correspond pas. Il y a toujours une poule pour caqueter, un chien pour japper, un gamin pour brailler, un instrument pour chanter. Mais là, rien. Le choc à la tête m'aurait-il rendu sourd également ?
Où suis-je ?
Je bascule lentement sur mon séant. La douleur pulse dans mon crâne. Les perles dans mes cheveux résonnent comme un grondement de tonnerre. Je suis à même le sol, libre de mes mouvements. Je garde toutefois le bras droit contre mon torse, pour épargner mon épaule. Le gauche se tend et mes doigts entrent en contact avec le sol. Lisse, doux, froid et un peu humide. Je sollicite mon esprit pour qu'il l'identifie, mais c'est visiblement trop lui en demander. Alors je porte mes doigts jusqu'au nez, renifle. De la terre battue. Mon odorat semble enfin vouloir se montrer coopératif et m'indique que toute la pièce sent la terre et l'humidité.
Où suis-je, bon sang ?
Si je suis dans des geôles, pourquoi n'y-a-t-il pas la moindre lumière ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas entendre des éclats de voix de gardiens, des cliquetis de clefs ou de chaînes ? Et pourquoi ai-je le sentiment d'être enterré vivant ? J'essaie de juguler la panique qui monte en moi. Je veux me lever, je veux connaître la taille de la pièce. Mais la sentence de mon corps est sans appel : ce n'est pas possible. Alors je me traîne tant bien que mal par terre, grimaçant lorsque le sol frotte trop contre mes contusions. Un obstacle se dresse soudain contre moi. Ma main gauche, avide, part à sa rencontre pour le palper. Une matière douce, comme polie, sans aspérités ni rainures. Je pose mon front contre, c'est frais et agréable. J'inspire de toutes mes forces. Mais je n'arrive pas à identifier la matière.
Mais où suis-je, ventre-dieu ?
Soudain, un bruit se fait entendre. Il me vrille les oreilles, habituées au silence. Un cliquetis. Une clef qui tourne dans une serrure. Un grincement léger. Puis une lumière insoutenable me brûle les yeux.
Je me recroqueville contre ce mur étrange, protège mes yeux de l'agression avec le bras gauche.
Le silence, à nouveau.
Lentement, je baisse mon bras. Quelques secondes encore et la lumière intense m'apparaît comme ce qu'elle est réellement : une lampe à huile, à la flamme chiche et vacillante. Elle pend à un crochet fixé dans le cadre de la porte. Une porte en bois plein, usé par le temps.
Un mouvement sur ma droite me fait sursauter. L'homme en noir vient de déposer un pichet au sol et s'apprête à partir.
- Où suis-je ?
Ma voix n'a jamais été aussi rauque et faible. J'avale à nouveau ma salive. Je suis sur le point de poser à nouveau la question, de crainte qu'il ne l'ait pas entendue, quand il tourne lentement sur lui-même. Il se tient dans l'encadrement de la porte, immobile, le visage sévère et les yeux assassins. Et d'une voix dénuée de toute émotion, il m'indique :
- Tu es en état d'arrestation.
Ses mots se frayent lentement un chemin dans mon esprit. Trop lentement. Je fonctionne au ralenti, je n'ai pas les idées claires. Il tend la main vers la lanterne, considérant la discussion close. Je ne veux pas qu'il parte avec la lumière. Je ne veux pas être à nouveau enterré vif. Alors je demande, un peu plus fort :
- En état d'arrestation ?
- Oui. Comme je l'ai dit.
- Pour la vache ?
Il s'immobilise, s'adosse au chambranle de la porte, croise les bras sur sa poitrine. Puis il me dévisage pendant de longues secondes, agacé, avant de répondre :
- Pour enlèvement.
- Pour enlèvement de vache ?
Un frémissement agite sa lèvre supérieure, signe de contrariété, je suppose. Il laisse le silence s'étendre entre nous avant de s'expliquer :
- Pour l'enlèvement de Mélisende, jeune fille de quatorze printemps, qui a disparu depuis hier au soir.
Cette déclaration me fait l'effet d'un coup de fouet. Je me penche vivement vers lui, soudain parfaitement lucide, oublieux de mes douleurs et débite :
- Quoi ? Une jeune fille ? Non. Non, non, non ! Ce n'est pas possible ! Je n'y suis pour rien, je vous jure. Autant une vache, je pourrais comprendre, mais une jeune fille …
- Tu avoues avoir volé la vache ?
- Non. Je n'ai rien volé. Rien du tout. Je vous le jure sur la Sainte Croix. Mais... une jeune fille, sérieusement ? Au moins, la vache servirait à quelque cho...
Je me mords les lèvres tandis qu'il hausse un sourcil. Je ne suis peut-être pas aussi lucide que ça, finalement. Il reste de marbre, silhouette silencieuse et sévère. Alors, en pesant chacun de mes mots, j'essaie de me rattraper :
- Je n'ai rien volé. Nous n'avons rien volé. Pourquoi aurions-nous enlevé une pauvre jeune fille ? Pourquoi l'arracher à l'amour tendre de ses parents ?
- Pour la marier de force à l'un d'entre vous ? Toutes les femmes de votre groupe sont prises. Il n'y a que deux célibataires, parmi vous. Il vous faut de la chair fraîche.
J'ouvre la bouche, prêt à rétorquer, à me justifier. Et je la referme tout aussi vite, avant de dire une connerie plus grosse que moi. Il se détache du chambranle, attrape la lanterne et, sans me regarder, m'annonce :
- J'ai à faire. Je reviens plus tard.
Et sans attendre, il quitte la pièce et referme la porte derrière lui, me replongeant dans le noir. Je ne le retiens pas. Ses explications m'ont assommé. Et comment pourrais-je le retenir, de toute façon ?
Il me faut du temps pour pouvoir réfléchir à nouveau. Je me souviens de la poursuite dans la forêt, de la chute. J'ignore pourquoi ils étaient dans la forêt à nous attendre. J'imagine qu'ils ont délaissé les travaux aux champs pour aider les parents de la jeune fille et organiser une battue pour la retrouver. Ou peut-être qu'ils ont organisé une battue pour nous attaquer et se venger. Qu'importe, le résultat est le même, ils étaient là-bas, et nous aussi. Je suppose que les villageois m'ont rattrapé et, après m'avoir frappé à loisir, m'ont remis à l'homme en noir. De là, je me suis retrouvé, inconscient, dans ces geôles. Des geôles souterraines, situées dans des grottes. Car grâce à la lumière, j'ai pu voir les murs luisants, polis par l'humidité. Je sais quasiment où je suis.
L'homme en noir m'a dévoilé une information très importante : je suis en état d'arrestation. Pas « vous êtes ». Donc normalement, Gabor et Filippia ont pu fuir jusqu'au campement. Je l'espère de tout mon cœur. Ils ont pu se placer sous la protection de Voel. Et nous sommes trop nombreux pour que les villageois osent s'en prendre directement au campement. Du moins, j'espère que leur désespoir ne les conduira pas à une telle extrémité. Et j'espère que les miens ne commettrons pas de folie pour me récupérer.
L'homme en noir a visiblement mené son enquête. Il sait beaucoup de choses sur nous, beaucoup trop à mon goût. Il a dû aller au campement, poser ses questions, fouiner dans nos affaires. Et peut-être même a-t-il annoncé à Voel que j'étais en geôles. Je prie pour qu'il l'ait fait. Voel s'inquiètera pour mon sort, mais il ne se retournera pas les sangs en m'imaginant à la merci des villageois, loin de toute autorité. Car même si je n'arrive pas à déterminer le rôle exact de cet homme en noir, je suis désormais convaincu qu'il représente une forme d'autorité. Il semble être impliqué dans les affaires qui nous concernent, quasiment comme un enquêteur. Et s'il a employé ce terme, « état d'arrestation », c'est bien qu'il a les pouvoirs pour arrêter quelqu'un. Non ?
Je prends de longues inspirations pour essayer de me calmer. Ces déductions étaient apaisantes, elles me permettent de savoir où j'en suis. Mais elles ne résolvent pas le problème principal : je suis accusé d'enlèvement de jeune fille.
Une vache est une denrée précieuse. Elle coûte très cher à l'achat mais offre, à son propriétaire, du lait, des veaux parfois, et de la viande. Voler une vache est un crime et le châtiment est de couper une main du voleur. Je réalise que j'aime bien mes deux mains, sans distinction. Elles me sont précieuses pour jouer du cistre, pour poncer le bois, pour manipuler les marionnettes. Mais si la situation devenait inextricable, si être reconnu coupable pouvait ôter la suspicion qui règne sur nous tous et si ça nous permet de quitter cette fichue vallée, alors je suis prêt à perdre une main.
Mais un enlèvement de jeune fille... Elle est vierge, à tous les coups, et ça ne fera qu'aggraver la sentence. Les braves gens vont imaginer cette Mélisende aux prises à un groupe de tsiganes, battue, violée, engrossée sans répit. Ils vont s'indigner, réclamer justice. Réclamer ma tête.
Et que puis-je dire pour ma défense ? Que je suis innocent ? Ils ne me croiront pas. Nous ne sommes pas seulement des voleurs, nous sommes aussi des menteurs, c'est bien connu. Alors non, ils ne me croiront pas si je leur dis que je n'ai pas touché cette fille et que j'ignore où elle est. Et si par malheur, je leur disais que non, jamais je n'enlèverais une femme, parce qu'ils n'y a que les hommes que j'ai envie de couvrir de caresses, alors je serais condamné pour bougrerie. Je serais torturé, au mieux. Et ils chercheront un autre coupable parmi les miens.
Le silence oppressant et l'obscurité se liguent pour attiser ma panique. Mon errance va prendre fin ici, à Âprefond, charmante petite vallée luxuriante, dans des souffrances inimaginables. La torture du bougre, à laquelle nous avions assisté contre notre gré il y a des années, me revient à l'esprit. Je chasse de toutes mes forces ces images qui hantent encore mes cauchemars, mais elles reviennent inlassablement. Je me bouche les oreilles pour ne pas entendre ses hurlements, je ferme les yeux pour évincer les images. En vain.
La terreur me submerge. Mon ventre se noue douloureusement, ma gorge semble être prise dans un étau. Ma poitrine est si compressée, soudain, que je peine à respirer. Je hoquète, sanglote, m'étrangle. L'air n'arrive plus dans mes poumons. Et je me sens partir.
Âprefond, chapitre 3
Voici donc, comme prévu, un nouveau chapitre ! Je triche un peu avec la proposition de musique, cette fois, puisque le chanteur n'est pas vraiment tsigane. Je triche aussi en vous proposant deux chansons, la première parce que je l'ai découverte en écoutant la seconde et qu'elle est parfaitement adaptée. La seconde, parce que si elle n'est pas tsigane, elle colle parfaitement au texte (et que je l'aime beaucoup). Bref, je vous propose donc Charles Aznavour, Les deux guitares 1997, et Charles Aznavour, Les comédiens.
Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente lecture ! N'hésitez pas à me donner vos avis ;)
Ma respiration se bloque l'espace de quelques instants avant de repartir. Mon front s'est couvert de sueur et entre mes doigts, la pierre tremble. Est-ce l'homme en noir qui leur a demandé de me transmettre ce message ? Est-ce qu'il souhaite, par ce geste, montrer qu'il peut nous atteindre à tout moment ? Nous prouver qu'il n'est pas seul, comme nous le pensions et l'espérions, mais qu'il a de nombreux complices ?
- Il y a un problème ?
Le villageois a parlé un peu trop fort, sans doute pour attirer mon attention. Je sursaute, secoue doucement la tête, scrute la mère qui serre désormais son fils contre ses jupes, le père qui semble craindre que ce cadeau me déplaît. Face à cette scène, je décide d'être honnête et je murmure :
- C'est ce H. Il m'a fait penser à l'homme que nous avons vu, hier, à la taverne.
Ils se penchent sur les veinures de la pierre, intrigués. Puis l'homme, du bout des lèvres, chuchote :
- On n'a pas pensé à mal, messire, on sait pas lire et on savait pas que ces lignes représentaient une lettre.
Il semble tellement sincère que je ne doute pas un seul instant de son honnêteté. D'autant plus qu'il poursuit, inquiet :
- Vous avez déjà eu affaire à lui ?
- Dieu merci, non ! Mais vous le connaissez ?
Ils s'approchent de moi d'un même mouvement, et c'est la femme qui me répond dans un murmure :
- Tout le monde le connaît ici. Et tout le monde sait qu'il faut l'éviter.
- Est-ce un brigand ?
- Non point. Cet homme est un funeste présage, qui apporte de terribles ennuis dès qu'on l'aperçoit. Il ...
Mais son mari l'interrompt brusquement :
- Tais-toi, Agathe, tu sais bien que parler de lui attire son attention.
La jeune mère se signe plusieurs fois et ne pipe plus mot. L'homme se redresse, s'éclaircit à nouveau la gorge, et m'assure :
- On savait pas pour la lettre. Jetez-la si vous préférez, on vous apportera autre chose demain soir.
Le gamin esquisse une moue déçue, et je secoue doucement la tête. D'une voix assurée, je lui explique :
- Dans certaines cultures, pour se protéger du Malin, ils gravent son image sur du bois ou de la pierre et la brandissent en cas de danger. Le Malin, horrifié par cette vision de lui-même, s'enfuit alors en courant. C'est une puissante protection que tu m'offres là, Jehan. Mille mercis pour ce cadeau précieux.
Parce que ce sont des gens simples et ignorants, parce qu'ils espèrent tant que ce cadeau me plaise, ils sourient de soulagement. Je serre ma main autour de ce fichu caillou et le glisse ostensiblement dans ma bourse. Après les banalités d'usage, ils s'éloignent à pas vif et je devine une discussion houleuse entre les deux adultes.
Après un signe en direction de Voel, je me dirige vers ma roulotte et m'allonge sur mon lit. Je n'ai pas agi consciemment mais je me retrouve avec cette pierre entre les doigts, à la regarder sans la voir. Je suis un ignorant, moi aussi. J'ai menti effrontément à cette famille démunie, pour leur éviter de m'offrir autre chose et pour ne plus voir cet air malheureux sur le visage du gosse. Je suis presque persuadé que si le Malin regardait une image de lui, brandie pour le chasser, il comprendrait qu'il est face à l'un de ses adorateurs. Et pourtant, j'ai terriblement envie de croire que ce caillou peut nous protéger. Plus qu'envie, en réalité : j'ai besoin de le croire.
Cet homme en noir est connu des villageois. De toute la vallée sans doute. Ses exactions sont telles qu'ils redoutent même de parler de lui. Et pourtant, ils ne font rien contre lui. Ils n'en parlent pas à leur Seigneur. Pourquoi ? Qui est-il ?
Nous n'avons pas vu le Seigneur, quand nous sommes arrivés. En voyage, d'après son conseiller. Mais cet homme en noir ne peut pas être le Seigneur du fief. Il n'a rien d'un noble, ni l'allure ni les manières ni même le visage. Il ne rôderait pas dans la forêt ou autour du camp à la nuit tombée. Et il ne dépouillerait pas ses gens dans la taverne.
S'il est un simple bandit de grand chemin, pourquoi oeuvre-t-il seul? Et pourquoi le Seigneur des lieux renie-t-il son devoir en ne protégeant pas les villageois de cette menace ? Et si cet homme …
Un choc soudain me fait bondir. Du moins, je tente de me redresser, en vain. Un oreiller m'étouffe et un poids incroyable pèse sur ma poitrine. Mon cri est assourdi, mes tentatives pour me libérer ne servent à rien. Mais alors que la panique est sur le point de me submerger, l'oreiller disparaît soudain. Et je me retrouve face à la figure hilare de Gabor.
Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je jure comme un charretier en me redressant. Et je lui assène un coup de poing dans l'épaule, de toutes mes forces, tout en l'insultant.
Il éclate de rire, comme s'il n'avait même pas senti mon coup. Puis d'une voix pâteuse et bredouillante, il décrète :
- Tu manques de vigilance, soudard.
Il rit tout seul de sa blague, faisant allusion à ce jeune homme, rencontré quelques jours plus tôt lors de notre périple. Nous avions parcouru un bout de chemin avec une troupe de mercenaire, dont le plus jeune membre était le souffre-douleur de la compagnie. C'est fréquent, chez les mercenaires, ils le testent. Et l'arrivée d'une nouvelle recrue mettra fin à cette situation. Rite de passage, ils lui faisaient faire toutes les corvées. Il était toujours le premier levé, le dernier couché, et n'avait pas une minute de répit. Un soir que nous discutions autour d'un feu de camp, je l'observais du coin de l'œil. Tous les mercenaires étaient couchés, et lui s'était écroulé comme une masse, endormi à peine sa cape posée autour de ses épaules. Mais en réalité, ses compagnons ne dormaient pas et ils s'étaient levés pour l'étouffer à l'aide d'un tapis de selle. Je l'avais vu se débattre de toutes ses forces, inutilement, jusqu'à ce que le meneur fasse un geste. Une fois le tapis retiré, il lui avait reproché son manque de vigilance. J'aurais aimé pouvoir faire quelque chose pour lui, l'aider d'une manière ou d'une autre. Mais je ne pouvais pas.
Gabor a perdu son sourire et c'est d'une voix mauvaise qu'il me demande :
- Tu te serais bien engagé, hein, rien que pour forniquer avec ce soldat ?
- Va te coucher, Gabor, tu dois dessouler.
L'odeur de vinasse a envahi tout l'habitacle. Je me rallonge et me recroqueville sous les draps. Gabor ivre est une vraie plaie. Il est au courant de ma préférence pour les hommes. S'il ne dit rien à ce sujet quand il est sobre, ou juste quelques allusions, il devient plus loquace après plusieurs verres. Bien que nous nous aimions comme deux frères, il a du mal avec cette partie de ma personnalité. Et quand il me susurre des propos graveleux, de son haleine avinée, je devine son dégoût et son mépris.
C'est avec des larmes plein les yeux, le vague à l'âme, que je m'endors, serrant dans la main ce maudit caillou.
L'aube teinte à peine le ciel lorsque je me réveille mais les ronflements sonores de Gabor m'empêchent de me rendormir. Je me lève donc et m'assieds sur le petit escalier de bois extérieur qui mène à la roulotte. Tout est calme, à cette heure, même les poules commencent à peine à se réveiller. Du feu, il ne reste plus que des braises mourantes. Le chant des oiseaux est le seul à troubler le silence. Les coudes sur les genoux, le menton au creux des paumes, je regarde le camp endormi et la rivière un peu plus loin.
C'est vrai qu'il me plaisait bien, ce jeune mercenaire. Avec ses cheveux dorés et son regard clair, il me faisait frissonner des pieds à la tête. Il réveillait chez moi des instincts protecteurs que je n'aurais pas imaginé avoir. J'aurais peut-être dû oser. Lui sourire de manière plus appuyée, partager ses corvées ou le défendre face aux autres. J'aurais peut-être dû l'aborder, lui avouer mon attirance. Et peut-être qu'il serait là, maintenant, à dormir tout contre moi. Peut-être que nous pourrions, chaque matin, aller à la rivière ensemble. Et pas forniquer, non, mais échanger des mots doux et des gestes tendres.
- Gabor était ivre, hier, c'est ça ?
Je sursaute. Voel est face à moi, hirsute, débraillé et mal rasé. Mais il m'adresse un sourire tendre alors je hoche doucement la tête. Voel sait comment se comporte Gabor quand il a bu. Je crois bien qu'ils en ont déjà parlé, tous les deux, bien qu'aucun des deux ne m'en ait soufflé mot. Mais ça ne change rien.
Je me décale légèrement pour le laisser s'asseoir à côté de moi. Il étouffe un bâillement, se frotte les yeux, avant de déclarer d'une voix sourde :
- Tu sais, il paraît que, maintenant, il y a des gens comme toi à la cour.
Je reste silencieux. Il est maladroit, mais je comprends ce qu'il veut dire. Des hommes qui préfèrent les hommes, mais sans les perles dans les cheveux et sans roulotte pour toute possession. Il poursuit sur le même ton :
- Il n'y a pas de procès pour eux, ni de tortures ni de condamnations.
- Mais nous sommes loin de la cour.
Il hoche doucement la tête, comprenant parfaitement que je ne parle pas uniquement de la distance géographique. Les courtisans et le roi sont tellement différents du peuple...
- Ça viendra. Jusqu'au fond des vallées comme celle-là, ça viendra. Dans un an ou dans dix ans, les bûchers ne seront plus allumés pour cette raison. Le quotidien ne sera peut-être pas beaucoup plus facile pour toi, mais tu ne risqueras plus ta vie.
J'ai envie de le croire. Tellement besoin de le croire. L'Église est impitoyable contre ce qu'ils appellent les bougres. Depuis toujours, les Inquisiteurs mènent une guerre sans merci contre les délits de l'épine, les actes amoureux entre hommes. J'ai envie de croire qu'un jour, je ne serai plus un criminel. Comme s'il devinait mes pensées, Voel passe un bras autour de mes épaules et m'attire contre lui. Je pose mon crâne contre son épaule, savourant le moment. Voel est rarement aussi démonstratif. Le fait que nous soyons juste tous les deux, à l'abri des regards, y est pour beaucoup.
- Gabor n'est qu'un jeune imbécile. Tu es comme tu es, et nous t'aimons tel quel. Mais tu dois être prudent, Yoshka, très prudent.
Je ferme les yeux pour retenir mes larmes. Ses propos me touchent plus qu'il ne l'imagine. Plusieurs minutes s'écoulent, comme s'il me laissait le temps de me ressaisir. Puis il pose un baiser sur mon front et s'écarte de moi.
- Andronica a été faire un tour au marché, hier, et votre spectacle est annoncé. Va préparer ce dont tu as besoin.
Un maigre sourire fleurit sur mes lèvres. Il se lève lentement et s'éloigne de la roulotte sans rien ajouter. Je ne suis pas dupe. Ses propos sont réconfortants et bienvenus. Mais il est le seul, avec Gabor, à savoir pour moi. Les autres ignorent tout de mes penchants, même si certains plaisantent à propos de mon manque de conquêtes féminines. Alors oui, ils m'aiment, comme on aime un membre de sa famille qu'on n'a pas choisi mais qui sera toujours là. Ils m'aiment sans savoir. S'ils savaient, qu'en serait-il ?
Je secoue doucement la tête, chassant ces idées noires. J'ai à faire. Je me dirige d'un pas déterminé jusqu'au tonneau d'eau et je me rafraîchis le visage. Puis, sans bruit, je regagne ma roulotte.
Sous mon lit, soigneusement arrimée, se trouve une longue boîte, de deux mètres de long pour un mètre de large et cinquante centimètres de profondeur. Elle n'est pas légère et j'ai quelques difficultés pour la sortir de la roulotte sans faire trop de bruit.
Je m'installe sur l'herbe pour sortir toutes les marionnettes de la boîte, les nettoyer et m'assurer que leurs costumes sont impeccables. Puis je m'occupe des décors, du rideau et des pièces de rechange. J'accorde toujours beaucoup d'attention à ce théâtre de marionnettes. L'odeur du tissu et du bois me rappelle tant de souvenirs que je ne peux pas m'en occuper sans repenser à mon père, précédent propriétaire de ce théâtre, qu'il m'a légué à sa mort. Il l'avait construit avec Ysayo et il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. C'est grâce à lui que je suis devenu conteur. Et reprendre le spectacle de marionnettes était une évidence pour moi. J'ai renouvelé les pièces que nous jouons avec Filippia, ma complice, même si je prends énormément de plaisir à ressortir, parfois, celles de mon père. Je n'en ai aucune trace écrite, mais tout est gravé dans ma mémoire. Nous nous installons toujours sur le marché, et nous proposons ce spectacle juste avant le déjeuner. Notre public est principalement composé d'enfants, qui aident leurs mères à vendre leurs récoltes sur les étals. Nous ne faisons pas payer le spectacle, nous savons que c'est une récompense pour eux, une sacrée fête, et il serait injuste d'en priver les plus démunis. Mais comme nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche, Filippia passe après la représentation avec une coupelle de bois, pour que les spectateurs nous donnent un petit quelque chose.
Lorsque je termine mon nettoyage, tout le monde est levé et le petit-déjeuner est prêt. Je me joins avec plaisir avec eux, écoutant leurs conversations encore ensommeillées, heureux de me changer les idées.
Puis j'annonce à Gabor et Filippia que nous avons notre spectacle ce matin. Gabor se contente de hocher la tête, son air rieur envolé. Filippia l'observe, puis reporte son attention sur moi avant de plisser les yeux. C'est vrai que nous n'avons pas été loquaces ce matin, et ce n'est pas dans nos habitudes. Elle ne dit rien jusqu'à ce que nous ayons quitté le campement, elle marchant à nos côté avec les tréteaux, Gabor et moi portant le théâtre.
Mais elle n'attend pas beaucoup plus et demande dès que possible :
- Que se passe-t-il ? Vous vous êtes disputés ?
Je pince les lèvres et me mure dans le silence, réfléchissant au mensonge que je pourrais lui raconter. J'avance en tête, je ne peux pas voir comment réagit Gabor à cette question toute innocente. Mon cœur manque un battement quand je l'entends répondre :
- C'est de ma faute. J'ai été stupide.
- Comme toujours. Qu'est-ce que tu lui as dit, cette fois ?
Tenant toujours la boîte, je me retourne à moitié pour marmonner :
- Rien dont je ne puisse me remettre. Inutile de ressasser tout ça.
Je n'ai effectivement pas envie de revenir sur ses propos de la veille. Et je n'ai pas envie, non plus, que Filippia apprenne ce détail me concernant. Parce que je la connais, si on lui lâche quelques bribes de la conversation, elle insistera jusqu'à tout savoir.
- J'ai parlé de ce mercenaire, là, dont il aurait bien fait son quatre-heures.
Je fais volte-face d'un bond, la bouche ouverte, prêt à lui dire ma manière de penser. La boîte m'échappe des mains, pour s'écraser sur ma botte. C'est finalement un cri de douleur qui jaillit de ma bouche. Puis suit une bordée de jurons à l'encontre de Gabor, tandis que je retire la caisse de mon pied. Et alors que je m'apprête à lui hurler après, il hausse ses épaules massives et avoue :
- Elle est au courant depuis des années.
Je referme la bouche, soudain incapable de parler. Je reste figé, le ventre noué et l'orteil douloureux. J'aurais tant de choses à dire, de reproches à formuler, de questions à poser que je ne sais pas par où commencer. Dans mon esprit, les idées tourbillonnent sans relâche. Je réalise à peine que Filippia m'a rejoint et me tient la main. Gabor se remet à parler :
- Je sais bien que je n'aurais pas dû, mais comprends-moi aussi. Ça a été un choc de te surprendre, les fesses à l'air, avec ce fermier. Et quand j'ai compris que, les jours passants, tu ne m'en parlerais pas, ben moi, j'ai eu besoin de causer. T'as tellement la trouille qu'on ne t'aime plus que tu lui mens, à elle. Moi, je sais pas lui mentir et elle a tout de suite vu que quelque chose me chiffonnait.
Le silence retombe sur le chemin de terre. Je passe ma main libre dans mes cheveux avant de laisser échapper dans un souffle :
- C'était pas à toi de lui dire. C'est moi qui aurais dû...
- Tu ne l'as dit qu'à Voel, Yoshka. Même une fois que moi, j'ai été au courant, tu es resté muet à ce sujet. Alors je ne crois pas un seul instant que tu lui aurais dit.
- Mais bon sang, Gabor ! De quel droit ? C'est ma vie privée ! Ça ne regarde personne de savoir avec qui je couche.
- Du droit de te voir heureux, sacrebleu. Filippia se faisait un sang d'encre pour toi, parce qu'elle voyait bien que tu étais malheureux. Je ne voulais pas mentir pour toi. Et moi, je ne sais pas comment faire pour t'aider, alors elle me donne des conseils. Même si, à chaque fois que j'essaie de parler de ça avec toi, tu te braques et tu finis en boule sur ton lit, en larmes.
- A chaque fois que tu m'en parles, tu es soul comme un cochon. Et ta voix porte tellement de dégoût …
C'est au tour de Gabor de rester silencieux. Je n'ose le regarder : mes yeux restent rivés sur le bout de botte qui a reçu l'impact. C'est Filippia qui, d'une voix douce, éclaircit les choses :
- Gabor t'adore. Il aimerait parler de tes conquêtes comme vous parlez des siennes. Sans aucune finesse, certes, mais sans honte ni complexe. Mais ça te gêne tellement d'en parler que tu t'imagines du dégoût dans sa voix. Tu crois qu'il vient fouiller dans ta vie privée comment on le ferait pour une fosse à purin. Mais je t'assure, Yoshka, je te le jure sur ma vie, qu'il n'a aucun mauvais sentiment à ton encontre. Il veut juste briser ce silence qui t'étouffe, même s'il s'y prend comme un manche, comme toujours.
- Et si je n'ai pas envie d'en parler ? On n'est pas tous faits comme lui, à tout raconter de nos conquêtes !
- Es-tu bien certain de ne pas avoir envie d'en parler ? Jamais ?
Parce que c'est Filippia, je prends le temps de réfléchir sérieusement à sa question. Mais je n'y réponds pas, car je ne peux pas affirmer que j'aime ce silence. Je hoche doucement la tête, en signe de capitulation. Et comme ils ne se décident pas à parler encore, je demande :
- Qui d'autre est au courant ?
Parce que Gabor a dû en parler à d'autres. S'il n'a pas su se taire avec Filippia, il n'a pas pu le faire avec les autres. Le silence perdure encore quelques secondes avant que, encouragé par un coup de coude, Gabor admette, comptant sur ses doigts chaque prénom qu'il prononce :
- Eh bien, euh, Djidjo, Ysayo, Andronica, Isaï, …
J'interromps sa litanie en demandant sèchement :
- Presque tout le monde, quoi ?
- Absolument tout le monde, en fait.
Cette affirmation me coupe le souffle et j'ai l'impression de tomber. Mais Filippia ne me lâche pas la main, et Gabor pose une main rassurante sur mon épaule. Je bredouille :
- Mais depuis quand ? Je n'ai jamais remarqué de changement …
- Parce que ça ne change rien.
Pour la première fois, je redresse la tête et je les dévisage. Et ce que je lis dans leurs regards me bouleverse : ils m'aiment, comme je suis. Je les serre contre moi, de toutes mes forces, jusqu'à ce que Gabor ronchonne, mal à l'aise :
- On va finir par rater le spectacle, à ce rythme.
Il n'a pas tort, nous ne pouvons pas passer la matinée ici, au milieu de nulle part, à discuter. Et puis, j'ai besoin de réfléchir, de faire le tri dans mes pensées, de digérer ces informations. Gabor et moi reprenons la caisse, et Filippia se remet en marche avec les tréteaux, à mes côtés. Elle respecte mon silence et ne dit rien de tout le trajet. Un trajet que je ne vois pas passer, perdu dans mes réflexions.
Mon pied est douloureux, mais c'est le cadet de mes soucis. J'ai été stupide de croire que personne n'était au courant. Même si Gabor n'en a effectivement parlé qu'à Filippia. Nous sommes une grosse vingtaine et nous vivons ensemble. Il n'y a quasiment pas d'intimité. Si l'un de nous ramène quelqu'un au camp, ne serait-ce que pour passer une agréable soirée, tout le monde le sait. Et si l'un de nous s'éloigne du campement, par discrétion, son absence se remarque immédiatement. C'est parfois pesant. C'est souvent rassurant. La solitude est l'une des rares choses que nous ne redoutons pas.
Alors forcément qu'ils ont vu des choses. Forcément qu'ils se sont posé des questions. Et forcément qu'à un moment où à un autre, le secret a été éventé.
Ainsi donc, ils savent. Je n'ai jamais surpris de regards en coin. Jamais de remarque désobligeante. Jamais de mot blessant. Quant aux plaisanteries, il n'y en a pas plus qu'avant. D'ailleurs, je peine même à différencier l'avant de l'après. Ça ne change rien.
J'ai finalement un sourire aux lèvres quand nous arrivons sur la place du marché. Un gamin, plus intrépide que les autres, me tire la manche pour me demander :
- C'est quand que ça commence ?
- Dès que nous sommes installés. Encore un peu de patience.
Je souris à mes deux compagnons et dépose la boîte à l'endroit qui me semble le plus approprié. Ignorant la douleur de mon orteil, j'installe la boîte sur les tréteaux et l'ouvre. Il ne nous faut guère plus de dix minutes pour tout mettre en place, on a l'habitude.
Une vingtaine d'enfants patientent, assis par terre. Presque autant d'adultes se tiennent debout, sous prétexte de surveiller ce que nous allons dire à leurs précieux rejetons. C'est surtout pour profiter, eux aussi, du spectacle, nous le savons bien.
Alors je ne les fais pas attendre plus longtemps. Filippia et moi prenons nos marionnettes et l'histoire commence.
C'est un conte moral, comme toujours. L'histoire d'une princesse venue de contrées lointaines, mariée par amour au roi et qui se retrouve face à l'hostilité du peuple. Parce qu'elle a la peau plus foncée, un accent quand elle parle, les petites gens se méfient d'elle. Aidée par le roi, elle lutte contre ces préjugés, leur fait découvrir sa culture, ses traditions. L'inconnu engendre la peur, la peur engendre la haine, c'est bien connu. Alors, face au peuple, elle fait tomber un à un les mystères qui l'entourent. Et si elle ne devient pas une reine adulée, au moins est-elle acceptée.
La pièce ne dure pas bien longtemps, les enfants se déconcentrent vite. Mais ils sont ravis par les costumes colorés et séduits par l'accent étrange que prend Filippia quand elle joue la princesse. Les parents aussi sont comblés, à en croire les nombreux dons que Filippia récupère, sous l'œil vigilant de Gabor.
C'est avec le sourire que nous remballons le théâtre, discutant avec enthousiasme de l'accueil reçu. Si nous restons encore plusieurs jours, nous pourrons refaire d'autres spectacles. Puis nous empruntons les ruelles du village pour regagner le campement.
Nous n'allons pas bien loin. Lorsque nous débouchons sur la place de l'église, nous tombons sur une situation qui ne peut que nous alarmer. Ils sont peut-être deux douzaines à vociférer sur le parvis, sous l'œil bienveillant du curé. Nous sommes bien assez proches pour entendre leurs paroles, même si, fort heureusement, eux ne nous ont pas remarqué.
Mon ventre se noue lorsque j'entends la raison de la vindicte populaire : une vache a disparu. Et comme je le redoutais, les villageois ne s'embarrassent pas d'innombrables hypothèses : les tsiganes arrivent, une vache disparaît, l'évidence crève les yeux.
Je pince les lèvres et échange un long regard avec Filippia et Gabor. Il est grand temps pour nous de déguerpir, avant que les villageois ne nous remarquent.
Mais un mouvement sur le parvis retient mon attention et cloue mes pieds au sol. Émergeant de l'ombre des piliers, l'homme en noir apparaît. Et un silence funeste s'abat sur la place.
Âprefond, chapitre 2
Voici donc un nouveau chapitre, et je propose comme musique : Gari, gari, brûle brûle (le son n'est pas terrible, mais la chanson, si!)
Comme toujours, le temps file lorsque nous sommes autour du feu. Quand les premiers villageois partent, emmenant dans les bras leurs enfants endormis, minuit est déjà passé depuis longtemps. Nous poursuivons un moment, avec des chants moins festifs, plus nostalgiques. Même s'ils n'en comprennent pas les paroles, ceux qui restent sont captivés : la musique parle à l'âme et n'a pas besoin de langage pour ce faire.
Et puis, j'entre en scène. Accompagné de mon cistre, pour donner du rythme à mon récit, je raconte l'histoire que j'ai inventé, parlant de preux chevalier découvrant un havre de bonheur dans une vallée verdoyante isolée de tout. L'accueil est plutôt bon, même si les villageois peinent à réaliser que je parle de leur vallée. Et qu'elle n'a rien d'un havre de paix. Mes compagnons, eux, se laissent porter par les intonations de ma voix, par le débit lent de mes paroles, que j'accélère juste aux moments opportuns, et aiment cette histoire. C'est le plus important pour moi.
Finalement, ils quittent le campement, l'air un peu ailleurs, comme s'ils avaient du mal à revenir à leur quotidien. Comme s'ils peinaient à réaliser à que la vie continue, que dans quelques heures, ils devront être dans leurs champs, à semer pour l'année à venir. Nous aussi, nous avons du mal à nous éloigner du feu. Épuisés, pourtant, nous nous levons chacun à notre tour, pour prendre un repos bien mérité. Mais alors que je m'avance vers ma roulotte, Voel m'intercepte :
- Yoshka ?
Il n'a pas besoin d'en dire plus. Les dernières lueurs du feu me permettent de voir son air soucieux. Je passe une main dans mes cheveux avant de lui dire, à voix basse :
- L'homme en noir était là, contre la roulotte de Djidjo.
Il me dévisage quelques secondes, sans me demander si je suis sûr de moi. Il sait bien que je n'aurais pas inventé tout ça. Puis il hoche doucement la tête et poursuit sa pensée :
- Il a vu que tu l'avais repéré ?
- Oui.
- Il est resté, ensuite ?
- Je ne l'ai plus vu, non.
Il hoche encore la tête puis, d'une claque sur l'épaule, m'envoie me coucher. Gabor est déjà allongé et nous n'échangeons pas beaucoup de paroles pendant que je me prépare pour la nuit. La chandelle soufflée, je reste de longues minutes à fixer, sans le voir, le plafond de bois. Les villageois semblaient contents de leur soirée, c'est un bon présage pour les jours qui viennent. Mais il y a cet homme en noir, qui ne cesse de titiller ma conscience. Qui est-il ? Et quel danger représente-t-il pour nous ?
Les mêmes inquiétudes troublent sans doute le repos de Voel. Mais lui peut sentir, contre son corps, la douce chaleur d'Andronica, son épouse. Je me tourne entre les draps froids, refusant d'imaginer ce que ça ferait si, moi aussi, j'avais un corps contre lequel me blottir.
La matinée est déjà avancée lorsque je me réveille. Je suis l'un des premiers à émerger : de nombreuses roulottes sont encore fermées, et le feu est éteint. Sous le regard inexpressif des bœufs, les poules caquètent dans leurs cages et les chiens terminent leur nuit sous les roulottes. J'en profite pour me rendre à la rivière et me baigner longuement.
Lorsque je retourne au campement, les flammes dansent joyeusement et le petit déjeuner est prêt. Nous mangeons en silence, encore embrumés par le sommeil. Puis Voel nous répartit les tâches. Je serai avec Filippia et Gabor, aujourd'hui. Je leur souris, heureux de passer du temps avec eux.
Filippia, ce petit bout de femme mince, tient une place particulière dans notre grande famille. C'est elle qui, malgré son jeune âge, maîtrise le mieux le secret des plantes. Elle tient ce talent de sa mère, un talent qui nous permet à tous de rester en bonne santé. Aujourd'hui, elle va se rendre dans les bois tout proches, pour y ramasser diverses herbes médicinales qu'elle fera sécher. Gabor et moi l'accompagnons, sous prétexte de ramasser du bois. Nous pourrons ainsi veiller à sa sécurité. Et si jamais du gibier nous passait sous le nez, nous pourrions agrémenter le repas du soir.
Filippia chantonne tandis que nous nous longeons, par habitude, la rivière pour ne pas nous perdre. Et bon nombre de plantes médicinales poussent près de l'eau vive. Tandis qu'elle remplit sa besace, sans jamais la quitter du regard, nous rassemblons le bois sec que nous pouvons trouver. Puis nous nous enfonçons entre les arbres.
C'est une belle petite forêt, à l'entêtante odeur d'humus. Le gibier semble y abonder, car il y a de nombreuses pistes qui semblent exclusivement utilisées par les animaux. Filippia mêle son chant à celui des oiseaux tandis qu'elle scrute le sol à la recherche de plantes. Gabor et moi, nous aussi, examinons les lieux avec attention : ici, le terrier de lapins, là-bas, un nid de grives, plus loin, le chant d'un faisan qui fait la cour à sa belle. Nous sommes aux aguets, pourtant, de crainte d'être surpris : les villageois n'aiment guère qu'on rôde sur les terres qu'ils exploitent, même s'ils n'en sont pas propriétaires. Et même si nous nous éloignons toujours plus du village, le risque d'en croiser quelques-uns n'est pas à exclure.
Filippia ramasse de la saponaire, tandis que je pose un collet devant un terrier. Gabor monte la garde. Mais ça ne suffit pas. Car alors que je contemple mon travail, satisfait, un toussotement se fait entendre dans mon dos. Je me retourne d'un bond. Filippia laisse échapper un cri d'effroi et se cache derrière moi. Gabor, prudemment, va rejoindre notre guérisseuse.
Je me retrouve donc en première ligne face à l'homme en noir, les mains sur les gardes de ses dagues.
Je suis tétanisé. Mes entrailles semblent se liquéfier alors qu'il porte sur moi un regard glaçant. Je déglutis péniblement, essayant d'ignorer, derrière moi, les deux qui tremblent. Je n'ai pas à rougir de ma carrure, je suis loin d'être frêle, même si je ne ressemble à pas un colosse. Mais je ne suis pas armé. Et l'homme en noir est plus grand que moi et armé. Mon esprit s'affole, à la recherche de quelque chose à dire, n'importe quoi qui pourrait briser ce silence sépulcral. Mais j'ai bien conscience qu'un « Salutations, messire ! » ou qu'un « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ? » ne serait pas des plus pertinents.
Il demeure immobile, dardant sur moi ce regard qui me transperce. Je sens que mes lèvres vont laisser échapper un gémissement pitoyable, au lieu d'une répartie intelligente. C'est à ce moment-là qu'il prend la parole. Dans cette forêt qui semble retenir son souffle, sa voix tombe comme un couperet.
- La chasse est interdite ici. Rentrez chez vous.
J'acquiesce péniblement, incapable de prononcer un mot. Gabor et Filippia se précipitent loin de l'inconnu. Et je suis sur le point de prendre mes jambes à mon cou quand il déclare, glacial :
- Vous oubliez quelque chose.
Je lui jette un regard à la fois étonné et interrogateur. D'un mouvement du menton, il désigne le collet, preuve de notre forfait. Je tombe à genoux, répugnant à l'idée de lui tourner le dos. Mais d'un geste vif, à l'aide de mon couteau, je tranche le lien de cuir et empoche le piège. Je me relève d'un bond et m'éloigne instinctivement de lui. Et je détale, comme un lapin, gardant à l'esprit l'image de cet homme, immobile au milieu du sentier.
Nous nous arrêtons devant le tas de bois mort que nous avions constitué, à l'aller. Nul besoin de se concerter : nous rentrons au campement. Filippia nous aide à hisser sur notre dos les deux paniers à lanière. Puis elle les remplit, sans un mot, ses gestes brusques et maladroits trahissant son émoi, du bois collecté. Nous ne marchons plus le nez au vent, Filippia ne chante plus : nous sommes pressés de retrouver la sécurité du campement.
En nous voyant revenir, Voel devine immédiatement que nous avons eu un souci. Cette fois encore, je suis proclamé porte-parole, et c'est donc moi qui lui résume notre rencontre. Sa seule réaction est de nous demander si nous sommes blessés, avant de tourner les talons. Voel est ainsi : il prend toujours son temps pour réfléchir. Gabor va aider Filippia à ranger les herbes qu'elle a ramassé tandis que je m'occupe du bois mort. J'essaie de chasser de mes pensées le souvenir de cette rencontre mais il revient, encore et encore, à la charge.
Je n'ai pas honte de l'avouer : je ne suis pas un héros. Je ne sais pas me battre, j'arrive tout juste à me défendre lors d'une bagarre de taverne. Je ne manie ni dague ni épée : un simple bâton de bois est bien suffisant, ça évite que je me mutile stupidement. Gabor et moi sommes faits du même moule, à ce sujet : nous ne savons pas nous battre, et nous n'aimons pas ça. C'est déjà arrivé que l'un de nos femmes soit importunée par un indélicat. Ou que l'un d'entre nous soit pris à partie par un ivrogne. Nous ne restons pas les bras croisés, nous intervenons. Mais c'est sans technique ni grâce, uniquement avec l'énergie du désespoir et des gestes maladroits.
Le seul qui sache se monter digne d'un combat, c'est Voel. Et je tremble à l'idée qu'il doive, un jour, affronter cet homme en noir. Parce qu'il est comme un père pour moi, mon cœur se serre à l'idée de le perdre. Que deviendrons-nous, tous, s'il venait à disparaître ? Comment pourrions-nous poursuivre sans lui ? La mort fait partie de la vie, bien sûr, mais certaines sont plus douloureuses que d'autres. C'est Ostelinda qui m'extirpe de mes idées noires. De sa petite voix fluette, elle me prévient que le repas est prêt.
Son sourire désarmant fait fuir toutes mes pensées funestes et je la suis bien volontiers, bercé par le froufrou de ses jupes miniatures, sa menotte calée dans ma main. Les mines sont réjouies autour du feu et les plaisanteries fusent. Djidjo, la mère d'Ostelinda, verse de belles portions dans les écuelles tendues, au rythme des éclats de rire. Mais lorsque nous sommes tous servis et installés pour le repas, Voel prend la parole et leur annonce notre rencontre sinistre dans la forêt, changeant l'ambiance du tout au tout.
Puis de sa voix implacable, il déclare que nous devrons toujours nous déplacer par trois, quel que soit l'endroit où l'on se rend. Avec un regard appuyé dans ma direction, il précise que c'est également valable pour la rivière.
Il annonce ensuite que nous ne devons pas pénétrer dans la forêt, et tant pis pour le gibier. Pour le bois mort, nous nous contenterons de suivre le cours de la rivière. Toute personne apercevant l'homme en noir, dont il donne une description précise, doit l'en informer dans les plus brefs délais.
Pour finir, il nous demande la plus grande prudence et nous souhaite un bon appétit. Le déjeuner se fait dans un silence relatif, uniquement troublé par le chahut des enfants. Les adultes sont plus graves : ce n'est pas la première fois qu'ils sont confrontés à une telle menace mais ça ne la rend pas plus plaisante pour autant.
Je termine rapidement mon écuelle et, sur un signe de tête de Ysayo, je le suis jusqu'à sa roulotte. Notre menuisier m'a pris comme aide et il a besoin de moi cet après-midi. Ysayo est de la même génération que Voel, même si le temps l'a plus marqué. Son visage buriné par le soleil est sec et ridé, ses bras musculeux, sans un gramme de graisse. Il n'est pas très grand, mais l'habitude de manier le bois l'a rendu fort comme un bœuf. Je ne suis pas sûr de lui être d'une grande utilité, je l'aide à tenir les chevrons de bois, je fais des petites découpes. Pour l'assemblage, je me contente de placer la pièce et de ne plus bouger : il paraît que je ne sais pas planter un clou droit. Par contre, j'aime faire les finitions. J'aime poncer le bois, sentir la matière chaude sous mes doigts devenir aussi douce que le velours. Je peux y passer des heures, perdu dans mes pensées, à peaufiner les derniers détails. Et puis, je ne suis pas très causant, et je crois bien que Ysayo apprécie de travailler dans le silence.
L'après-midi passe ainsi, dans un silence troublé par le frottement de la scie et la musique lointaine. Le soleil est déjà bas à l'horizon quand je me redresse, le dos crispé d'être resté trop longtemps penché sur mon ouvrage. Je plie et déplie mes doigts tétanisés par la tâche que m'a confié Ysayo. Mais son sourire, lui qui en est si avare, est une belle récompense : il est content de mon travail.
C'est que nous avons tous un rôle, dans notre grande famille. Le travail ne manque pas, lorsque nous nous arrêtons : refaire les provisions, nettoyer nos affaires, entretenir nos roulottes, nos seules et précieuses possessions, soigner les bêtes, planifier la suite du voyage.
Je ne peux me rendre à la rivière pour me rafraîchir, mais pendant que nous travaillions, certains ont amené des tonneaux près des roulottes, et les ont rempli d'eau. J'en profite donc pour faire quelques ablutions avant de passer à table.
La soirée est à nouveau bercée de musiques, de chants et de contes. Nous ne pouvons pas nous arrêter à cette menace sourde qu'il représente. Nous faisons bonne figure et jouons le rôle que les villageois attendent de nous. Notre musique, la danse effrénée de nos femmes, le bonheur d'être ensemble m'aident à retrouver le sourire.
Un sourire qui disparaît à l'instant où, dans l'ombre des roulottes, j'aperçois deux prunelles brillantes. L'homme en noir. Par défi, par folie, je soutiens son regard. Entouré des miens, porté par cette musique qui est toute ma vie, je me sens fort. Il n'osera pas s'attaquer à nous ici, nous sommes trop nombreux. Alors j'ose cet affrontement visuel, j'ose ce défi.
Il cède le premier, détourne le regard avant de s'enfoncer dans les ombres. Je frissonne malgré la douce tiédeur de la soirée. J'espère avoir réussi à le faire partir, à lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu ici. J'espère encore plus fort ne pas m'être fait un ennemi mortel par ce simple échange de regards.
Lorsque je reviens à la fête, cessant d'observer l'ombre de la roulotte, je découvre que Voel me dévisage gravement. Lui aussi, il a dû voir l'homme en noir. Il hoche doucement la tête, sourit un peu, rassurant. Puis je me laisse emporter par les tourbillons des jupes et la musique endiablée.
Les heures passent comme un éclair, les violons s'apaisent, les souffles sont trop courts pour poursuivre encore. Alors je prends mon cistre, je m'installe sur un rondin près du feu, et c'est illuminé par les flammes dansantes que je commence mon histoire.
Les temps dont je vais vous parler sont si anciens que seule une poignée d'hommes et femmes de par le monde s'en souvient encore. A dire vrai, mes braves gens, cette histoire est si ancienne qu'elle est devenue légende...
Elle était là, nichée entre les falaises, cette ville fortifiée dont les vagues venaient lécher les pieds des remparts. Un voile de brouillard ne la quittait jamais, la parant comme les femmes se parent de leurs plus beaux atours. Les habitants vivaient heureux de la pêche, des récoltes des champs avoisinants. Il y avait toujours du passage, dans cette ville, car elle était réputée en Bretagne et même au-delà. Les instruments jouaient nuit et jour pour faire danser les jeunes femmes et même les hommes. Cette ville, elle se situe tout près, entre Saint Pol et Triguier. Enfin... se situait.
Il y avait, dans cette ville, une vieille femme. La vie ne l'avait pas gâtée, loin de là : son mari était parti pêcher en mer, mais n'en était jamais revenu. Ses enfants, elle les avait tous enterré, du moins, ceux dont on retrouva les corps. Maladie, disparition en mer, chute mortelle. Rien ne lui avait été épargné. Et pourtant, elle était toujours disponible, prête à aider quiconque viendrait lui demander de l'aide. Car elle avait été bénie par les Dieux à sa naissance, et elle avait un don. En vérité, je vous le dis, brave gens, elle avait un don formidable ! Elle connaissait toutes les plantes, tous les onguents et tous les breuvages qui pouvaient guérir. Et il lui suffisait de poser les mains sur la poitrine d'un enfant souffrant pour qu'il soit rétabli. Il lui suffisait de masser le ventre d'une femme pleine pour que l'accouchement soit sans douleur. Elle savait soulager les douleurs d'un murmure, et panser les plaies de telle manière qu'en quelques jours, il n'en restait plus aucune trace. Oui, tout le monde aimait cette vieille femme et personne ne l'oubliait jamais quand la disette faisait rage. Elle trouvait toujours, sur le pas de sa porte, un présent, modeste ou généreux en fonction des possibilités de chacun.
Et puis, un jour, ils sont arrivés.
Ils allaient dans les villages et hameaux, dans les villes et dans les ports, apporter la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, qu'ils disaient. Funeste nouvelle, je vous le dis.
Oh, bien sûr, au début, ils faisaient profil bas. Vantaient les mérites de cette ville aux multiples facettes, envoûtante comme une tsigane en robe rouge qui danse autour du feu. Mais il fallait se méfier des apparences. Ils vinrent, et peu à peu, insinuèrent dans l'esprit des gens que les croyances des Bretons étaient hérésie. Que les Dieux qu'ils vénéraient n'étaient que chimères. Ils étaient fort habiles, je vous le jure ! Ils organisèrent d'immondes mises en scène, pour faire croire à tous les miracles divins qu'ils prônaient. Ils flattaient les plus faibles, laissant les gens parler, douter, se convaincre les uns les autres. Ils proclamaient à qui voulait l'entendre, et à ceux qui ne le voulaient pas aussi d'ailleurs, qu'il n'existait qu'un seul Dieu. Un Dieu Unique, tout puissant.
Et la vieille femme, dotée par les Dieux de pouvoirs exceptionnels, s'éleva contre ces mensonges. Elle lutta, avec ses mots, avec ses dons, pour prouver aux autres que les Dieux existaient, qu'ils n'étaient que des charlatans, des imposteurs. Une lutte féroce s'était engagée. Une lutte sans merci.
Et toute la bonne foi de la vieille femme,
tous ses talents furent bien faibles face à la malice des étrangers.
Ceux qu'elle avait aidé, ces enfants qu'elle avait sauvé et ces vieux
qu'elle avait soulagé de leurs douleurs se mirent à douter de sa parole.
C'est pourquoi personne n'osa se révolter quand les étrangers
décrétèrent qu'elle était hérétique, qu'elle affabulait et qu'elle était
dangereuse. Et si certains protestèrent contre la décision, leurs
murmures se perdirent dans les cris de la foule en colère.
Personne n'empêcha les étrangers de dresser un bûcher sur la place. Personne n'osa se manifester quand ils la ligotèrent au pieu. Et personne ne pipa mot quand ils enflammèrent les fagots de bois.
Le visage de la vieille femme était serein, aussi surprenant que cela puisse paraître. Elle regardait les habitants se masser autour d'elle, ivres de colère, manipulés, et eu de la peine pour eux. Oui, elle avait de la peine pour ces êtres faibles pour qui les croyances se changent aussi facilement qu'une chemise. Elle avait de la peine pour ces esprits faibles qui ne se souvenaient que de ce qui les arrangeait.
Et
ses croyances à elle lui assuraient de retrouver son mari, ses enfants,
et tous ceux qu'elle avait aimé. Alors ... partir de ce monde hypocrite
ne lui semblait pas si terrible...
Mais la Déesse Airmed, fille du dieu-médecin Diancecht, qui avait pourvu la vieille femme de ses dons, s'indigna.
Elle
s'indigna d'avoir donné la vie, la santé, et l'espoir à de si viles
créatures. Elle trembla de colère en voyant ces imposteurs monter ainsi
les gens les uns contre les autres.
De voile, le brouillard devint linceul. Puis il fut chassé par des pluies torrentielles, qui éteignirent le bûcher, ruisselèrent dans les ruelles en les transformant en rivières déchaînées. Puis, un vent violent se leva. Si violent qu'il arracha les toits de chaume, les ardoises et les tuiles. Les vagues venaient s'écraser de plus en plus violemment contre les murs d'enceinte, projetant leurs embruns loin dans les terres.
Et la ville fut engloutie par la mer, avalée par le courroux divin, et disparut à tout jamais. Nul ne revit jamais les étrangers, ni aucun habitant. Il se murmure que, parfois, leurs âmes errantes s'attaquent aux navires égarés. Mais j'ignore si c'est la vérité.
Ce que
je sais, par contre, avec certitude, c'est que cette histoire ne doit
jamais être oubliée. Et qu'avant de renoncer à ce que vous croyez au
plus profond de vous-même, réfléchissez et assurez-vous que personne ne
cherche à vous manipuler.
Les mots meurent sur mes lèvres et le silence perdure. Je ne suis pas fier de la chute, mais les villageois semblent réfléchir à cette histoire : une partie est gagnée. C'est une histoire délicate, que je ne raconte pas souvent. Même si je sais que mon public ne fait pas partie des plus bigots, le risque est grand que ce récit déplaise à l'Église. Mais j'ai toujours eu beaucoup de chance, choisissant avec soin les villages où je la raconte, et j'arrive à m'en sortir avec une pirouette. Après tout, puisque l'Église a réussi à convaincre le brave peuple que les Dieux ne sont que foutaises, je plaide en leur faveur. Si un olibrius s'amusait à prétendre que Dieu n'existe pas, alors les fidèles réagiraient par de la méfiance.
A dire vrai, je crois plus aux Dieux qu'à un Seigneur tout-puissant. Il va de soi que cette croyance est enfouie au plus profond de mon cœur. Nous sommes déjà assez mal vus comme ça, inutile de rajouter hérésie à notre liste de forfaits, réels ou imaginaires. Ils n'ont pas besoin de ça pour nous détester et pour vouloir nous …
- Excusez-nous.
Je redresse vivement la tête pour me retrouver face à un couple de jeunes villageois, elle tenant un nouveau-né dans ses bras, lui tenant un jeune garçon par la main. Ils me sourient, compréhensifs, tandis que je jette un rapide regard autour de moi. Les villageois se sont enhardis et discutent, ça et là, avec nous. Je me lève, détestant rester assis quand mes interlocuteurs sont debout. L'homme s'éclaircit la gorge avant de déclarer, comme s'il avait répété cette phrase plusieurs fois avant d'oser m'approcher :
- On voudrait vous remercier pour cette magnifique histoire. Pour sûr, elle donne à réfléchir.
- C'est un plaisir. Tout l'intérêt des contes et légendes réside dans le message qu'ils transportent : si nous y parvenons, alors nous avons accompli notre travail.
- C'est marrant que vous parliez de travail, c'est beaucoup moins difficile que faucher un pré ou pétrir du pain.
- Ce n'est certes pas un travail physique. Mais je vous assure qu'il réclame beaucoup de labeur.
La jeune femme souriante prend soudain la parole, tandis qu'elle pousse doucement le jeune garçon vers moi :
- A ce sujet, puisque tout travail mérite salaire... Jehan voudrait vous offrir quelque chose.
Je me penche pour être à sa hauteur, mes perles cliquetant dans mes cheveux. Il tente un sourire timide, ses grands yeux marrons reflétant les lueurs du feu, avant de me tendre un simple cailloux. Et d'une voix hésitante, il m'explique :
- C'est un caillou de la rivière, messire, que j'ai trouvé tout à l'heure. Il est très beau !
- On n'est vraiment pas riches, rajoute la mère, et on ne peut pas vous donner mieux. Mais on aime vraiment les soirées que vous nous laissez partager avec vous.
Je souris de toutes mes dents, heureux. Je ne cherche pas de richesses. Ce caillou ne vaut rien, mais il vient du cœur et ça le rend inestimable. Le plus sincèrement du monde, je réponds, tout en faisant tourner la pierre entre mes doigts :
- C'est un très beau présent, Jehan, je suis très touché par cette attention. Le conte de demain soir parlera du preux chevalier Jehan qui, jadis, sauva notre Royaume de l'invasion barbare.
Le gamin tape dans ses mains, ravi comme seuls les enfants peuvent l'être. Je n'ai pas le temps de m'adresser aux parents : le motif de la pierre attire soudain toute mon attention. C'est une pierre grise, toute simple d'apparence. Mais elle est veinée de blanc et ces lignes forment un H grossier mais parfaitement reconnaissable.
Âprefond, chapitre 1
C'est une fiction "historique", donc, même si j'aurais aimé pouvoir choisir "réaliste" ou même "crédible". Je ne suis pas docteur en histoire, autant vous prévenir tout de suite. Il n'est donc pas impossible que qu'il y ait quelques incohérences, et je m'en excuse platement. Mais j'essaie de coller au plus juste à la réalité de l'époque et j'espère que ça sera convaincant.
Le deuxième point de cette introduction comportera aussi des excuses, décidément. Je trouve génial les fictions qui proposent de la musique en début de chapitre. Et j'ai pensé que ça pourrait être sympa de vous faire découvrir de belles musiques tsiganes par le biais de cette fiction. Mais autant vous prévenir tout de suite : je n'ai absolument pas l'oreille musicale. Et c'est vraiment pas évident de trouver une musique qui collera aux différents passages des chapitres. Donc j'espère ne pas tomber totalement à côté de la plaque. Si c'est le cas, s'il vous plait, dites-le moi, histoire que je ne sois pas trop ridicule.
Suggestion de musique : Bratsch - Avenasto Trapezimou
Bonne lecture à tous et à toutes !
Les bières sont posées sans douceur sur la longue table de bois brut, constellée de rayures et de ronds blancs. Le liquide ambré, dégoulinant des chopes en ferraille, vient encore en assombrir le plateau. Je feins de m'y intéresser, le temps que l'aubergiste s'en aille sans avoir prononcé un seul mot.
Dès que nous avons franchi les portes de sa gargote, cet homme rubicond, à la panse plus que généreuse, nous a dardé de son regard mauvais. Et même en présentant la somme due, bien avant de voir la couleur de la bière, il a rechigné à nous servir. Mais nous sommes allés nous asseoir, sans un mot plus haut que l'autre. Question d'habitude. C'est à contrecœur qu'il nous a servi, je le sais, et c'est avec impatience qu'il attend de nous voir quitter son auberge.
Le printemps cèdera bientôt sa place à l'été et nul feu ne brûle dans la cheminée. Son crépitement aurait alors été le seul son audible dans cette grande salle en terre battue, hérissée de tables et de bancs bancals. Les autres clients nous observent, nous jaugent, dans le silence le plus complet. Même l'aubergiste nettoie les chopes avec un chiffon d'un brun douteux sans le moindre bruit. Les conversations ne reprennent pas. Les regards restent figés sur nous. On boit en silence la plus mauvaise bière qu'il a daigné nous offrir, tiédasse. Question d'habitude ou non, nous sommes pressés de repartir.
Nous aurions pu nous en passer facilement. Nous ne sommes pas exigeants, en termes de besoins. Mais la rencontre avec le conseiller du Seigneur du fief, et la longue route que nous avons fait plus tôt, rendaient une bière tentante. Et nous allons rester plusieurs jours. Quel est le meilleur endroit pour juger d'un village que l'antre où les hommes viennent se ressourcer après une journée de dur labeur ?
Les premiers chuchotements se font entendre, comme si leur examen était terminé. Ou comme si, bon gré mal gré, ils acceptaient cette présence, faute de raison suffisante pour nous mettre dehors. A ce signal tacite, les autres tablées se mettent à leur tour à chuchoter, et c'est un étrange bruissement qui se fait entendre entre les murs aux pierres grossièrement taillées. Je me détends quelque peu. Notre présence n'est jamais acceptée immédiatement, il leur faut toujours du temps. Et elle n'est jamais acceptée totalement, mais pour ça, le temps n'arrange rien.
Ce village et ce fief ne sont jamais qu'une étape dans notre voyage sans fin. Un amas de masures et une poignée de visages burinés par le soleil, aux yeux méfiants et curieux. L'arrêt à l'auberge, ou ce qui s'en approche, est un moyen comme un autre pour juger si notre présence sera tolérée ou non. Car si certains viennent se repaître de nos histoires, le soir, au coin du feu, non loin de notre campement, ce sont souvent les mêmes à recompter le nombre de leurs poules après notre départ. Sans même parler de ceux qui nous rejettent en bloc. Mais certains se laissent tenter par ce que nous leur proposons : contes, chants, tours de force ou d'habilité. Nous égayons leur quotidien le temps d'une semaine ou deux, puis nous reprenons notre route. Et malgré les soirées partagées, ils sont soulagés de nous voir partir. Nous avons appris à nous méfier de ceux qui acceptent trop bien notre présence. Souvent des femmes. Qui, sans subtilité, veulent s'acoquiner avec les hommes les plus musclés, frisson d'interdit. Et qui vont, ensuite, pleurer dans les chemises de leurs maris, hurlant au viol.
Les Seigneurs aussi aiment notre présence. Nos récits devenus d'ailleurs, nos chansons exotiques. Juste le temps de se distraire, de casser la routine confortable dans laquelle ils baignent. Ensuite, eh bien, eux aussi estiment que notre présence a suffisamment duré. Et ils nous font clairement comprendre que nous serions mieux ailleurs. N'importe où mais ailleurs.
Mon regard parcourt les hommes, assis autour des tables, qui discutent comme si nous n'étions pas là, laissant même parfois échapper un rude éclat de rire. A quoi bon continuer ? A quoi bon parcourir chaque maudite route de ce maudit royaume, pour croiser, toujours, cette même méfiance, cette même haine ?
Une ombre furtive accroche mon regard. Derrière le comptoir émerge une tignasse hirsute et deux grands yeux curieux. Le sourire revient sur mes lèvres. C'est pour ça. Parce que les yeux émerveillés des gamins, leurs éclats de rires et leurs mines effrayées sont la plus belle récompense au monde. Parce qu'embarquer un enfant dans un conte, le faire frémir et sourire, c'est bien plus important que toutes les menaces des adultes. Et parce que certains adultes, eux aussi, ont gardé une âme d'enfant et une même propension à s'émerveiller. Mon cistre à la main, apportant nouvelles du royaume et récits fantastiques, ma vie est ainsi faite. Je ne la conçois qu'ainsi. Je l'aime ainsi.
C'est un brouhaha sonore qui règne désormais dans l'auberge, tandis que nos chopes se vident peu à peu. Personne n'est venu nous parler, mais ils ne le font guère devant leurs amis. Ils attendent le soir, pour se faufiler entre les maisons et s'approcher discrètement de notre campement. Là, enfin, ils osent avouer leur curiosité. Jamais devant les autres. Devant les autres, comme en ce moment, ils rient, de nous peut-être, se vantent et se montrent durs. Mais soudain, la porte qui grince fait taire le bourdonnement.
Le gamin a disparu. L'aubergiste a lâché son chiffon sale et se tient droit derrière le comptoir. Il ne souhaite pas la bienvenue avec un sourire ou un visage avenant, pas plus qu'il ne darde un regard mauvais. Il reste figé, les mains tremblant légèrement et ses prunelles fixant intensément son chiffon. Les autres clients gardent le silence, et soudain, c'est comme une chape de plomb qui s'abat sur la pièce, la rendant suffocante.
Le nouveau venu fait deux pas sur le sol en terre battue avant de s'immobiliser. Tandis que son regard parcourt lentement la salle, je l'observe. Ce n'est pas un villageois. Tout de noir vêtu, il ne cache pas les deux longues dagues qui pendent à sa ceinture. Des cheveux mi-longs, bruns, encadrent un visage fermé, sans expression, n'invitant certainement pas à la sympathie. Un glapissement effrayé s'échappe d'un gros bonhomme, assis à une table, sur qui le regard de l'homme s'est arrêté. Le nouveau venu s'approche de lui d'un pas souple, presque félin, plein d'assurance. Les visages se font blêmes, dans la tablée, mais personne ne se lève, personne ne bouge, personne ne souffle un mot. Comme des proies cernées par le chasseur, ils restent immobiles, pétrifiés. Sans hésitation, le nouveau venu vient se placer tout près du gros bonhomme, se penche vers lui, main sur la garde de sa dague et lui souffle quelques mots à l'oreille.
Tous les regards sont rivés sur eux, et je devine dans beaucoup du soulagement. Soulagement de ne pas être la proie de ce prédateur qu'ils redoutent tous. Les bajoues du gros bonhomme tremblent lorsqu'il acquiesce au chuchotement, et sa main tâtonne nerveusement avant d'extraire de sa bourse une poignée de piécettes qu'il fait choir sur la table. A grands gestes maladroits, il réunit une somme qu'il remet à l'homme en noir. Lorsque ce dernier se détourne, après avoir empoché l'argent et soufflé quelques mots supplémentaires à l'homme frémissant, il nous examine un instant. Juste le temps pour nous d'apercevoir, sur toute sa joue gauche, un énorme H de chair boursouflée qui part de la mâchoire et s'arrête juste sous l'œil. Son visage et ses yeux sont indéchiffrables. En quelques souples enjambées, il quitte l'auberge sans un regard derrière lui.
Nous sentons distinctement la tension retomber, dans la grande salle. Le gros bonhomme reste prostré sur son banc et ses compagnons n'osent souffler mot. Le silence perdure, lourd. Voel se lève, d'un geste lent, et comme un seul homme, nous l'imitons. Les villageois que nous rencontrons considèrent régulièrement Voel comme notre chef, et nous ne leur donnons pas tort. C'est qu'il est grand, Voel, et fort en plus. Il n'est guère âgé, ses cheveux mi-longs n'ont pas commencé à grisonner, mais sur son visage tanné par le soleil se lisent maturité et responsabilité. Mais il est tellement plus que ça, pour nous, à la fois père, mentor, confident. Il est le pilier qui nous donne la force d'avancer et la foi en ce que nous faisons.
Il se contente d'un geste de la main pour prendre congé. Si nous avons l'habitude d'être mal reçus, nous ne poussons pas le vice jusqu'à les remercier de leur accueil. Nous étions quatre dans l'auberge, les autres étant restés au campement avec les femmes et les enfants. Nous marchons de front, prenant toute la largeur de la rue. Les habitants interrompent leurs activités pour nous dévisager. Nous ne passons pas inaperçus et ils ne peuvent manquer de savoir qui nous sommes. Nos tenues, parfois aux couleurs éclatantes, nos bijoux de bronze et nos cheveux agrémentés de perles crient notre appartenance au cercle des saltimbanques. Voel, Gabor et Ysayo discutent de l'installation et de nos besoins dans ce village. Jamais ils ne parlent de leurs premières impressions dans la rue, trop d'oreilles traînent. Je les écoute distraitement, sur mes gardes. L'homme en noir est parti depuis peu, et il doit être tout proche. Malgré nos bijoux en bronze, nous ne sommes pas riches, mais il ne peut pas le savoir. S'il a osé s'en prendre, devant tous les clients de l'auberge, au gros bonhomme, il n'hésitera sans doute pas à s'attaquer à nous. Voire à attaquer le camp.
Nulle trace de l'homme en noir, sur notre route, mais c'est avec soulagement que je retrouve notre campement. Les éclats de rire des enfants qui jouent, courant entre nos maisons ambulantes, les femmes qui s'affairent, en pleine discussion, les hommes qui installent rondins et grosses pierres autour du futur feu de la veillée, c'est mon quotidien et il est rassurant. Voel a décidé d'installer le campement sur la berge de la rivière, assez éloigné du point d'accès principal, pour que les villageois n'aient pas à se plaindre de nous voir tous les matins. Assez proche, pourtant, pour ne pas empiéter sur les champs, et pour éviter tout problème.
Nos maisons ambulantes sont en réalité des charrettes aménagées par Ysayo, notre menuisier attitré. A partir de simples plateformes en bois, sur quatre roues, il a bâti des cloisons, un toit étanche. Puis l'intérieur a été aménagé. Des lits, des coffres pour nos quelques possessions, des tissus pour se préserver du froid hivernal. Ce ne sont pas des palais, mais je m'y sens chez moi, en sécurité. Les bœufs ont été libérés de leurs attelages et placés dans un parc sommaire, fait de cordes et de pieux. Les poules picorent l'herbe dans leur cage, tandis que les chiens sont laissés en liberté. Le cuir tanné qui sert de porte laissé ouvert, je vais prendre mon ballot de linge sale, du savon et une brosse. Puis, après avoir fait signe à Voel que j'allais à la rivière, je m'éloigne du campement.
La lessive est un travail de femme. Si j'étais marié, je n'aurais pas à m'en occuper. Filippia s'en charge parfois pour moi mais je perds une excuse pour m'isoler un moment. A genoux au bord de la rivière, je regarde les vêtements s'imbiber d'eau. Puis mes pensées vagabondent. Nous devons faire vite. Djidjo a négocié avec les paysans pour avoir blé, choux, raves et viande séchée. Il faudra du temps pour qu'ils réunissent tout ce dont nous avons besoin. Et puis, surtout, les essieux et les moyeux sont chez le forgeron du village, les réparations payées d'avance, comme toujours. Nous n'avons pas eu besoin de lui demander de s'en charger rapidement : il sait très bien que tant qu'il a ces pièces, nous ne pourrons pas repartir. Et à son regard, j'ai compris qu'il avait envie que nous repartions au plus vite. Deux roulottes sont immobilisées. Nous détestons cette contrainte, ce sentiment d'être coincés, comme pris au piège. Notre vie, c'est également d'être prêts à partir dans l'heure. Question de sécurité.
C'est que le regard désapprobateur du conseiller qui nous a reçu, un peu plus tôt dans la journée, nous a enlevé toute illusion. Notre présence est tolérée en attendant le retour du Seigneur du fief qui prendra la décision finale. Quelques jours, tout au plus. Le château, tout en angles et pierres grises, sans la moindre fioriture ni décoration, est bien plus accueillant que cet homme. Je me demande pourquoi il nous a autorisé à rester. Je suis convaincu que, si ça ne tenait qu'à lui, nous serions déjà loin. Et pourtant, à en croire ce château, le Seigneur des lieux n'est pas homme à apprécier l'originalité ou le changement. Je redoute qu'à son retour, nous devions quitter les lieux au plus vite.
J'espère que les réparations seront terminées. Et j'espère que nous aurons suffisamment de succès pour nous procurer des provisions. Nous avons déjà reçu pire accueil. Peut-être qu'ils seront nombreux, les villageois, à oser s'approcher. Je ne doute pas un seul instant que toute la vallée d'Âprefond est désormais au courant de notre présence. Ceux qui sont intéressés viendront, nul besoin d'invitation. Et comme le veut la coutume, ils nous laisseront, pour le spectacle offert, de la nourriture, des bibelots, des aiguilles ou du tissu. Nous prenons tout, nous ne somme pas vraiment en position de faire la fine bouche. Voel aime raconter le temps où nous ….
- Yoshka ? Yoshka ?
Je me redresse vivement. Gabor se tient face à moi, sourcils froncés. Les battements affolés de mon cœur se calment peu à peu et je lui adresse un faible sourire. D'un geste du menton, il me désigne le tas de linge qui baigne dans la rivière et lâche :
- Je crois que cette chemise est assez propre.
J'ai frotté chaque pièce de tissu mais la dernière chemise porte les marques visibles de la brosse. Sans doute ai-je inconsciemment fait durer un peu trop, pour ne pas interrompre mes pensées. Je lui adresse un petit sourire contrit, hausse les épaules et essore les vêtements. Il éclate de rire et je me surprends à l'imiter. Nous nous connaissons depuis toujours. Certains seraient surpris de voir ce colosse rire comme un enfant. Ses cheveux toujours emmêlés, ses habits toujours débraillés, son sourire pétillant lui confèrent beaucoup de charme, malgré sa carrure impressionnante. Il le sait, en use et en abuse. Il aime trop butiner à droite et à gauche pour se poser sérieusement avec une femme. C'est pour ça que nous habitons tous deux dans la même roulotte. Les deux seuls célibataires de notre troupe. Je le connais aussi bien qu'il me connaît, et c'est pour cette raison qu'il est venu me chercher. Il ne craignait pas que je me sois noyé mais que je perde toute notion du temps. Et il n'avait pas tort.
- Je ne vois pas pourquoi tu t'obstines à faire ta lessive.
- Ce n'est pas parce que toi, tu trouves toujours une jolie femme prête à nettoyer tes vêtements pour tes beaux yeux que je dois en faire autant.
- Tu pourrais, pourtant. Question beaux yeux, tu n'as rien à m'envier.
Je ne relève pas sa remarque. Il a raison, mes yeux sont mon principal atout de séduction : très clairs, étrangeté pour mon peuple, ils varient du bleu au vert en fonction de la couleur du ciel. Je sais qu'ils plaisent. Un visage au traits réguliers les entoure, classique, ni beau ni laid, qui ne ruine pas leur effet. Mais ça ne change rien à l'histoire. Tandis que nous marchons lentement en directement du camp, je hausse les épaules et rétorque, d'un ton faussement fâché :
- Je ne me prostituerais pas pour qu'une garce récure mes fonds de caleçon.
- Tout de suite les grands mots ! Il s'agit simplement d'exploiter au mieux les capacités naturelles des femmes.
Je lui jette un regard en coin, le sourire sur les lèvres. Ni lui ni moi ne pensons la moindre parole prononcée. Mais hors de question de le laisser avoir le dernier mot. Alors je lâche, provocateur :
- Si Filippia était là, tu n'oserais pas dire un tiers de ce que tu viens de dire.
Ma réplique a fait mouche, et il marmonne une vague excuse pour s'éloigner de moi et se précipiter au campement. Je suis un imbécile. Je n'ignore rien des sentiments qu'il éprouve pour Filippia. Seulement il est incapable de cesser de séduire et de se contenter d'une seule femme. Et Filippia, malgré des sentiments réciproques, est incapable d'accepter cela de la part de son mari. Elle en a épousé un autre. Et lui cherche vainement à l'oublier dans les bras de femmes anonymes. Sur la corde tendue entre deux roulottes, j'étends soigneusement mes chausses et chemises, songeur.
Gabor aussi s'est aventuré sur un terrain glissant. Il sait très bien pourquoi je ne fais pas les yeux doux à une femme pour ma lessive. Il le sait car nous nous connaissons comme deux frères. Et même s'il ne me rejette pas pour ça, même s'il semble s'en moquer, il ne manque jamais une occasion de me taquiner à ce sujet. Il est le seul, avec Voel, à savoir. Ce serait trop …
- Yoshka ?
Je sursaute et me retourne d'un bond. Voel me fait face, soucieux, et décrète :
- Tu crois que les fixer du regard les fera sécher plus rapidement ?
Voyant que je peine à comprendre ses propos, il me désigne d'un geste de la tête mes vêtements étendus sur la corde. Je hausse les épaules, passe une main dans mes cheveux, faisant cliqueter les perles de verre coloré qui les parsèment.
- Il fallait bien que je j'infirme cette théorie.
Il marque un temps d'arrêt avant de me donner une grande claque sur l'épaule en riant. Je grimace un sourire tandis qu'il m'annonce :
- Nous allons bientôt dîner. Tu as une nouvelle histoire à nous raconter, pour ce soir ?
- Oui, tout récente.
D'un geste vague, je désigne ma tempe, et il comprend que je l'ai inventée dans la journée, tandis que nos roulottes s'avançaient au creux de la vallée d'Âprefond, inspiré par les paysages verdoyants.
- Bien. Très bien. Que penses-tu de ce fief ?
Je m'avance à pas lents vers ma roulotte, tête baissée. Voel aime avoir nos impressions lorsque nous arrivons dans un nouvel endroit. C'est un signe de grande humilité, je trouve, alors je prends toujours le temps d'y réfléchir avant de lui donner mon avis. Il m'a emboîté le pas et n'a donc pas de mal à entendre ma sentence :
- On a déjà reçu pire accueil. Et meilleur. Il faudra se tenir prêts à partir au plus vite. Et puis, il y a cet homme en noir.
- Oui, il m'inquiète aussi.
Nous n'avons pas besoin d'en dire plus. Voel m'a côtoyé chaque jour de mes vingt-cinq années de vie. Il connait le fond de ma pensée, et la réciproque est vraie. Alors il hoche simplement la tête, me tape à nouveau sur l'épaule, et s'éloigne.
Je ne traîne pas plus que de nécessaire dans ma roulotte, et je me hâte de rejoindre les autres. Djidjo est parvenue, comme toujours, à nous préparer des merveilles à partir de rien. Aidée de quelques femmes, elles nous ont cuisiné des tubercules dans un bouillon de poule, assaisonnés d'herbes cueillies au bord de la route. Ce n'est pas un repas pantagruélique, mais il est savoureux et les portions copieuses.
La nuit succède au crépuscule, et désormais, seul le feu crépitant illumine le campement. Les reliefs du repas sont rangés et la vaisselle lavée. Les villageois arrivent par petits groupes, tenant leurs enfants impatients par la main, s'installant timidement sur les rondins de bois. Nous les attendions, nos instruments sortis, pour partager avec eux la musique qui réchauffe les cœurs et les récits qui emmènent loin d'ici. Je marque la mesure en tapant dans mes mains, encourageant les villageois à en faire autant. Les musiques endiablées, portées par les voix magnifiques de nos femmes, font fourmiller les corps et invitent à danser. Peu s'y risquent, toutefois, malgré Filippia qui, tel un feu follet, va de l'un à l'autre pour se faire offrir une danse. Voilà en vérité ce qui me fait affronter les regards méfiants : cet instant de communion où, qu'importe la provenance des gens, nous partageons la même joie grâce à la musique. Les enfants du village jouent avec nos enfants, les hommes et les femmes se mêlent pour danser, et les rires ont tous la même intensité.
Un mouvement dans l'ombre attire soudain mon attention. Il est presque illusion, silhouette toute de noir vêtue dans l'obscurité. Mais le feu dansant se reflète dans ses prunelles et la clarté de son visage est bien visible. L'homme en noir de la taverne. Nos regards se croisent pendant une fraction de seconde. Je détourne bien vite les yeux, le cœur battant la chamade. La surprise m'a fait perdre le tempo, et je peine à revenir à la fête. Voel me jette un regard interrogateur et je m'empresse de le rassurer d'un léger sourire. Puis, me faisant violence, je me concentre sur le rythme de la musique. Comme si de rien n'était. La fête doit continuer.
Iduvief, épilogue
Il règne un silence sépulcral dans la bibliothèque qui fait office de bureau. L'odeur de cire, de vieux parchemin et d'encre est omniprésente, pour le plus grand plaisir de Calith.
Il se masse doucement les tempes, essaie de se concentrer sur le dossier étalé devant lui. Les rayons du soleil se déversent à flots sur son bureau, uniquement atténués par la fenêtre translucide. Elihus lui a remis le rapport, avant de retourner aux archives. Comme tous les mois, il a passé sa matinée en réunion avec les différents responsables du château : Voinon, Alima, mais aussi le Chef de cuisine, la lingère, le capitaine des gardes et encore tout une flopée de gens importants pour le bon fonctionnement. Calith déteste ce genre de réunion mais il s'y rend de temps en temps, sous la menace d'Elihus. Par contre, il est obligé, tous les mois, de lire le rapport de cette fichue réunion, et de prendre les décisions qui s'imposent. Et à chaque fois, Elihus, prudent, disparaît à ce moment-là.
Fáelán est installé sur un tapis moelleux, et joue sans bruit avec son bout de tissu. Quand il a été question de le laver, pour ôter cette odeur d'écurie, il s'est mis à pleurer bruyamment pour la première fois. Alors ils ont renoncé, et le laissent l'emmener partout. Iezahel ressemble à une statue, tant il est immobile et silencieux, debout près de la porte. Calith sait pourtant qu'à la moindre intrusion, son amant le défendra dans la seconde. Ils sont si discrets qu'on aurait vite fait d'oublier leur présence. Mais l'esprit du roi, peu enclin à s'intéresser au satané rapport, revient sans cesse vers eux.
Il est sur le point d'envoyer balader le compte rendu, quand Iezahel déclare :
- Loundor arrive et il n'est pas seul.
Ravi de l'aubaine, Calith délaisse le rapport et se tourne vers la porte, qui s'ouvre moins d'une minute plus tard. Loundor laisse passer Iris, avant de s'avancer à son tour dans la bibliothèque. Ses longs cheveux noués en tresse qu'elle a enroulé sur sa nuque, vêtue d'une simple robe couleur crème, elle est magnifique. Son visage commun est illuminé par ses yeux d'un bleu profond, qui reflètent toujours une douceur infinie. Possessif, Loundor se tient à côté de sa femme, une main sur ses reins, et déclare :
- Nous avons pris une décision, Majesté.
Calith esquisse un sourire en l'entendant : comme d'habitude, il ne s'encombre pas de politesse superflue et va droit au but. C'est pourtant avec une légère pointe d'appréhension qu'il attend la suite : Loundor prend rarement la peine de l'informer de décisions concernant son couple. Et si Iris est présente, c'est que ça concerne leur couple. C'est d'ailleurs elle qui, contre toute attente, déclare :
- Loundor m'en a parlé et m'a laissé le temps de la réflexion. Si vous êtes d'accord, Sire, j'aimerais m'occuper de Fáelán dans la journée.
Elle laisse retomber le silence et darde son regard doux et franc sur Calith. Calith, bien en peine de lui donner une réponse tant il est pris au dépourvu. Bien sûr, ce serait la solution idéale : elle a élevé trois garçons, trois Loundor miniatures. D'après Iezahel, les loups-garous de naissance engendrent plus souvent des lycanthropes que ceux qui ont été mordus, raison pour laquelle aucun des fils de Loundor n'est un loup-garou. Mais ça n'a pas dû être de tout repos pour autant, et elle a parfaitement su les élever. Épouse de Loundor, elle en connaît un rayon sur la lycanthropie et ne risque pas de s'enfuir en courant en voyant Fáelán se transformer. Et puis, bien sûr, les appartements de Loundor sont légèrement éloignés du cœur du château, puisqu'ils se situent non loin de la caserne. Fáelán pourra ainsi grandir avec d'autres garçons, sans le regard de la cour rivé sur lui. Mais avant de prendre la moindre décision, Calith veut l'accord de son compagnon, alors il se tourne vers lui et demande :
- Tu en penses quoi, Iezahel ?
Fáelán s'est levé à l'arrivée de Loundor et caché entre les jambes de son père, il scrute les nouveaux venus, comme conscient que son avenir se joue actuellement. Iezahel semble impassible, son beau visage figé dans un masque indéchiffrable, le corps souple et détendu. Mais Calith le connaît suffisamment pour deviner que derrière cette apparence calme, l'esprit de son compagnon est en ébullition. Iris se tourne un peu, de manière à avoir les deux dans son champ de vision, et déclare, comme pour les convaincre :
- Si vous êtes d'accord, vous me l'amenez dans la matinée, à l'heure que vous voulez. Il mangera le midi avec les enfants, et je l'occuperai toute la journée. Et vous pourrez venir le récupérer à l'heure qui vous arrange.
- C'est d'accord pour moi.
La voix de Iezahel est claire, assurée. Pourtant, Calith y décèle bien des sentiments qu'il se promet d'aborder avec lui, quand ils seront seuls. En attendant, il confirme :
- Nous sommes d'accord. Merci beaucoup pour ta proposition, Iris, je suis convaincu que Fáelán sera heureux avec toi.
- Je ferai tout pour qu'il en soit ainsi, Sire.
Elle s'incline légèrement, puis s'approche lentement de Fáelán. Il hésite un court instant, avant que le regard rassurant de son père ne le convainc de s'avancer vers Iris. Elle se penche pour le prendre dans ses bras, l'embrasse doucement, et dans un murmure, lui explique qu'il va aller avec elle, mais qu'il retrouvera bientôt son papa. Puis sans brusquerie, elle quitte le bureau royal, Fáelán lançant un regard poignant à son père par-dessus son épaule.
Iezahel est visiblement ému de voir partir son fils, mais ne bronche pas. Un rapide coup d'œil à la fenêtre translucide indique à Calith que le crépuscule arrivera dans une paire d'heure : la séparation ne sera pas trop longue.
Loundor, resté dans le bureau, bougonne :
- J'ai pensé que c'était une bonne solution. Elle va bien s'en occuper. Glial est parti ce matin ?
- Oui, avec le tribunal. Ils nous enverront un message lorsqu'ils seront arrivés.
- Parfait. Aucune nouvelle de Nyv' ?
- Pas pour le moment, non.
- Ils ne devraient plus tarder, maintenant... Bon, je dois retourner auprès de mes soldats, je vous laisse.
Loundor, comme gêné par cette conversation qui doit lui sembler futile, tourne vite les talons. C'est pourtant bien normal qu'il demande des nouvelles de son éclaireur. Et c'est normal aussi de s'inquiéter du départ de Glial et du tribunal.
Glial, cet homme dans la force de l'âge, passionné lui aussi par la paperasse et les règlements, ancien assistant de l'économe du château. Elihus l'a débauché et a voulu le former au rôle d'archiviste, mais il a bien dû se faire une raison : l'homme s'étiolait enfermé entre quatre murs, lui qui rêve de rencontrer des gens et de les aider aux quotidien. Mais c'est aussi un homme sûr de lui et de son savoir, avec les épaules suffisantes pour tenir bon quand on remet en cause ses décisions. Le lendemain de leur retour, il y a deux jours, Calith a résumé leur séjour à Iduvief et expliqué ses décisions à Elihus, qui a tout de suite vu en Glial l'homme de la situation. Et Glial n'a pas hésité bien longtemps avant d'accepter la proposition de devenir le bras droit de Marsylia.
Il ne lui a fallu que deux jours pour rassembler ce dont il avait besoin, et pour que le tribunal se libère de ses obligations. A l'aube, ils ont pris la route, en direction d'Iduvief et Calith est rassuré : ils se montreront à la hauteur de la tâche qui les attend.
Iezahel a repris sa veille silencieuse, comme si de rien n'était. Entre deux maux, Calith a du mal à choisir : aborder des sujets douloureux avec son amant, ou terminer ce foutu rapport. Finalement, bien conscient de sa lâcheté, il se concentre sur le compte-rendu. Après tout, c'est l'affaire d'une petite heure et il en sera débarrassé après.
Le temps file et le soleil est déjà dangereux bas à l'horizon quand il redresse la tête. Le dossier est couvert d'annotations diverses et variées, de quoi convaincre Elihus qu'il a sérieusement travaillé. Il pousse un long soupir de soulagement, se tourne vers Iezahel avec un petit sourire. Mais Iezahel est concentré, la tête penchée sur le côté, et murmure :
- Jérémias est en train de discuter avec Nyv' dans le couloir. Il est en pleine panique parce qu'il ne sait pas s'il peut le laisser entrer alors il parle pour ne rien dire.
- Pourquoi tu n'es pas allé lui dire de le faire rentrer ?
- Tu étais occupé. Et c'était plutôt amusant.
Calith hausse un sourcil et prend une mine réprobatrice, même s'il doit bien se l'avouer, lui aussi s'amuse de la maladresse de Jérémias. Dans un grondement affectueux, il ordonne :
- Va le chercher.
Iezahel s'exécute sans rechigner et laisse entrer peu après Filraen, Nyv' et Severin. Calith ordonne à Jérémias d'aller chercher Elihus et Loundor, et de faire venir des boissons et de quoi grignoter.
Tandis que Iezahel tire des chaises pour que les arrivants puissent s'asseoir, Calith observe Severin. Il se tient bien droit, son visage n'accusant plus le contre-coup de sa terrible nuit à descendre d'Iduvief en pleine tempête de neige. Mais il semble tout de même épuisé, et il vacille légèrement, se tenant tout près de Nyv', comme en prévision d'une chute soudaine. Il attend pourtant l'ordre de Calith pour s'asseoir, un temps après Filraen et Nyv'. Ils ont dû venir ici immédiatement après leur arrivée, car leurs joues sont rougies par le froid, et ils sentent le cheval. Iezahel se tient droit derrière la chaise de Calith, silencieux et immobile, ce qui semble surprendre Filraen. Mais quand Calith demande comme s'est passé leur voyage, il répond avec assurance :
- Fort bien, Votre Majesté, fort bien ! Nous sommes restés trois jours à L'Hydre qui fumait. Xalaphas s'est montré très agréable et très attentionné. Il nous a permis de nous installer à l'étage la seconde nuit, car Severin allait un peu mieux et n'avait plus besoin d'être dans une pièce aussi chaude. Il faut quand même reconnaître que c'était bien plus confortable que de dormir sur une chaise. Enfin, il a été charmant. Seule Hilda s'est montrée légèrement menaçante quand j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il n'était pas bon de tant donner à manger à un malade. Elle n'a rien voulu entendre, a haussé le ton, et s'est même permis de me dire qu'elle n'avait pas de leçon à recevoir d'un gringalet comme moi qui, de toute évidence, est totalement imperméable aux plaisirs de la bonne chair.
Il frissonne longuement et Calith doit se mordre les lèvres pour ne pas éclater de rire. Elihus, comme désœuvré par l'absence de son roi, a entassé des dizaines de dossiers absolument pas importants à traiter de toute urgence, et après une journée à potasser tout ça, Calith apprécie vraiment la fraîcheur et le bavardage du mage. Nyv' et Severin sont côte à côte, et à mesure que Filraen parle, ils semblent se rapprocher de plus en plus, donnant l'impression de faire bloc contre son babillage. Mais le mage poursuit, comme si de rien n'était :
- Oh ! Et nous avons rencontré son garçon d'écurie, un homme charmant, lui aussi, très élégant et raffiné ! Nous avons longuement discuté des soirées entières, il était très calé en créatures surnaturelles et se montrait passionnant quand il en parlait. Enfin, Severin allait de mieux en mieux, et nous avons pu reprendre la route plus tôt que je ne le pensais. Ses engelures étaient encore un peu douloureuses, mais le risque d'infection était passé. Quant à ses problèmes respiratoires, ils étaient nettement sur la voie de l'amélioration. Xalaphas était navré qu'on parte si tôt, d'autant qu'il nous a certifié que vous aviez prévu large pour notre séjour et que nous pouvions encore rester un peu. Il a également essayé de savoir qui vous étiez, Sire : je crois que vous l'avez vraiment marqué. Mais nous n'avons rien dit, Sire, je vous le jure, il ignore qui vous êtes !
- Pas pour longtemps : le lendemain de notre retour, j'ai demandé à l'ébéniste de la cour de graver une petite plaque de remerciement et je lui ferai parvenir dès qu'elle sera prête. Des remerciements royaux devraient apporter un petit avantage à son auberge, qui aura plus de clients.
- Il est très embêté à ce sujet, il est convaincu que c'est à lui de vous remercier, et non l'inverse. Et je dois bien avouer que je suis plutôt d'accord avec lui... Enfin, bien entendu, je ne remets pas en cause votre décision, qui est sage et juste, mais je comprends...
L'arrivée de deux esclaves, apportant vin chaud et petits biscuits sablés, coupe court aux justifications hasardeuses de Filraen. Le silence règne pendant une poignée de minutes, tandis que les voyageurs se réchauffent avec le vin chaud. Filraen, conscient qu'il était sur un terrain glissant, reprend la parole en changeant de sujet :
- Nous avons donc quitté l'auberge au matin, et nous avons fait halte au monastère de Pòrr. C'était absolument fascinant ! Je n'étais jamais allé dans ce genre d'endroit, heureusement que Nyv' me l'a conseillé car je n'aurais jamais pensé à m'arrêter là-bas. Ils ont été vraiment très chaleureux, et j'ai pu discuter avec l'acolyte responsable de l'infirmerie. Nous avons échangé énormément de recettes de remèdes, car il en connaissait beaucoup, dont certaines n'apparaissent même pas sur les parchemins que j'ai en ma possession ! Heureusement, j'ai pu lui apprendre quelques petits trucs mais il en ….
La porte s'ouvre, laissant entrer Loundor et Elihus. Le soulagement de Nyv' et Severin est palpable et le roi devine sans peine à quel point le trajet a dû leur paraître long, eux qui souhaitaient sans doute roucouler en paix, alors que le mage n'arrêtait pas de causer. Ses deux conseillers assis, Calith fait les présentations :
- Filraen, Severin, voici Elihus, mon bras droit avec Loundor, qui m'aide énormément dans toute la partie … paperasse. Enfin, les archives, les décrets, les décisions administratives, ce genre de choses. C'est un homme de confiance, avec qui vous pouvez parler sans crainte. Elihus, voici Filraen, mage guérisseur de son état, anciennement basé à Iduvief. Marsylia l'a mis à la porte quand il a échoué à sauver son amant de l'empoisonnement. Les quartiers de Volkhves sont toujours disponibles, n'est-ce pas ?
- Oui Sire.
La réponse d'Elihus a été claire et dénuée de sentiments, mais la simple évocation de ce nom a dû faire resurgir bien des émotions. Volkhves était le mage officiel de Pieveth à l'époque du père de Calith et c'est lui qui enseignait la magie. Malgré son peu d'attrait pour la magie, Calith l'appréciait énormément, comme tout le monde au château : c'était un homme déjà âgé, qui donnait envie d'apprendre et savait expliquer les choses clairement. Il était toujours disponible et avenant, essayant systématiquement d'aider les autres. Sa mort, naturelle, deux ans avant l'arrivée du Tyran, avait bouleversé le Roi et il s'était refusé à le remplacer. Ensuite... eh bien, le Tyran avait pris le pouvoir, amenant ses propres hommes. A son retour, Calith n'avait pas pris réellement la peine de chercher un remplaçant et les quartiers de Volkhves sont restés intacts. Avec une grande chambre, un espace dédié aux manuscrits et un atelier pour la préparation des potions, les lieux devraient plaire à Filraen. Face au silence de Calith, Elihus ajoute :
- Je demanderai à ce que les lieux soient nettoyés et Filraen s'y installera. Soyez le bienvenu.
- Mille mercis ! J'apprécie énormément votre générosité et je saurai m'en montrer digne, je vous en fais la promesse. Je soigne aussi bien les esclaves que les nobles, sans aucune distinction, toujours guidé par le besoin impérieux d'aider les autres. C'est dans ma nature, que vous voulez-vous ! Et j'ai hâte de faire plus ample connaissance avec vous, Elihus, je devine en vous un homme fort intéressant et …
- Filraen ?
- Excusez-moi Sire. Je parle un peu trop, c'est ça ?
Calith opine, amusé, et échange un long regard avec Elihus, qui semble cerner le personnage. Puis il poursuit :
- Qu'on prépare une chambre d'invité pour Filraen pour cette nuit. Et je veux que ses quartiers soient prêts pour demain : n'enlevez aucun objet, Filraen se chargera de faire le tri, il faut juste faire un peu de ménage.
Après une courte pause, pour s'assurer que tout le monde a pris note de ses ordres, il continue, sans laisser le temps à Filraen de se répandre en remerciements :
- Et voici Severin, esclave banni d'Iduvief car il obéissait à mes ordres. Severin assistait le conseiller d'Artéus : il est lettré, instruit, et très efficace. Je pensais te le confier pour qu'il t'aide aux archives.
Elihus reste muet, examine attentivement l'esclave, intrigué. Sa réserve est bien compréhensible : confier ses précieuses paperasses à un inconnu, asservi de surcroît, n'est pas chose aisée. Calith sait bien que ce n'est pas un sentiment de supériorité qui fait hésiter Elihus, mais le fait que ce soit un inconnu : il voudra juger par lui-même. Il rajoute donc :
- Je te laisse une semaine pour voir s'il te convient ou non. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas, nous trouverons autre chose. Loundor ? Il reste des chambres individuelles vacantes, dans le baraquement ?
- Oui, une poignée.
- Bien, dans ce cas, s'ils sont d'accord, j'aimerais que tu en réserves une pour Nyv' et Severin.
- Ça sera fait.
Si son visage reste impassible, impossible de manquer le sourire dans la voix chaleureuse de Loundor. Nyv' et Severin se regardent puis reportent leur attention sur leur roi pour accepter cette proposition. Les yeux de l'esclave se remplissent de larmes, et la main de Nyv' serre la sienne dans un geste qui en dit long sur leur affection mutuelle. Elihus ne rate rien de ce manège mais ça ne changera pas sa manière de traiter Severin. Calith est également persuadé que le conseiller saura ménager l'esclave, en évitant de l'envoyer faire des courses à droite et à gauche.
- Bien, je vous laisse aller vous installer et vous reposer, nous nous verrons demain je pense. Loundor, tu peux accompagner Nyv' et Severin jusqu'aux baraquements ? Elihus, j'ai encore deux mots à te dire, s'il te plait.
Filraen est conduit, par un esclave, jusqu'à sa chambre temporaire, tandis qu'Elihus transmet à un domestique les ordres de Calith. Puis ils se trouvent tous les trois dans le bureau royal, à siroter le reste du vin chaud. Calith s'apprête à parler quand Iezahel demande :
- Tu as encore besoin de moi ?
C'est bien la première fois que Iezahel lui demande ça, et il en est si surpris qu'il ne répond pas tout de suite. Il est convaincu que cette demande cache l'envie d'aller ailleurs, sans aucun doute vers Fáelán, pour voir comment ça se passe avec Iris. Et l'espace d'un instant, il est très tenté de lui refuser ça. Il apprécie énormément le petit bout, qu'il trouve mignon et agréable, et il est bien conscient de son importance aux yeux de Iezahel. A vrai dire, c'est ça le cœur du problème. Fáelán est devenu le centre d'attention de son amant. Habitué à toujours le savoir en train de veiller sur lui, pour sa sécurité et son bien-être, il a énormément de mal à accepter qu'un gamin prenne sa place. Et il se l'avoue enfin. Qu'il serait tentant de répondre que oui, il a encore besoin de lui, qu'il aura toujours besoin de cette présence bienveillante autour de lui. Mais il ne peut pas répondre ça, il ne peut pas lui refuser ce bonheur, ce serait trop cruel. Et si Fáelán le rend heureux, n'est-ce pas à le plus important ? Et puis, c'est lui qui avait lancé l'idée qu'il se fasse des amis, qu'ils ne restent pas systématiquement ensemble. Il doit rester cohérent avec ses décisions. D'une voix assurée, il répond donc :
- Non, c'est tout bon, merci Iezahel.
- A tout à l'heure.
Elihus n'a rien raté de l'échange, et une fois Iezahel parti, il demande :
- Il y a un souci avec Iezahel ? Vous ne vous entendez plus bien ?
- C'est gentil de t'en préoccuper, mais tout va bien, ne t'inquiète pas.
Brave Elihus qui, malgré son entêtement à le marier, a bien compris pour qui bat le cœur de son roi. Alors dans un sourire, Calith reprend :
- On en parlera ce soir et ça ira mieux.
- Je te fais confiance.
- Merci. D'ailleurs, tu devrais aussi me faire confiance pour Severin. Tu es méfiant, c'est normal, mais c'est un bon bougre qui n'a pas été épargné par la vie. Tu as vu pour sa claudication, forcément, mais il est aussi sourd de l'oreille gauche. Sois indulgent s'il ne te répond pas dans la seconde.
- Tu t'es encore attaché à un oisillon blessé, c'est ça ?
Calith retient un petit rire, suite à cette demande bourrue et confirme sans honte :
- Oui, c'est ça. Il a trop subi de la part d'un responsable retors et malsain. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais te voir. J'aimerais qu'on réfléchisse à une solution pour contrôler ce qu'il se passe dans le royaume. Je ne te parle pas de revenir aux milices du Tyran, mais je voudrais une équipe parfaitement impartiale, qui aurait le droit d'aller partout, et qui pourrait s'assurer que les lois sont bien respectées. Ce ne serait pas une équipe armée, elle aurait juste un rôle d'observateur, elle serait mes yeux. Et en cas de problème, elle en aviserait le tribunal. Et à ce sujet, j'aimerais un second tribunal, fonctionnant comme le premier, mais itinérant. Il se déplacerait dans le royaume au gré des plaintes, et n'importe qui pourrait y faire appel en marge des jugements des seigneurs.
- Ils ne vont pas apprécier, juger les infractions à la loi est l'une des prérogatives qu'ils aiment le plus.
- Et malgré le décret, ça conduit a beaucoup de dérives. Bon, disons qu'ils n'interviendraient pas dans les jugements des seigneurs, mais ils pourraient apporter leur connaissance de la loi à ceux qui en ont besoin, manants comme seigneur. Mieux comme ça ?
- C'est un vaste chantier que tu veux lancer, Calith, et il faudra y réfléchir de manière plus approfondie. Peut-être qu'on pourrait placer des hommes de Nala dans les différents fiefs, histoire d'avoir un œil sur ce qu'il s'y passe en tout discrétion.
- Mais ses hommes ne sont pas spécialisés dans les lois.
- Non, bien sûr, mais ils savent reconnaître une injustice ou trop de sévérité.
- Ça me gêne un peu, d'espionner les fiefs. Ils sont censés être dignes de confiance.
- Certes mais ce que vous avez trouvé à Iduvief prouve bien que ce n'est pas si simple. Ces hommes devront juste s'assurer que tout se passe correctement. Mais comme je te le disais, c'est un vaste chantier et on doit l'étudier assez sérieusement avant de faire quoique ce soit.
- On s'en occupera. J'aimerais aussi qu'on réfléchisse à la situation des esclaves. Le cas de Severin m'a ouvert les yeux : au château, nos asservis sont bien traités. Voinon est certes sévère, mais il est juste. Florain, le responsable des esclaves d'Iduvief, était une pourriture qui prenait tous les prétextes possible pour les faire souffrir. Et je...
- Tu es un grand rêveur, Calith. Tu ne peux pas faire une loi pour que les esclaves soient bien traités. Les gens achètent des asservis à prix d'or, les entretiennent et gèrent leur descendance. C'est leur propriété, ils en font ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucun intérêt à les tuer ou à les estropier trop, car leur investissement serait perdu. Au pire, ils les fouetteront un peu, les enfermeront quelques jours dans un cachot. Ça ne les tuera pas.
Calith bondit hors de son fauteuil, furieux et prêt à hurler sur son conseiller. Mais Elihus poursuit :
- Je sais. Ce sont des êtres humains et toi, tu ne les vois pas comme étant des outils de travail. Enfin, surtout, tu ne vois pas Iezahel comme ça. Je me trompe ? Si Iezahel n'était pas ton... enfin... l'élu... enfin... Bref. Si tu n'avais pas Iezahel, tu ne réagirais pas comme ça. Avant, tu te moquais pas mal des esclaves, sois honnête.
- Peut-être bien, oui ! Et alors ? J'ai le droit aussi de changer d'avis, non ?
- Bien sûr que oui, mon grand ! Mais dis-toi bien que pour la majorité des gens, les esclaves ne sont que des instruments. Et ils ne comprendraient pas cette décision. C'est comme si tu annonçais un décret visant à prendre soin de sa fourche et de sa binette, en interdisant de les laisser sous la pluie ou en obligeant les propriétaires à bien les nettoyer après usage. Sans parler de leur faire un abri bien confortable protégé du vent pour passer l'hiver. Tu serais ridicule, et tu perdrais toute la crédibilité que tu as obtenu depuis ton couronnement.
Calith lâche une bordée de jurons qui font pâlir Elihus. Il enrage car il ne sait que trop bien qu'il a raison. Tout comme il ne peut pas obliger son peuple à accepter les créatures surnaturelles, il ne peut pas obliger les plus nantis à prendre soin de leurs esclaves.
- Arrête un peu, on dirait Loundor. Calme-toi, Calith. Pour mettre en place cette idée, il va falloir trouver les mots justes, et peut-être lancer une réforme du statut d'esclave. Alors laisse-moi un peu de temps pour que je puisse y réfléchir, d'accord ?
Il cesse de faire les cents pas, et observe son conseiller. Malgré son discours, Elihus a bon fond et respecte toujours les esclaves. Alors peut-être qu'il pourra trouver une solution... Elihus, d'une voix douce, demande :
- Tu as été voir Zélina ?
- Oui, le soir de notre retour.
- Bien. Tu sais que l'accouchement est prévu d'ici un mois environ ?
- Elle me l'a dit, oui. J'espère juste que ce sera un garçon.
- Même si elle te donne un héritier, tu devras continuer à la fréquenter, tu sais ?
- Je sais, je sais. Je ne compte pas l'abandonner dans ses appartements de toute façon. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas d'amour que je n'éprouve pas affection et respect pour elle.
- Je n'en doutais pas une seconde, mon garçon. Mais même si elle te fait un héritier, tu devras lui faire un autre enfant. C'est plus prudent, au cas où l'héritier ne survive pas, même si on fera tout pour que ça n'arrive pas.
Calith gronde doucement. Ce n'est pas tant de faire un autre enfant à Zélina qui le dérange, mais le fait d'en parler comme s'il s'agissait d'un objet comme un autre. Elihus, comme s'il avait senti que la colère de son roi était sur le point d'exploser à nouveau, lève les mains en signe de reddition et déclare d'une voix douce :
- Mais tu as le temps de voir venir. On en reparlera. Respire un grand coup, calme-toi, et va retrouver ton Iezahel.
Le conseiller arbore un petit sourire qui énerve encore plus Calith. Et l'idée de rejoindre un Iezahel qui l'a laissé tomber pour aller retrouver son fils ne l'aide absolument pas à se calmer. Mais tant qu'ils sont tous les deux, il reste un dernier sujet qu'il veut aborder avec son conseiller. Alors prenant sur lui pour étouffer sa colère, il déclare :
- Une dernière chose, s'il te plait. Je voudrais que tu fouilles dans tes archives pour voir s'il n'existe pas un roi qui aurait pris comme pupille un esclave.
Le petit sourire d'Elihus disparaît brusquement, ne laissant plus que stupéfaction sur son visage. Calith lui explique, les yeux rivés sur le bureau :
- Je... Enfin, je voudrais pouvoir protéger Iezahel et Fáelán s'il devait m'arriver quelque chose. Je... Enfin, je voudrais qu'ils aient quand même une vie douce après ma mort, au lieu d'être revendus ou utilisés pour de bases besognes.
- Je n'aime pas beaucoup parler de ça, Calith.
- Je sais. Mais être prévoyant ne me tuera pas.
- Je suppose que, de toute façon, ils dépendraient de l'armée, si... enfin...
- Peut-être oui. Mais j'aimerais que tu regardes si je ne peux pas écrire dans un testament ou une paperasse quelconque mes volontés les concernant.
- Je vais m'informer, oui. Mais tu ne vas pas mourir demain, tu sais.
Calith adresse un sourire rassurant à son conseiller livide, et opine :
- Oh non. Je sais que je suis en sécurité avec vous, et j'ai bien l'intention de vivre encore très longtemps. Mais c'est juste au cas où.
- Très bien. Mais sois prudent.
- Ne t'en fais pas. Bon, je vais rejoindre Iezahel.
- Bonne soirée.
- De même.
Elihus quitte rapidement le bureau, le laissant seul avec ses pensées et les relents de sa colère. Même s'il ne voulait pas que Iezahel entende cette conversation, il regrette son absence. Il aurait aimé croiser son regard rassurant, son demi-sourire qui lui dit toujours qu'il a bien agi.
Debout à côté des étagères ployant sous les manuscrits, il ferme les yeux, essaie de calmer les battements de son cœur. Il a autorisé Iezahel a s'éclipser et il ne peut pas maintenant le lui reprocher. Tout comme il n'a pas le droit de lui en vouloir pour Fáelán. C'est avec ce leitmotiv qu'il parvient enfin à se calmer. Et il se jure qu'il sera doux et attentionné avec Iezahel quand il le retrouvera.
Il prend une grande inspiration et quitte la bibliothèque pour se rendre dans ses appartements. Mais ses bonnes résolutions vacillent quand il pousse la porte. Seule la cheminée apporte un peu de luminosité au salon. Aucune chandelle ne répand sa douce lumière, aucun bruit de se fait entendre, et aucun esclave ne s'affaire, que ce soit pour le bain ou pour le dîner qui approche. Les lieux sont déserts et sinistres. D'un pas rageur, il se rend dans sa chambre pour se changer. Et ensuite, il ira pousser une ou deux gueulantes, histoire de leur rappeler qu'il attend quand même un minimum de la part de ses sujets. Il a fait trois pas dans la chambre quand une masse se projette sur son dos, lui plaque une main sur la bouche et passe son bras autour de son ventre, immobilisant ses bras en même temps, avec suffisamment de force pour l'empêcher de se libérer. Son cœur s'emballe mais il tente de garder l'esprit clair, d'essayer de deviner qui a pu s'introduire dans ses appartements sans être vu. L'intrus s'est-il débarrassé des esclaves pour avoir le champ libre ? Il réfléchit au sort le plus utile qu'il connaisse, qui lui permettrait de se libérer sans se faire mal quand il entend :
- Tu me fais confiance ?
- Iezahel ? Mais bon sang ! A quoi tu joues, là ? Tu sais que...
- Tu me fais confiance ?
- En théorie, oui. Là maintenant tout de suite, un peu moins...
- Ne bouge pas.
Calith se retrouve libre, et commence à se retourner vers son amant. Un tissu épais se retrouve soudain devant ses yeux. Il s'apprête à le retirer quand une petite tape sur la main l'en empêche. Puis il sent le poids d'une cape sur ses épaules et un capuchon tiré sur son crâne.
- Mais qu'est-ce que tu fabriques, Iezahel ?
- Chut.
Agacé par ces évènements qu'il ne comprend pas, Calith essaie à nouveau de repousser le capuchon et de retirer le bandeau. Mais Iezahel a tout prévu, et à l'aide d'une corde souple lui noue les poignets sur le devant.
- Ça suffit maintenant, Iezahel ! Arrête ton petit jeu et libère-moi !
Mais Iezahel ne l'écoute pas. Il lui prend la main, et le traîne à sa suite. Aveuglé, Calith avance très lentement, redoutant de se cogner ou de chuter. Cette chambre qu'il connaît pourtant très bien lui semble soudain pleine de dangers. Ils avancent jusqu'aux passages secrets. Iezahel, dans un murmure, le prévient qu'il y a des marches, et le guide lentement. L'air frais sur son visage masqué lui apprend qu'ils sont sortis du château. Il a renoncé à réclamer des explications, il a cessé de jurer comme charretier : il attend de découvrir la surprise de son compagnon avant d'exploser de colère. Il avance à petits pas hésitants pendant ce qui lui semble durer des heures. Et sa colère fond à mesure qu'il avance : il a une confiance absolue en Iezahel et il sait qu'il aimera cette surprise. Ils sont là, juste tous les deux, rien qu'eux deux. Le sol devient plus pentu soudain et il s'appuie de tout son poids sur la main de son compagnon alors qu'ils descendent un sentier. Il a beau fouiller dans sa mémoire, il n'a pas souvenir d'une telle pente.
Ils s'arrêtent enfin. Privé de la vue, Calith écoute de toutes ses forces. Mais seul le bruissement du vent se faire entendre, étouffé. Il devine que Iezahel s'affaire autour de lui et il enrage de ne pas savoir ce qu'il prépare. Pourtant, même si ses poignets sont noués, il pourrait retirer le bandeau mais il n'en fait rien. Soudain, les mains de son compagnon s'aventurent sur la ceinture de son pantalon et la dénoue.
- Non non non ! Je ne suis pas d'accord ! Qu'est-ce que tu fais ?
- A genoux. Mets-toi à genoux.
Pour une raison qu'il ne s'explique pas, Calith obéit. La colère et la crainte disparaissent peu à peu, remplacées par une autre sensation qui lui fait venir le rouge aux joues. Iezahel l'a soutenu pour prévenir toute chute et cette prévenance le rassure. D'une voix boudeuse, il demande :
- Tu vas m'exécuter ?
- Idiot...
Un baiser léger vient effleurer ses lèvres et il sent Iezahel se remettre en mouvement. La cape est retirée, le laissant frissonnant. Il le libère l'espace d'un instant, le temps de lui retirer son épaisse chemise et son linge de corps, puis la corde s'enroule à nouveau autour de ses poignets. Impossible de le nier désormais : la situation l'excite. Puis en douceur, Iezahel le fait basculer sur le côté, accompagnant sa chute. Il se laisse manipuler et se retrouve allongé sur le dos, les yeux bandés, les poings liés. Sous lui, un curieux tissu réchauffe sa peau refroidie par l'air nocturne. Il sent qu'on lui retire ses bottes, qu'on soulève son bassin pour enlever son pantalon, mais il se laisse faire, docile. Il porte pour tout vêtement le bandeau sur ses yeux. Il ne cherche même pas à masquer son membre tendu, palpitant d'impatience. Il n'a pas froid, pourtant, car l'étrange couverture le réchauffe et il devine la présence d'un feu non loin de lui. Le silence retombe, et il craint un instant que Iezahel ne soit parti, le laissant vulnérable. Il sursaute soudain : Iezahel vient de lui écarter les jambes et s'installe entre.
- J'ai rêvé d'une grotte oubliée de tous, où régnait une douce chaleur. Le sol était recouvert de peaux de bête, et tu étais allongé là, indécent, alangui, parfaitement nu, n'attendant que ma venue. Et je venais, conquérant, savourer ta peau et …
Le bandeau glisse contre son visage, dénoué, Il est dans la petite grotte cachée dans la Falaise, dont le sol a été recouvert de peaux de bêtes et l'ouverture masquée par une vieille couverture, les protégeant ainsi du froid. Un petit feu crépite non loin, apportant lumière et chaleur. Il cligne des yeux, s'habituant petit à petit au retour de la lumière. Son excitation n'a pas diminué, au contraire. Il se souvient du rêve que Iezahel lui avait raconté, au monastère de Pòrr. Iezahel, agenouillé devant lui, torse nu. Son ventre musclé, son torse recouvert d'une fine toison noire, son collier qui reflète la lueur des flammes. Et son regard brûlant de désir, malgré une pointe d'appréhension.
- Et dans ton rêve, tu m'avais ligoté comme un rôti et aveuglé ?
- Ligoté comme un rôti, tout de suite les grandes comparaisons. C'est juste les poignets !
- Mais tu m'as traîné là contre mon gré...
Iezahel hausse un sourcil, et passe innocemment le bout de son doigt sur le membre raidi de désir de son amant. Et dans un murmure, il rétorque :
- Ose dire que ça te déplaît.
Calith reste silencieux, son regard enfiévré est bien assez éloquent. D'un geste doux, Iezahel commence à défaire la corde autour de ses poignets mais Calith l'interrompt :
- Laisse-la s'il te plait.
- Tu crois que tu es en position de me dire ce que je dois faire ?
Les yeux de Iezahel reflètent un désir dévorant et de l'amusement. Alors le roi lâche dans un soupir un « non » résigné. Il aime être à la merci de Iezahel, et ces liens qui se défont petit à petit rendaient palpable sa docilité. Mais en même temps, le fait que Iezahel n'accède pas à sa requête montre que c'est lui qui mène la danse cette fois...
Ses poignets libres reposent sur les peaux de bête, et lui demeure immobile, complaisant, le désir palpitant dans sa chair. Il ne parvient pas tout à fait à se détendre, malgré les apparences, et demande d'une petite voix :
- Ils ne vont pas s'inquiéter, au château ?
- Non, Alima et Loundor sont prévenus.
Iezahel lui répond d'une voix absente, occupé à lui soulever le bassin et à glisser la corde au niveau de ses reins. Totalement malléable, Calith se laisse faire sans rechigner et remarque :
- Tu as eu besoin de temps pour préparer tout ça. Tu n'es pas allé voir Fáelán ?
- Non, je voulais te préparer cette surprise.
Il enroule habilement les deux extrémités de la corde autour des poignets de Calith et les noue solidement. La corde coincée sous lui, le roi de Pieveth se retrouve les bras le long du corps, incapable de les bouger, incapable de toucher son amant. Iezahel explique :
- Tu pourrais te libérer en soulevant le bassin et en passant la corde derrière tes cuisse. Et je pourrais arrimer cette même corde aux parties les plus sensibles de ton anatomie pour être sûr que tu ne le fasses pas. Qu'en dis-tu ?
- Je ne me libèrerai pas.
Un petit quelque chose, dans sa voix, fait que Iezahel se redresse et scrute son regard un instant. Puis le plus sérieusement du monde, comme s'ils étaient assis côte à côte, habillés, tout près de la cheminée, il déclare :
- Écoute-moi bien, Calith. Je suis passé rapidement voir comment ça se passait et il va bien. Il restera la nuit avec Iris, et j'irai le voir demain matin. Fáelán est certes mon fils, mais il ne deviendra pas le centre de mon monde. Mes seules ambitions le concernant, c'est d'être sûr qu'il ait un toit sur la tête, qu'il mange à sa faim, et qu'il ne soit pas maltraité. J'ai entièrement confiance en Iris pour tous ces points et je passerai du temps avec lui quand nous serons dans la forêt. J'ai beaucoup d'affection pour lui, mais il ne te remplacera pas. Tout comme Mahaut ne m'a pas remplacé.
Calith hoche doucement la tête, fasciné par la perspicacité de son amant, et rassuré, infiniment rassuré. Iezahel se penche sur lui, le couvre de son corps, l'embrasse au coin de la bouche et demande :
- Tu as d'autres choses de cet acabit qui te tracassent et t'empêchent de profiter de l'instant présent ?
- Non, rien d'autre.
- Bien.
Iezahel se redresse tout en caressant son torse, l'observe un instant tout en l'effleurant, faisant renaître le désir amoindri par la conversation. Et d'une voix songeuse, il hasarde :
- Tu pourrais être un prisonnier de guerre et je serai un ennemi, séduit par ton charme et ton indécence. Je viendrais profiter de la nuit tombée et des gardiens qui dorment à l'entrée de la grotte pour abuser honteusement de ton corps... Ou alors, je pourrais être ton sauveur, qui vient te libérer de tes ravisseurs, mais qui cède à l'appel du désir... Ou alors, je pourrais...
- On s'en fiche. Passons aux choses sérieuses.
Plus tard, beaucoup plus tard, alors que l'aube approche, ils sont allongés l'un contre l'autre, leurs membres entremêlés. Iezahel a joué avec son désir, le menant sans répit jusqu'au point de non-retour puis lui refusant la jouissance. La frustration, la sensation d'être à sa merci, l'amour qui guidait chacun des gestes de Iezahel l'a rendu quasiment fou de plaisir. Puis l'extase l'a emporté, le laissant ivre de sensations, groggy et à peine conscient de ce qui l'entourait.
Et maintenant, repus l'un de l'autre, ils se murmurent leurs sensations et tout leur amour. Ils savent désormais qu'ils pourront se réfugier ici de temps à autre. Et que rien ne les empêchera d'être heureux ensemble.
Commentaires
1. Sumomoechan le 19-02-2014 à 15:03:28
Bonjour très chère,
Maintenant qu'Iduvief est terminé, peut on espérer une nouvelle histoire ?
J'ai hâte !!!
Sumomo
2. histoiresyaoi le 20-02-2014 à 10:23:28 (site)
Je n'ai, malheureusement, aucune histoire sous le coude prête à être publiée. Plusieurs sont commencées, sans qu'elles ne me donnent satisfaction, donc je préfère attendre d'avoir un récit bien entamé et correct avant de poster quoique ce soit. Désolée, j'espère que ça sera pour bientôt.
Iduvief, chapitre 33
Ils se lèvent tôt le lendemain, reposés et sereins. Hilda les attend avec un sourire radieux et une montagne de galettes. Comment lutter ? Une fois qu'ils sont rassasiés, tandis que Loundor et ses hommes font un brin de toilette, Calith, accompagné par Iezahel et son fils, s'approche du comptoir.
Xalaphas nettoie des chopes de bière, l'air concentré, quand Calith s'approche et annonce :
- Nous allons partir.
- Oh ! Déjà ? Vous êtes des hôtes si charmants !
Le doux sourire de l'aubergiste est tellement sincère que Calith est convaincu que cette déclaration n'est pas faite dans l'espoir d'augmenter son pourboire. Xalaphas se reprend et enchaîne rapidement :
- Enfin, bien sûr, vous êtes libres de partir quand vous voulez, je comprends bien que vous avez des obligations.
- Nous serions restés avec joie, votre auberge est très accueillante, mais nous sommes effectivement attendus. Par contre, l'esclave malade ne pourra pas repartir avec nous, sa santé est encore trop fragile pour le moment.
- Je comprends, bien sûr !
Mais sa tête penchée sur le côté, les rides inquiètes sur son front, ses lèvres pincées démentent ses paroles : il ne comprend pas vraiment où veut en venir Calith. Alors il écoute avec soulagement et beaucoup d'attention la suite des explications :
- Il restera ici avec le mage et l'autre homme qui a dormi dans la petite chambre. Et ce, jusqu'à ce qu'il soit apte à prendre la route. Il va de soi que je viens aussi vous payer pour les nuits qu'ils passeront ici.
- Mais... comment savez-vous combien de temps ils vont rester ?
Calith esquisse un sourire en voyant l'air perplexe du vieil homme. D'un ton affable, il réplique :
- Je n'en sais rien. Disons qu'ils resteront une semaine.
Xalaphas écarquille les yeux, surpris par la générosité de son client. Tout comme sa femme, il a deviné qu'il était le propriétaire de Iezahel, et donc, par conséquent, de son fils. Et il en a donc conclu qu'il était le maître de Severin, imaginant dans la foulée qu'il était un très riche noble qui voyageait avec des gens d'armes pour sa protection. Certes, il ne fréquente pas de nobles très riches, mais Xalaphas ne les imaginait pas capables d'offrir une semaine d'auberge à un esclave. Après la somme généreuse qu'il avait laissé à l'aller, il se doutait bien que Calith n'était pas radin, mais à ce point...
- Et s'il est suffisamment en forme pour partir plus tôt ?
- Ils partiront plus tôt.
- Et je leur confierais le trop-perçu ?
- Non, vous le gardez. Quoiqu'il advienne, vous le gardez. Si pour une raison ou une autre, ils sont obligés de rester plus longtemps, vous leur donnerez le montant qu'il reste à payer, et je vous enverrai quelqu'un pour régler la somme.
Xalaphas demeure figé, les yeux grands ouverts et son torchon toujours enfoncé dans une chope qui a séché depuis le temps. Dans son esprit tourbillonnent mille pensées qu'il ne parvient pas à canaliser. Calith se voit contraint d'insister, tout en douceur :
- Combien je vous dois, s'il vous plait ?
- Oh ! Je...
Il s'affole soudain, l'aubergiste, envoyant promener chope et torchon, bien conscient que faire attendre un client, surtout lorsqu'il se propose de faire preuve d'autant de générosité, c'est très mal venu. Le voyant proche de la panique, Calith lui propose de revenir dans une poignée de minutes, ce qu'il accepte avec empressement.
Ils se rendent donc auprès de Severin, qu'ils trouvent en compagnie de Nyv' et d'un Filraen d'humeur bavarde. Iezahel, son fils lové contre son torse, s'adosse au chambranle de la porte, tandis que Calith s'avance dans la pièce et demande :
- Comment te sens-tu aujourd'hui, Severin ?
- Un peu mieux, merci. Filraen continue à me donner des infusions et à me faire des cataplasmes. Et Hilda n'arrête pas de me faire manger.
- Elle n'est pas femme à laisser mourir de faim un esclave.
- Ni à écouter les recommandations d'un guérisseur, bougonne Filraen.
- Je ne pense pas que cette nourriture en abondance mette en péril la vie de Severin. Et il faut faire avec son tempérament, vous allez rester ici le temps que Severin se rétablisse complètement. Filraen, vous déciderez du moment où voyager ne sera plus dangereux pour lui, et vous déciderez également si vous pouvez aller dormir à l'étage. Ne vous préoccupez pas du temps que ça prendra, tout est réglé avec Xalaphas. Nyv', toi, tu te chargeras du voyage. Si quiconque t'interroge sur les raisons de la présence d'un esclave dans votre groupe, tu diras que tu m'en ramènes un, à ma demande. Ça devrait suffire. Vous vous présenterez à moi une fois arrivés à Pieveth, nous aurons beaucoup de choses à régler.
Ils opinent tous, conscients qu'il s'agit là d'ordres royaux qu'ils n'ont pas à discuter. Puis voyant que le silence devient pesant et les trois hommes mal à l'aise, Calith souhaite un bon rétablissement à Severin et quitte la pièce.
Xalaphas les attend derrière son comptoir, et sourit gentiment en les voyant arriver. Il tend un morceau de parchemin à Calith, où sont détaillées toutes les dépenses. Une fois que l'argent a changé de main, Calith ayant rajouté deux pièces d'argent au montant total, l'aubergiste s'éclaircit la voix et déclare :
- Je... je ne voudrais pas m'imposer, messire, si ça ne vous intéresse pas, dites-le moi mais je voulais vous remercier pour votre générosité. Grâce à l'argent de la dernière fois...
Il hésite un peu, tord le torchon qu'il a repris en main. Calith l'encourage à continuer d'un sourire et d'un regard interrogateur.
- Grâce à vous, j'ai pu faire réparer la cheminée, vous avez dû vous en rendre compte. J'aurais dû le faire bien avant, même si ça m'aurait coûté toutes les économies, mais … Enfin, le maçon qui a réparé la cheminée viendra aussi rajouter des murs, à l'étage. Il y aura deux petites chambres individuelles, et le reste sera commun. Mais il faut attendre la fonte de la neige, il ne peut pas avoir de pierres avec un temps pareil. L'enseigne est réparée et modifiée, aussi. Pour le portrait de mon fils, ça va prendre du temps, mais l'ébéniste a déjà commencé son travail. Je ne sais comment vous remercier. Peut-être accepteriez-vous de me donner votre nom, ainsi je pourrais demander à l'ébéniste de graver une petite plaque de remerciement ?
Calith le dévisage, surpris. Il n'est pas rare que les monastères fassent graver des plaques pour remercier leurs plus généreux donateurs, mais il n'avait jamais eu vent de telles pratiques pour une auberge. Il est très tenté de lui dévoiler son identité, mais il devine sans peine que l'ébéniste refusera tout net de graver quoique ce soit au nom de son souverain. C'est tellement improbable qu'il ne le croira jamais et s'opposera catégoriquement à la création d'une plaque mensongère. Pourtant, il devine dans le regard plein d'espoir de Xalaphas que c'est un moyen pour lui de le remercier. Et il pressent que le bonhomme n'aime pas être redevable. Mais peut-il dire qui il est, après toutes les précautions qu'ils ont pris pour qu'il voyage incognito ? Indécis, il se tourne vers Iezahel, qui murmure :
- Suis ton cœur.
Calith hoche doucement la tête avec un léger sourire. Et il déclare :
- C'est plutôt à moi de vous remercier, Xalaphas. Je vous ferai parvenir une plaque, confirmant ainsi mon identité. Si vous souhaitez ensuite en rajouter une autre, vous êtes libre de le faire.
- C'est-à-dire que je ne pensais pas à ça, mon bon sire, je... C'est très embarrassant, c'est moi qui devais vous remercier, pas l'inverse... Je... j'ignore si je peux accepter un tel présent.
- Vous pouvez. De toute façon, je vous l'enverrai : si ça vous gêne, mettez-la au-dessus de votre lit ou dans la cave. N'en parlons plus, nous devons prendre la route si nous voulons arriver avant la nuit.
- Oh, bien sûr, évidemment. Je... excusez-moi de vous avoir retardé.
Calith le rassure d'un signe de la tête, l'attention vite détournée : Loundor, Asaukin et les jumeaux sont de retour après avoir fait leur toilette et salué ceux qui restent. Voyant que tout le monde est prêt, Calith donne le signal du départ et c'est accompagnés par Xalaphas qu'ils se rendent dans les écuries. Ils traversent la cour intérieure, jonchée de caisses vides et de tonneaux recouverts d'un blanc manteau. Le ciel est livide, annonciateur de neige. Ils se pressent pour se mettre à l'abri du froid mordant. Mais Calith n'a pas le temps de faire trois pas dans les écuries qu'il se retrouve plaqué contre le mur, Iezahel et Loundor faisant rempart de leurs corps en poussant des grognements inhumains. Asaukin et les jumeaux, voyant la réaction des loups-garous, tirent leur épée au clair et les pointent en direction d'un homme, plutôt jeune, au visage affreusement défiguré. Iezahel et Loundor ont sorti leur arme, eux aussi, et Fáelán, le visage rouge et congestionné, pleure sans un bruit. Calith l'observe un court instant avant de reporter son attention sur l'homme, devinant qu'il est le responsable de cette situation. Il reste immobile et muet : ce n'est pas le moment de demander ce qu'il se passe. La main de son compagnon repose sur son ventre pour le tenir à l'écart. L'atmosphère est pesante, étouffante presque et fait hennir les chevaux qui s'agitent. Sur le seuil, Xalaphas est pétrifié et glapit :
- C'est rien, c'est juste Bargn, il...
Mais il s'interrompt bien vite. L'homme tombe à genoux, les mains levées au-dessus de la tête, et déclare d'une voix pressante :
- Ne me tuez pas, par pitié ! Je... je vous en supplie, laissez-moi vous expliquer !
Calith le dévisage, se demandant pour quelles raisons les deux loups-garous lui en veulent, sans pour autant douter d'eux. L'homme est sobrement habillé de vêtements pourtant bien taillés et de belle facture. Sur la moitié droite de son visage, quatre profonds sillons marquent la chair et déforment ses traits. Sur le haut de son crâne, la cicatrice trace une raie au milieu de ses cheveux bruns. Son œil a été épargné par miracle mais la chair autour semble étirée vers la tempe. Sa joue est comme labourée par la balafre et la dernière marque semble lui faire un long sourire bien peu naturel. De son oreille, il ne reste plus grand chose, comme si la fourche, arme probable qu'on a utilisé contre lui, en avait arraché le lobe et la partie supérieure. Et Calith ne peut s'empêcher de s'interroger sur les raisons de telles cicatrices. L'homme poursuit, les mains tremblantes :
- Je suis inoffensif, je vous le jure. Je vous en conjure, ne me faites pas de mal. J'ai... C'est vrai que j'ai tué autrefois, je me suis repu d'hommes et de femmes. Mais j'ai payé mes fautes, j'ai expié mes péchés.
Loundor semble se détendre, rapidement imité par Iezahel. Les soldats baissent leurs armes, mais les gardent au clair. Dans un grondement sourd, Loundor le somme de poursuivre ses explications, et Bragn s'exécute avec empressement :
- Les villageois m'ont capturé, m'ont enfermé. Ils m'ont fait subir bien des douleurs et je savais que ce n'était que justice ! Je... Ma mort seule ne suffirait pas à rembourser mes crimes. Mais j'avais tellement mal... J'ai fui. Je... je me repens ! Je... je ne me nourris plus d'humains, je vous en fais le serment. Je veux juste reprendre une vie irréprochable, loin de ces villageois. Je vous en prie...
- Xalaphas est-il au courant de ta véritable nature ?
- Oui ! Il m'a recueilli, avec sa femme. Ils ont été très gentils avec moi. Quand... quand l'opportunité de travailler pour lui s'est faite plus précise, j'ai tenu à lui dire que je suis un Eachuisge. J'étais prêt à prendre la fuite, tout plutôt que revivre le calvaire de l'autre village. Mais je commence une nouvelle vie, vierge de tout vice, et je ne pouvais pas la bâtir sur des mensonges. Xalaphas m'a posé beaucoup de questions, puis il en a parlé avec Hilda. Il a pris ses précautions, bien sûr, mais il a accepté de me garder comme employé.
Voyant que la situation est plus détendue, Xalaphas s'avance et de sa voix frêle déclare :
- Grâce à votre générosité, j'ai pu embaucher un garçon d'écurie, même s'il n'était pas évident d'admettre que quelqu'un allait remplacer mon fils. Mais Bragn a été torturé, il était aux abois, et nous estimons, avec ma douce, qu'il n'y a pas meilleur moyen de rendre hommage à notre fils qu'en prenant sous notre aile quelqu'un qui a souffert.
Calith esquisse un sourire rassurant, définitivement convaincu que cet homme gringalet est quelqu'un de bien. Loundor et Iezahel échangent un long regard entendu, essayant sans doute de déterminer la sincérité de l'Eachuisge. Puis le Général ordonne :
- Très bien, dans ce cas, je te fais toutes mes excuses, j'ai réagi instinctivement. Fais donc ton travail et prépare nos chevaux, Bragn. Asaukin, les jumeaux, aidez-le.
Calith reporte son attention sur Fáelán, qui semble sur le point de s'étouffer. D'un geste habile, Iezahel dénoue la bande de tissu et le prend dans ses bras en lui murmurant des paroles apaisantes. Le roi caresse doucement le crâne de l'enfant en demandant :
- Il a eu si peur que ça ?
- Pas exactement. Il a voulu se transformer pour attaquer Bragn. Et vu la situation, j'ai ordonné un peu trop sèchement à son loup de rester tranquille.
Calith réprime un sourire, imaginant sans peine le louveteau se jeter sur un Eachuisge. Mais son sourire disparaît bien vite. C'est un problème insoluble. Le décret qu'il a fait passer concerne la totalité des créatures surnaturelles. Mais si le peuple est prêt à faire bon accueil aux margotines, les fées champêtres, aux farfadets ou autres, sans qu'un décret ne soit nécessaire, ce n'est pas le cas pour les créatures les plus dangereuses. Décret ou pas, les villageois ont tôt fait de les abattre. Mais ce sont pourtant des créatures des dieux, qui savent se contrôler la plupart du temps et ne se nourrissent que rarement d'humains. Calith ne peut accepter qu'une race entière soit anéantie à cause d'une poignée d'individus qui sèment la terreur. Les Eachuisge peuvent prendre apparence humaine ou chevaline. Ils vivent dans les lacs, les étangs, régulant la population aquatique. Tout le monde sait qu'il faut se méfier des apparitions autour de ces lieux, que ce soit d'un bel homme ou d'une jolie femme, ou encore d'un magnifique destrier. Car les Eachuisge aiment la chair humaine, ils en raffolent, et si une proie vient les narguer, ils ne résisteront pas à l'entraîner dans l'onde pour l'y noyer et se repaître. Pour célébrer les Dieux, et pour flatter la créature qui vit près de chez eux, de nombreux villageois lui font des offrandes, des animaux ou des criminels condamnés à la peine de mort. Et ils arrivent à faire bon voisinage. Souvent. Mais comment blâmer un village qui pleure encore la perte de proches et qui s'en prend au fauteur de troubles ?
Malgré le décret qui stipule bien que tout acte criminel doit être jugé par des personnes compétentes en la matière, et par nul autre, certains oublient que les créatures surnaturelles sont également concernées. Mais les décrets ne changent pas les mentalités, et n'émoussent pas la méfiance. Et il se rend compte, là, soudain, que c'est folie d'imposer aux gens d'accepter ces créatures. Spontanément, en sentant la véritable nature de Bragn, Loundor et Iezahel ont protégé Calith. Et il doit bien avouer, en son for intérieur, qu'il a vraiment pensé qu'il allait être attaqué. Certes, les Eachuisges sont bien plus dangereux au bord de l'eau qu'au milieu des terres, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont des tueurs. Calith n'en côtoie jamais, alors c'est facile de dicter la conduite à ceux qui les côtoient, mais dans les faits...
Une petite main qui lui tire la manche le sort de ses pensées. Fáelán, le visage encore maculé de larmes, réclame un câlin, qu'il s'empresse de lui donner en le serrant contre lui. Iezahel semble désespéré et il devine qu'il n'a pas réussi à apaiser son fils. Face à son désarroi, Calith lui demande :
- Ça ne va pas mieux, n'est-ce pas ?
- Non. Je crois que je l'ai traumatisé. Il a peur de moi maintenant. Je … et s'il ne...
- Tu as essayé avec ton loup ?
Calith sourit, rassurant, bien qu'il n'ait pas la moindre idée de la faisabilité de sa suggestion. Mais il se rend bien compte du trouble de son compagnon, et il ne supporte pas l'idée de le voir ainsi. Et Iezahel esquisse un sourire penaud, avant de se concentrer sur son fils. Les liens de meute existent et sont puissants, alors ceux entre père et fils doivent l'être encore plus, non ? Fáelán est toujours serré contre lui, à s'agripper à sa chemise de voyage, mais son attention est rivée sur Iezahel. Et après quelques instants, il semble enfin se détendre et offre même un sourire à son père.
Loundor est en conciliabule avec Xalaphas, et d'après les bribes de conversation qu'il peut saisir, il lui donne des conseils de prudence tout en le félicitant pour son altruisme. C'est délicat, bien sûr. Bragn semble inoffensif, déterminé à rester sur le droit chemin, et de par sa nature, il a le contact très facile avec les chevaux. Mais dans une auberge, avec tant de passage, c'est un risque perpétuel...
Les montures sont prêtes, mettant fin à l'incident. Xalaphas les remercie à nouveau longuement, leur promettant la plus grande vigilance. Loundor, déjà en selle, félicite Bragn pour ses résolutions et espère, dans un grondement qui s'apparente presque à une menace, qu'il saura s'y tenir.
Calith monte à son tour en selle, ayant vérifié que Iezahel avait pu installer son fils contre lui. Il n'y a guère de monde, dans les ruelles du village, pour assister au passage de cet étrange cortège, et c'est donc sans encombre qu'ils le laissent derrière eux.
La journée passe lentement, rythmée par les rires des jumeaux, les bourrasques de neige et les haltes pour ménager homme et chevaux. Ils n'hésitent pas un seul instant lorsque le monastère de Pòrr se dresse devant eux. Ils convergent tous vers le lourd portail pour demander l'hospitalité. Et l'acolyte leur accorde bien volontiers. Accompagnés par le même homme qui les avait accueilli la dernière fois, ils se rendent dans les écuries, où ils soignent longuement leurs montures. Mais alors qu'ils sont sur le point de rejoindre les salles communes, Iezahel, d'une toute petite voix, laisse échapper :
- Fáelán aurait besoin de changer et de se dégourdir les pattes.
Calith comprend tout ce qu'il ne dit pas. Son compagnon n'ose pas imposer aux acolytes la présence d'un louveteau, et il n'ose pas non plus retarder le moment de repos uniquement pour son fils. Alors il se tourne vers l'acolyte et déclare :
- Nous avons un jeune loup-garou avec nous : verriez-vous un inconvénient à ce qu'il se transforme et profite du cloître pour se défouler ? Il n'est pas dangereux.
- Notre Dieu prend régulièrement la forme d'un loup : nous serions bien impertinents de refuser qu'un loup profite de notre monastère pour se défouler. Et lorsque nous offrons l'hospitalité, nous acceptons les hôtes tels qu'ils sont, tant qu'ils ne nous mettent pas en danger.
Si les paroles semblent un peu froides, la voix, le sourire et le regard de l'homme sont si chaleureux qu'il ne subsiste aucun doute. Alors Iezahel libère Fáelán de son cocon de tissu, le déshabille rapidement, et en l'espace d'une poignée de minutes, un louveteau s'ébroue à leurs pieds.
L'acolyte, après un regard attendri en direction de Fáelán, retourne à sa surveillance. Loundor et ses hommes se rendent dans les salles communes pour saluer l'acolyte en chef et poser leurs affaires. Calith et Iezahel vont s'installer sur un petit banc de pierre, dans la zone abritée du cloître et observent le louveteau découvrir les lieux.
Le crépuscule recouvre lentement les arches en pierre, gravées en l'honneur de Pòrr, de lueurs rendues oranges par le ciel livide. Le froid forme des nuages de condensation à chaque respiration des deux amants, mais ils sont bien, là, dans le silence du cloître, à surveiller la progression du louveteau. Et ils ne sont pas les seuls à le surveiller : dans l'entrée du réfectoire, qui donne sur la petite cour, se découpe une multitude de silhouettes. Un novice, plus téméraire que les autres, s'avance lentement en direction de Fáelán, qui se fige en suivant chacun de ses gestes. Le louveteau jette un regard à son père, en quête d'approbation, et voyant qu'il n'y a pas de danger, s'approche du novice.
Le courage du premier a donné des ailes aux autres et ils sont bientôt cinq autour de Fáelán. Mais le temps de la découverte mutuelle ne dure pas et ils se retrouvent tous les six à jouer et à courir.
Calith se rapproche de Iezahel, de manière à ce que leurs cuisses se touchent, et il lui prend la main, qu'il serre doucement sous les capes. Un mouvement détourne brusquement son attention du jeu et la porte sur une zone d'ombre, là-bas, au fond du cloître. L'eubage, toujours vêtu de sa tunique blanche immaculée, contemple les novices et le louveteau. Puis, sentant un regard sur lui, tourne la tête vers le roi, et lui adresse un magnifique sourire. Il n'a pas besoin de paroles pour que Calith comprenne qu'ils sont les bienvenus, et que l'agitation dans le cloître l'est tout autant. Et il sent confusément que la bénédiction des Dieux s'étend désormais au petit bonhomme qui court à perdre haleine pour mordiller les chevilles des novices. Puis l'eubage se recule dans l'ombre et disparaît. Calith jette un regard à son compagnon : lui aussi a surpris l'eubage. Et à en croire son visage serein, lui aussi a ressenti cette bénédiction.
Finalement, c'est Fáelán qui crie grâce et titube jusqu'aux jambes de son père, signant ainsi la fin des festivités. L'acolyte en chef, accompagné de Loundor, a observé toute la scène sans intervenir, marque de son approbation. Ils se retrouvent tous autour des longues tables qui meublent le réfectoire pour un dîner simple mais copieux, auquel ils font honneur. Ils discutent ensuite un long moment, l'acolyte en chef leur expliquant notamment comment ils ont réussi à offrir une mort paisible aux draugnar qui peuplaient la ferme. Ils abordent également la situation des paysans des alentours, la vie des villages et les difficultés qu'ils rencontrent.
Enfin, alors que tous tombent de fatigue, la conversation s'éteint et ils vont dormir dans les petits lit de l'infirmerie où un berceau a été installé pour Fáelán, qui s'est attiré l'affection de tout le monastère.
Ils se lèvent aux aurores, le lendemain, après une nuit reposante, bien que les lits soient à peine confortables. Le petit-déjeuner est rapidement expédié. Laissant les acolytes enchaîner les entraînements matinaux, ils reprennent la route, non sans les avoir longuement remerciés.
Le temps est exécrable, et ils peinent à avancer dans les tourbillons de vents chargés d'une neige lourde et collante.
C'est donc épuisés et frigorifiés qu'ils atteignent la bourgade qui les accueillera pour la nuit. Ils passent tout droit devant l'auberge qui les avait contraint à se séparer de Iezahel à l'aller, et nul n'ose émettre la moindre protestation. Plus loin, un autre établissement offre le gîte et le couvert sans séparer les esclaves, et leur choix s'arrête dessus. Ils y passent une nuit correcte, la nourriture servie y est acceptable et l'aubergiste juste assez poli pour ne pas déclencher la colère des voyageurs. Ils sont tous pressés de reprendre la route le lendemain, car ils atteindront Pieveth dans la soirée, aussi ne traînent-ils pas plus que nécessaire après le petit-déjeuner. Ils réduisent également la durée des haltes, pressent un peu leurs montures, ce qui leur permet d'arriver au château juste avant le crépuscule, malgré le vent qui souffle sans répit.
Nul n'était prévenu de leur arrivée, mais lorsqu'ils s'avancent vers les écuries, le cœur gonflé de joie à l'idée d'être de retour chez eux, le responsable lance ses ordres et la petite cour devient une véritable fourmilière. Ils laissent leurs chevaux aux bons soins des garçons d'écuries, et restent un moment, après avoir pris leurs affaires, à l'abri sous l'auvent. Là, Calith remercie Asaukin et les jumeaux pour leur service, qui en retour lui assurent que c'était un honneur.
Puis avec un certain empressement, ils regagnent les logements des soldats, sans doute pour y retrouver leurs compagnons. Calith se tourne vers Loundor, persuadé que ce dernier les accompagnera jusqu'aux appartements royaux. Mais le Général fourrage dans son épaisse crinière couleur charbon et bougonne :
- Iris doit m'attendre.
- Va la rejoindre, bien sûr. On se voit demain.
Loundor acquiesce, presque gêné, et décampe sans demander son reste, sous le regard attendri de Calith. Il comprend bien qu'après plus de deux semaines de séparation, Loundor ait envie de rejoindre sa femme. Il ne le crie pas sur tous les toits, il fait même preuve d'une pudeur désarmante, mais Loundor aime intensément Iris. Alors c'est bien normal de le laisser aller la retrouver.
Restés seuls, Iezahel, Fáelán et Calith décident de regagner leur appartement, savourant par avance le plaisir d'un bain chaud. Ils traversent les couloirs sobrement décorés et éclairés par des torches vacillantes. Il n'y fait guère plus chaud à Iduvief, mais après une journée passée dehors, ils ont l'impression d'être dans une fournaise. Et puis, surtout, toutes les personnes qu'ils croisent leur sourient et les saluent poliment. Alima les attend dans le salon richement meublé, et les salue chaleureusement. Derrière elle, des esclaves s'affairent déjà à préparer le bain chaud. Elle n'a guère changé physiquement, depuis la première fois que Calith l'a vue, mais elle a pris de l'assurance et se révèle efficace et discrète. Le roi devine qu'elle doit être très directive, mais la douceur de ses gestes et de sa voix doivent largement contribuer à adoucir ses ordres.
Elle ne quitte pas des yeux Fáelán, un sourire sur les lèvres, sans oser demander quoique ce soit. Lorsque Calith lui demande d'installer un petit lit pour lui, dans leur chambre, en toute discrétion, elle lui assure que ce sera fait. Puis elle aide Calith à retirer sa cape pleine de neige, qu'elle va étendre près du feu crépitant. Iezahel, de son côté, enlève sa cape puis libère Fáelán, qui reste prudemment accroché au pantalon de son père.
Alima leur propose du vin chaud, pour patienter le temps que le bain soit prêt. Elle ne fait aucune remarque, bien sûr, mais après les avoir servi, elle se rend dans la salle de bain, pour presser les esclaves et leur demander de rajouter de la saponaire. Calith et Iezahel sentent fort le cheval et la sueur, et ils ont vraiment hâte de pouvoir se laver.
Mais Elihus, les doigts maculés d'encre et les cheveux en bataille, se faufile dans le salon et déclare :
- Bonjour Calith, bonjour Iezahel. Et bonjour … ?
Il a marqué un infime temps d'arrêt en voyant le petit sur les genoux de Iezahel. Calith, après un bref regard à Iezahel, répond :
- Fáelán. Il s'appelle Fáelán. C'est un esclave, que j'ai acheté là-bas. Et surtout, c'est le fils de Iezahel.
- Oh. Toutes mes félicitations, Iezahel.
Il lui adresse un sourire chaleureux avant de s'installer à la table avec eux. Durant leur absence, il n'a pas chômé et ses yeux sont cernés de noir. Pourtant, il poursuit d'une voix tranquille :
- Je voulais juste prendre des nouvelles. On m'a averti que vous étiez rentrés, donc je suis venu. Mais je me doute bien que vous êtes épuisés.
- Nous le sommes, oui. Ce ne fut pas de tout repos. Mais nous en parlerons plus tard, si tu le permets.
- Oui, oui, bien sûr. Tout le monde va bien ? Loundor n'est pas avec vous ?
- Il est allé directement voir Iris. Et tout le monde va bien, oui, nous n'avons pas eu de grave problème.
- Mais des problèmes quand même, n'est-ce pas ?
- Quelques uns oui. Rien de bien méchant. Et ici, tout s'est bien passé ?
- Rien de grave à signaler. Mais je suis content de te revoir, Calith.
Ils échangent un sourire puis, brusquement, le conseiller se lève et déclare :
- Je vais vous laisser. On se retrouve demain matin, dans ton bureau Calith ?
- Oui. Mais pas trop tôt.
- Quand tu voudras.
Et il quitte les appartements à petits pressés, sans doute pour retourner à sa paperasse. Calith pousse un long soupir : dire que pendant plus de quinze jours, il n'a eu aucun parchemin à signer ! Mais à n'en pas douter, Elihus va vite lui redonner le rythme. Et ça l'épuise déjà.
Les esclaves ont terminé, et se retirent pour qu'ils puissent prendre leur bain. Prévoyante, Alima a même demandé à ce qu'un petit baquet soit installé et rempli, juste à côté de la baignoire. Et Fáelán l'adopte immédiatement.
Ils passent près d'une heure à se laver mutuellement, puis à se caresser sous couvert de l'eau rendue trouble par la saponaire. Deux esclaves arrivent alors, porteurs d'un lourd plateau chargé de gobelets, d'assiettes et de victuailles : tourte à la viande, potage épais, miche de pain et demie-tomme de chèvre. Les estomacs se mettent à gargouiller, alors ils sortent rapidement de la baignoire, lavent Fáelán et s'habillent chaudement pour aller s'installer dans le salon. Fáelán retrouve sa place habituelle sur les genoux de son père, et à eux trois, ils dévorent le contenu du plateau.
Entre la chaleur dégagée par la cheminée, le plaisir d'être rassasié et le silence qui règne, ils sont sur le point de s'endormir à table. Mais Calith se lève et déclare :
- Je vais saluer Zélina et Mahaut, tu veux venir ?
- Oh... j'allais coucher Fáelán et ranger un peu nos affaires, ma présence n'est peut-être pas indispensable, si ?
Calith esquisse un sourire qui se transforme en rictus : il comprend bien la réticence de son compagnon. Alors, sans faire d'histoires, il lui assure que non, sa présence n'est pas indispensable, qu'il sera parfaitement en sécurité avec Zélina, et qu'il vaut mieux qu'il couche le petit qui dort debout. Laissant Iezahel à ses occupations, il parcourt, l'esprit en ébullition, le passage secret jusqu'aux appartements de Zélina. Iezahel lui aurait-il fait la même réponse, s'il ne s'était pas découvert un fils ? Un fils qui prend beaucoup de place dans son cœur, et qui l'occupe aussi énormément. Calith serre les poings, jusqu'à ce que ses ongles plantés dans ses paumes le fassent réagir : serait-il jaloux de Fáelán ?
Finalement, il débouche dans le petit salon de Zélina, après avoir frappé, et ses sombres pensées s'envolent. Oubliant ses soucis, il va saluer son épouse, ainsi que son amant, qui l'accueillent chaleureusement. Ils discutent un bon quart d'heure, se donnant mutuellement des nouvelles, puis Calith va contempler sa fille endormie. Il commence à se faire tard, et la fatigue lui pèse de plus en plus, alors il prend congé, promettant de revenir le lendemain, et regagne ses propres appartements.
Seules les flammes dans l'âtre luttent contre l'obscurité qui s'est répandue dans le salon. Dans leur chambre, un grand berceau a été installé : il n'a ni le luxe ostentatoire des berceaux pour enfants nobles, ni la misérable simplicité des berceaux pour les esclaves. Il mesure près d'un mètre de long, de bois sobrement sculpté, et il est garni d'un lainage épais, typiquement le genre de mobilier qu'on trouve chez un bourgeois. Calith se promet de remercier Alima pour son tact et sa subtilité, elle qui a su comprendre sans qu'on lui explique que cet enfant est un cas à part.
Iezahel vient juste de terminer de ranger leurs affaires, à en croire ses yeux encore parfaitement alertes et le froid qui glace les draps dans le lit, lorsque Calith le rejoint. Ils soufflent les chandelles dans un mouvement simultané et se blottissent l'un contre l'autre, savourant le plaisir d'être enfin de retour à Pieveth.
Iduvief, chapitre 32
Filraen, d'une toute petite voix, ose demander :
- Que faisons-nous, à présent ?
Cette question reporte l'attention sur Severin, plus mal en point que jamais. Ils ne peuvent pas rester au beau milieu du village. Faire voyager l'esclave était une erreur, Calith en est bien conscient. Même si l'écurie était peu chauffée, poussiéreuse et peu adaptée pour soigner quelqu'un, c'était toujours mieux que de le faire errer sur les routes par un froid pareil. Même si Lucias ne pouvait pas le garder indéfiniment, ils auraient trouvé un arrangement. Mais le mal est fait, et désormais, il faut trouver une solution. Loundor a retrouvé son calme et ordonne d'une voix posée :
- Asaukin, les jumeaux, remontez en selle. Iezahel, change-toi, tu nous guideras. Je te suivrai, mon cheval à l'habitude des loups. Vous devrez tous faire attention à ne pas vous laisser distancer. Nous allons à L'Hydre qui fume : nous passerons la nuit sur la route. Dans le noir, c'est vite arrivé de perdre les autres, donc soyez attentifs à ce qui vous entoure.
Personne ne conteste les ordres de Loundor. Ils savent tous que la nuit sera éprouvante mais ils sont bien conscients qu'ils n'ont pas beaucoup d'alternatives. Après le scandale devant l'auberge, personne n'acceptera de les loger. Et puis, ils sont neuf, dix en comptant Fáelán...
Iezahel s'approche de Calith, un léger sourire sur les lèvres, malgré la ride de contrariété sur son front. Il retire sa cape, et défait la longue bande de tissu qui retenait Fáelán. Avec beaucoup d'habileté, il la noue autour du torse de son roi, lui confiant ainsi son fils. Fáelán observe ses faits et gestes avec beaucoup d'attention et semble s'apaiser lorsque Calith lui caresse le dos. Iezahel va prêter sa cape à Nyv', puisqu'il n'en aura pas besoin, et il aide Filraen pour envelopper Severin dans une épaisseur supplémentaire. Puis il revient vers Calith, qui lui enlève son collier de métal et le glisse dans sa besace. Calith, qui s'apprête à se reculer pour laisser son amant se déshabiller et se changer, se retrouve tout surpris quand Iezahel l'embrasse à pleine bouche devant tout le monde. Mais il répond bien vite à son baiser. Cette brève étreinte calme l'angoisse dont il n'avait pas conscience mais qui lui nouait la gorge. Il n'a pas besoin que Iezahel lui dise le fond de sa pensée : alors qu'il s'écarte pour reprendre son souffle, il lâche dans un murmure :
- Je prendrai soin de lui.
Iezahel lui offre un sourire et s'écarte. Il commence à se déshabiller pendant que Calith monte précautionneusement en selle. Guidés par Loundor, les cavaliers forment un cercle autour de Iezahel, qui se tient, parfaitement nu, debout dans la neige. Ses affaires sont rangées dans la besace accrochée à la selle de son cheval. Puis, cachés des éventuels curieux qui regarderaient encore, il se transforme à l'abri du cercle. Et c'est un magnifique loup gris qui émerge du rassemblement et s'ébroue en silence. Puis, après avoir jeté un regard à Loundor, se met à trottiner dans la neige.
Les dernières lueurs du jour disparaissent progressivement, les plongeant dans une immensité noire. Les torches seraient inutiles, n'éclairant guère plus loin que leur monture, et faisant d'eux des cibles de choix. Mais Calith déteste se sentir à ce point vulnérable. Privés de lumière, ils avancent lentement en file indienne, Asaukin tenant la bride du cheval de Iezahel. Les conversations sont rares, ils sont à l'affût du moindre craquement, du moindre gémissement de la nuit. Le ciel étoilé semble faire tomber sur eux un froid pénétrant, que les capes n'arrivent pas à contrer et donne vie à d'innombrables ombres maléfiques le long de la route.
Ils ont cumulé les erreurs. Ils n'auraient jamais dû emmener Severin avec eux. Et Loundor n'aurait pas dû faire usage de violence à l'encontre de l'aubergiste. Mais alors quoi ? Se laisser parler de la sorte, accepter d'être méprisé ainsi ? Même en tant que roi, Calith ne se permet pas de traiter ses sujets avec autant d'affront.
Calith en viendrait presque à estimer que ce voyage à Iduvief, tout entier, était une erreur. Ils n'ont pas pu aider Artéus. Ils n'ont pas pu empêcher des meurtres. Et ils ont découvert une réalité qu'il aurait préféré ignorer. Mais i ce petit corps blotti contre lui, douce chaleur endormie, qui l'en dissuade. Ils ramènent avec eux un esclave qui n'a que trop souffert, un mage talentueux qui était sous-estimé, et un louveteau qui a besoin de beaucoup d'amour. Alors l'inconfort est un moindre mal. Sauf si Severin ne survit pas à cette nuit.
Des petits doigts s'agrippent à sa chemise. Fáelán remue dans son sommeil, avant de s'apaiser. Comment pourront-ils s'occuper de lui malgré leurs rôles respectifs ? Et que se passera-t-il si Fáelán se révèle inadapté à l'armée ? Après tout, tous les hommes ne sont pas voués à finir avec une épée à la main. Bercé par le rythme lent du cheval, luttant contre le sommeil, il réfléchit. Il demandera à Elihus s'il n'y a pas, dans les archives, des cas où un roi a pris pour pupille un jeune esclave. Ça se fait pour les nobles : des orphelins, dont les parents sont morts dans des circonstances tragiques ou au service du royaume, se retrouvent sous l'aile protectrice du souverain. Mais des esclaves ? Il sait que s'il lui arrive quelque chose, Zélina pourra s'occuper de Mahaut, imposer ses volontés en tant que reine. Mais que pourrait faire Iezahel pour son fils ?
Une agitation inhabituelle le tire de ses sombres pensées. Loundor, de sa voix de basse, ordonne de bifurquer sur la droite, et de s'y arrêter. Iezahel leur a trouvé une clairière, légèrement épargnée par la neige. Ils mettent pied à terre, se dégourdissent les jambes en essayant vainement de se réchauffer. Les chevaux soufflent dans l'obscurité presque complète, tandis que Iezahel s'approche de Calith. Un craquement à peine audible, et la lumière surgit soudain, donnant d'inquiétantes allures aux arbres qui bordent la clairière. Loundor tient bien haut une torche pour s'assurer que tout le monde est présent. Puis il la plante dans la neige. Ils ont faim et ils ont soif. Les chevaux ont besoin de se reposer un peu. Mais un arrêt prolongé dans ce froid signerait leur arrêt de mort.
Filraen est allé chercher de la neige qu'il a tassé dans un gobelet. A l'aide d'incantations, il la fait fondre puis tiédir. Puis après avoir vérifié la température du bout du doigt, plonge des herbes séchées dedans.
Les gestes rendus malhabiles par le froid, ils fouillent dans leurs affaires respectives pour prendre quelques provisions. Et dans un silence sépulcral, ils dînent, debout dans la neige. Iezahel est resté sous sa forme lupine et attrape au vol les morceaux de viande séchée que lui lance Calith. Ils ne traînent pas plus que nécessaire : une fois le repas terminé et Severin soigné, ils remontent en selle
et reprenne la route.
Il n'y a plus d'autres haltes. Le reste du trajet se déroule dans un brouillard cotonneux. Dormant à moitié, veillant au petit bonhomme qui somnole contre lui, Calith se laisse bercer par sa monture et le silence glacial de la nuit. Une nuit qui lui semble interminable.
Les premiers rayons du soleil dévoilent un paysage enneigé, d'où s'élèvent ça et là des arbres imposants tout de blanc vêtus. La route principale se révèle à eux. Calith sourit : ils n'ont pas dévié. C'est si facile, en pleine nuit, de poursuivre tout droit, sans se rendre compte qu'on a quitté le chemin. Mais Iezahel, avec sa vision nocturne, les a parfaitement guidé et Loundor a su leur faire suivre la trace du loup.
Les cavaliers clignent des yeux, essayent de s'extraire de la torpeur dans laquelle ils sont plongés. Ils n'ont pas vraiment dormi, ils ont somnolé, se laissant parfois surprendre par le sommeil impérieux. Même les traits de Loundor sont marqués par la fatigue. Au loin se dressent des silhouettes rendues fantomatiques par la brume matinale. L'espoir revient.
A mesure qu'ils avancent, sentant sous leurs jambes les chevaux tituber de fatigue, les silhouettes deviennent des chaumières et le village prend forme. De maigres sourires reviennent sur les visages épuisés. Seul celui de Nyv' garde un masque figé. Entre ses bras, Severin est devenu poupée de chiffon. Quelques minutes encore qui leur paraissent bien longues avant qu'ils ne s'immobilisent devant l'auberge. Sur l'enseigne, le « e » a été grossièrement rayé et un « ait » le remplace désormais. L'Hydre qui fumait.
Loundor est le premier à pénétrer dans l'auberge, suivi par Asaukin. Calith descend péniblement de son cheval, le corps endolori, veillant à ne pas malmener Fáelán. Iezahel s'assoit près d'eux, le souffle court. Les jumeaux aident Nyv' a faire descendre Severin, inconscient, guidés par Filraen.
Laissant les chevaux sous la bonne garde de l'un des jumeaux, ils pénètrent dans l'auberge. Xalaphas s'agite, tourne et virant en répétant à l'envi « Oh mes bons sires, mais que s'est-il passé ? » Succinctement, Loundor lui explique le refus de l'autre aubergiste, la nuit sur la route. Le vieil homme hoche la tête, l'air sombre, et calmé, il prend la direction des évènements. Un jumeau et Nyv' portent, sous ses instructions, Severin jusqu'à une petite pièce, coincée entre la cuisine et la salle. Ils sont glacés et la chaleur de la pièce leur semble étouffante et leur brûle la peau.
La présence de Iezahel sous sa forme lupine rend Xalaphas très nerveux. Pourtant, il obtempère quand Calith lui demande l'accès à la cave. Il ne souffle pas un mot quand il le voit déposer des vêtements et enfermer le loup dans la cave, mais il les observe du coin de l'œil. Et il laisse échapper un cri étranglé en voyant un homme en sortir.
Dans la cuisine, la femme de Xalaphas fait chauffer ses fourneaux et lance la production des fameuses galettes qui avaient tant régalé Calith et ses hommes, il y a une éternité de cela. Dans un coin de l'âtre, elle met du potage à réchauffer, ainsi que de l'eau. Filraen fait allonger Severin sur le petit lit qui occupe quasiment tout l'espace, le fait enfouir sur une montagne de couvertures. Dans un gobelet d'eau, il verse des herbes, puis lance plusieurs incantations pour soulager la respiration sifflante de l'esclave.
La bande de tissu qui entourait le torse de Calith libère Fáelán, qui se précipite dans les jambes de son père. Iezahel accuse le coup, le prend dans ses bras, mais impossible de manquer l'épuisement qui marque ses traits.
Ils se retrouvent tous dans la salle principale, où un feu joyeux crépite dans l'âtre, sans enfumer toute la pièce. Peu à peu, leurs corps se réchauffent : leurs joues sont devenues toutes rouges et leurs doigts brûlent. Asaukin et les jumeaux vont s'occuper de rentrer les chevaux à l'abri, tandis que Xalaphas et sa femme garnissent la table de boissons chaudes et de galettes.
Ils sont épuisés, mais leur faim est impérieuse et ne les laissera pas se reposer tant qu'elle ne sera pas assouvie. Alors dès que les soldats reviennent de l'écurie, ils se jettent sur la nourriture et dévorent les galettes, sous le regard bienveillant de leur hôtesse. Quand il n'y en a plus, elle leur apporte une autre fournée avec un sourire ravi.
Iezahel tombe littéralement de fatigue, malgré Fáelán sur ses genoux qui lui mordille la chemise. Même pour un loup-garou, passer une nuit entière à mener un groupe de cavalier est éreintant. Xalaphas, bien conscient de la fatigue de ses clients, les conduit sans plus tarder à l'étage, où il leur propose les mêmes lits qu'à l'aller. Ils s'écroulent dessus, laissant Nyv' et Filraen veiller sur Severin.
Ils n'ont pas fait long feu, et il semble à Calith qu'il vient juste de s'endormir quand une sensation étrange le réveille. Il ouvre péniblement les yeux, et découvre Fáelán assis à côté de son visage, triturant ses cheveux. Le gamin a dormi toute la nuit, blotti contre son torse, il n'a plus sommeil. Calith pousse un soupir et s'apprête à se rendormir quand une petite voix chuchote :
- Et elle !
La surprise dissipe bien vite le brouillard de sommeil qui l'entourait. Se redressant à moitié, il suit du regard la direction qu'indique Fáelán : son amant, vaincu par la fatigue. Il secoue doucement la tête et marmonne, la bouche pâteuse :
- Mais non, ce n'est pas elle, c'est lui. Et il dort, car il est épuisé. J'aimerais bien en faire de même, si tu permets, petit bonhomme.
Mais Fáelán, parfaitement réveillé, n'a pas l'intention de se laisser envoyer paître et insiste :
- Et elle !
Bien malgré lui, Calith sourit. C'est la première fois qu'il entend le gamin parler, et il commençait à se demander si c'était bien normal, ce silence. Pourtant, ses paroles n'ont rien de cohérent et l'inquiètent un peu : est-il sain d'esprit ? Alors, presque réveillé, il explique doctement :
- Ce n'est pas elle, c'est lui. C'est un homme, avec … ahem, tout ce qu'il faut où il faut. Donc tu ne dois pas dire « et elle » mais « et lui ».
- Si.
Le minuscule index de Fáelán se pose sur son nez, et coupe net l'agacement qui commençait à monter. Il fond devant ce petit bonhomme si sûr de lui, au visage si sérieux. Mais il ne peut laisser passer une telle affirmation. Craignant que le gamin, ayant vu ou entendu les relations qu'il entretient avec son compagnon, ne fasse un raccourci aussi prompt que dérangeant, il insiste :
- Je te dis que c'est pas une femme, mais un homme, bon sang. Et il...
La maigre clarté des lieux lui permet de voir Loundor qui le regarde, lui aussi réveillé, un sourire narquois sur les lèvres. Retenant de justesse un juron, Calith laisse retomber la tête sur l'oreiller en dévisageant son Général. Fáelán, voyant son attention détournée, pivote et regarde Loundor, avant de répéter un peu plus fort :
- Et elle !
Calith est sur le point de prendre Loundor à témoin, de lui faire remarquer que confondre un homme et une femme c'est pas bien normal quand même, quand il l'entend déclarer :
- C'est presque ça, mon grand. Yé-za-el. Mais tu peux l'appeler « papa », c'est plus simple.
La gorge nouée, Calith entend Fáelán s'entraîner à la prononciation du mot jusqu'à ce que Loundor, satisfait, poursuive :
- Et lui, là, pas besoin de l'appeler Sire. Calith, ça ira très bien pour toi.
Mais la prononciation du prénom du roi, trop compliquée, s'avère laborieuse et il se retrouve surnommé « Cali ». L'esprit encore voilé par le sommeil, Calith comprend enfin que le « si » qu'il avait pris pour une provocation n'est en fait que la tentative de « Sire ». Alors il sourit, vaincu par la tendresse que lui inspire le gamin. Fáelán, ayant trouvé une oreille plus compatissante, se tourne alors vers Loundor et joue avec ses cheveux. Et dans un soupir, ce dernier déclare :
- Bon, il s'ennuie. Repose-toi, Calith, je vais l'occuper en bas.
- Merci.
Ce n'est pas simplement parce que Loundor se propose d'occuper le gamin que Calith le remercie, et il sait qu'il aura compris. Alors il sourit une dernière fois, se retourne, enfouit son visage contre le dos de Iezahel, et se rendort presque aussitôt.
Plus tard, c'est l'agitation contre lui qui le réveille. Iezahel s'est redressé dans le lit et cherche du regard quelque chose. Voyant que Calith a ouvert les yeux, il demande d'une voix pressante :
- Où est passé Fáelán ?
- Vendu. Au poids. Pour payer l'auberge.
Il a à peine terminé sa phrase que Calith réalise la stupidité de sa réponse. L'humour de grand matin ne lui réussit pas. Il pose une main impérieuse sur l'épaule de Iezahel, déjà prêt à bondir hors du lit, et s'empresser de rectifier :
- Je suis désolé Iezahel, je plaisantais. Il va bien, il est avec Loundor. Il ne dormait plus et s'ennuyait, alors il l'a emmené en bas. C'était stupide, désolé, mais il va bien.
Mais la terreur dans le regard de Iezahel, si elle s'est apaisée, n'a pas disparu. Et Calith comprend : il a confié le petit à un autre loup, avec lequel les relations sont parfois tendues. Iezahel ne répond rien mais s'extirpe du lit et commence à enfiler ses bottes. Dans un soupir, Calith l'imite et ordonne, voyant que son amant n'a pas l'intention de patienter :
- Attends-moi, Iezahel.
Il n'a pas besoin de préciser, le loup-garou a bien compris qu'il s'agit d'un ordre. Quand ils sont prêts tous les deux, ils descendent jusqu'à la salle principale, Iezahel en tête, Calith observant par-dessus son épaule. Loundor est installé sur une table, le petit sur ses genoux. Il manipule deux croûtons de pain sous les yeux émerveillés de son auditoire :
- Et le chevalier s'écria « Tu vas mourir, impudent, toi qui as osé t'en prendre à ma bien-aimée ! »
Loundor précipite les deux croûtons l'un contre l'autre et imite le choc de deux épées qui s'affrontent. Mais il s'interrompt bien vite en percevant une présence dans son dos. Fáelán se retourne et un sourire ravi éclot sur ses lèvres. Il s'échappe des bras de Loundor pour se laisser tomber à terre et trottine jusqu'à Iezahel en appelant :
- Papa ! Papa !
Le concerné reste figé l'espace d'un instant, avant de se baisser pour le prendre dans ses bras et le serrer contre lui. Calith, silencieux, s'approche et découvre les larmes qui dévalent les joues de son compagnon. Des relents de fatigue, la terreur inspirée par la plaisanterie stupide de Calith, l'émotion, enfin, d'entendre Fáelán l'appeler de la sorte, ont fait déborder le vase. Tout en douceur, Calith attire contre lui Iezahel, d'apparence stoïque mais bouleversé. Il l'étreint sans un mot, bercé par les « Papa » murmurés par Fáelán. Ce n'est que lorsque Iezahel cesse de trembler entre ses bras que Calith s'écarte et murmure :
- C'est ton fils, il sera toujours à toi. Désolé d'être aussi stupide parfois.
Son amant esquisse un sourire poignant qui lui noue la gorge. Tout en douceur, il caresse ses cheveux puis effleure sa joue. Et dans un murmure, lui raconte les évènements de la nuit, quand Fáelán essayait en vain de l'appeler, et que lui ne comprenait rien à rien. La porte de l'auberge s'ouvre soudain, empêchant toute moquerie de la part de Iezahel et les faisant se séparer : deux hommes entrent, sans doute des habitués. Ils vont s'asseoir directement à une table sans la moindre hésitation. Xalaphas arrive en trottinant, fait demi-tour avant d'avoir atteint ses clients, et va leur servir deux chopes de bière. Loundor, Calith et Iezahel décident qu'il est temps d'aller prendre des nouvelles de Severin et traversent la cuisine, où s'affaire l'imposante femme, avant de s'entasser dans la petite pièce. Filraen s'est assoupi sur une chaise inconfortable. Nyv' partage le lit du convalescent et dort à poings fermés. En réalité, seul Severin est éveillé et il observe les nouveaux venus avec un pâle sourire. Son regard semble lucide, sa respiration est moins sifflante. Son bras gauche entoure les épaules de l'éclaireur dans un geste protecteur. Dans un chuchotement rauque, il murmure :
- Filraen a fait des miracles encore. Et comme Nyv' dort avec...
Il s'interrompt immédiatement lorsqu'une silhouette massive se dresse sur le seuil de la porte. La femme, voyant tout ce monde présent, tend un bol de potage à Calith en déclarant d'un ton péremptoire :
- Puisqu'vous êtes ici, z'allez l'aider à manger. C'l'heure du déjeuner et les clients arrivent.
Et sans attendre de réponse, elle fait demi-tour, laissant Calith pétrifié. Iezahel pose son fils à terre et récupère le bol, puis s'approche du convalescent pour lui donner à manger. Le déjeuner. Ils n'ont dormi qu'une poignée d'heure, à peine. Calith comprend mieux la fatigue qu'il ressent toujours.
Lorsque Severin, handicapé par ses mains encore bandées, a terminé de manger et s'endort, ils quittent la pièce pour regagner la salle principale. Les jumeaux et Asaukin les attendent patiemment autour d'une chope et les saluent en les voyant arriver. Ils ont à peine le temps de s'asseoir que Xalaphas leur apporte une copieuse marmite de ragoût qui leur met l'eau à la bouche, puis sa femme pose une écuelle d'une bouillie non-identifiée devant Fáelán, assis sur les genoux de son père. Puis elle se redresse, toise Calith avec une terrible lueur de défi dans le regard, et assène :
- Et v'nez pas m'dire qu'c'est trop pour un esclave. J'sais qu'vous êtes son maître, mais j'dis qu'il faut qu'ce môme se remplume. Alors tant qu'vous s'rez là, il mang'ra une bouillie d'avoine au miel, foi d'Hilda !
Xalaphas, à ses côtés, pousse un couinement étouffé, tenté de demander à sa femme de ne pas parler aux clients de la sorte, mais bien trop intimidé pour le faire. Calith lève les mains en signe de reddition, impressionné par ce dragon et son sens de l'observation. Il ne lui serait cependant jamais venu à l'idée de lui interdire de nourrir le petit : il est bien conscient qu'il est trop maigre pour son âge. Il tente un sourire pour l'amadouer et répond :
- Bien au contraire, je vous remercie pour votre prévenance et votre sollicitude. Soyez assurée que j'apprécie grandement votre geste.
Elle reste stupéfaite et indécise, craignant qu'il ne se moque d'elle. Mais le voyant sincère, elle émet un grognement qui pourrait passer pour un « pas d'quoi » et tourne les talons. Xalaphas tente de rattraper le coup en se lançant dans une litanie d'excuses, d'une voix chevrotante, jusqu'à ce que Loundor intervienne :
- Ne vous inquiétez pas, mon brave. On connaît ce genre de personne : bourrue, qui crie fort parfois, mais qui a le cœur sur la main. Ne vous en faites pas, ça ne rend votre auberge que plus chaleureuse.
Calith, encore secoué par la tirade de Hilda, n'aurait pas été jusqu'à dire que c'est un accueil chaleureux, mais le soulagement de l'aubergiste est bien trop palpable pour qu'il nuance les propos de son Général. Et puis, voir Fáelán se régaler de cette bouillie, sous le regard tendre de son père, achève toute tentative de protestation : il n'y en a pas un qui prendra sa défense.
L'œil vigilant de la matrone fait de ce déjeuner un véritable festin : une fois la marmite vide, elle leur en ramène une seconde. Impossible de résister à la tendresse de la viande qui fond dans la bouche, aux mille saveurs qui explosent contre le palais, aux délicieuses pommes de terre gorgées de jus. Alors ils font honneur à la cuisine, sous le regard ravi de Hilda, qui n'oublie pas Fáelán et lui donne une autre écuelle tout aussi pleine. Le louveteau se repaît, dévore, fidèle à sa nature lycanthrope, avec l'approbation muette de Iezahel et de Loundor. Quand leur panse crie grâce et que la seconde marmite est vide, elle arrive avec une énorme miche de pain et un fromage tendre et délicieux. Ils le dévorent, bien sûr, savourant chaque bouchée. Et c'est à ce moment-là qu'elle revient avec un énorme pain d'épice. S'il y a bien un mot pour qualifier cette femme et sa cuisine, c'est généreux. Car le pain d'épice est merveilleusement tendre, moelleux et presque fondant tant il y a de miel. Même s'ils n'ont plus faim, comment résister ?
Ils sirotent de l'hypocras, rendus hébétés par tant de bonne chair, conscients qu'ils devraient aller faire un brin de toilette, car ils sentent fort le cheval mais incapables de se lever. Même lorsque Filraen arrive, l'air catastrophé, ils n'arrivent pas à se redresser. Mais ils écoutent avec la plus grande attention le mage leur explique à voix basse :
- Cette femme essaie de gaver Severin. Elle prétend que ça l'aidera à aller mieux mais je n'en suis pas convaincu. Il faut que vous lui disiez de cesser immédiatement !
Filraen ne s'adresse à personne en particulier. Pourtant, tous trouvent fascinant, soudain, le feu qui brûle dans l'âtre, la rainure, là, dans la table, ou encore Fáelán, repus, qui dort comme un bienheureux. Calith se sent obligé de répondre, ne pouvant laisser la requête du mage sans réponse :
- Filraen, vous êtes le guérisseur, celui chargé de rétablir Severin. Vous avez bien plus de légitimité à recadrer Hilda que nous.
Le mage lui jette un regard désespéré avant de comprendre que cette évidence est un refus, diplomate certes mais implacable. Il se dirige alors en traînant les pieds jusqu'à la petite salle, suivi du regard par Calith, légèrement pris de remords. Mais lorsque le mage revient, cinq minutes plus tard, le visage gris et les mains tremblantes, il ne regrette plus de ne pas avoir osé affronter le dragon : c'était une lutte perdue d'avance. Filraen s'installe à côté des jumeaux, penaud et ne réagit même pas lorsque Xalaphas apporte un énorme fauteuil confortable, suivi de près par Hilda et Nyv' qui soutiennent l'esclave. Calith retient un sourire en imaginant la discussion qui a eu lieu : Filraen s'opposant au déplacement de Severin, et Hilda campant sur ses positions.
Filraen ne retrouve bonne mine que lorsque Severin, soigneusement emmitouflé dans une épaisse couverture, se met en sourire en déclarant :
- Je suis bien mieux ici avec vous que claquemuré là-bas.
Il semble encore épuisé, et sa respiration est toujours sifflante, mais son regard luit intensément et il parait heureux. Alors les conversations reprennent et les rires éclatent à nouveau. Le soleil poursuit sa course quotidienne, tandis qu'ils devisent joyeusement, heureux d'être débarrassés de l'ambiance morose d'Iduvief et soulagés de voir Severin sur pied.
Trois silhouettes entièrement masquées par d'épaisses capes entrent dans l'auberge, les faisant taire. Avec curiosité, ils les scrutent tandis que deux jeunes et jolies femme et un homme plus âgé émergent des capes. Très vite apparaissent luth, flûte et tambours. Des ménestrels ! Voyant que leur arrivée n'est pas passée inaperçue, ils s'approchent de la table de Calith et l'homme déclare :
- Que de nobles guerriers, en cette belle tablée ! De si nobles guerriers qu'il me semble, mes chères, poursuit-il en prenant à témoin les deux jeunes femmes, qu'ils ne seront pas insensibles à nos récits chevaleresques. Et qu'ils comprendront très bien que de pauvres ménestrels comme nous ne peuvent exercer leur art la gorge sèche, et que les temps sont durs, si durs...
Calith retient de justesse un sourire. Des troubadours ou des ménestrels itinérants ne cessent de se rendre à Pieveth, dans l'espoir d'y être accueilli quelques jours en l'échange de divertissement. Et Calith, par la voix d'un de ses conseillers, se montre toujours enclin à accepter. Mais il sait très bien qu'ils ont les moyens de se payer une chope, et qu'ils chanteront quoiqu'il advienne. Il s'apprête à refuser poliment mais fermement cet arrangement quand les jumeaux, dévorant du regard les jeunes femmes, appellent Xalaphas pour qu'il les serve et prennent sur leurs propres deniers pour régler la note.
Calith reste impassible, réalisant soudain que ces divertissements, quasiment quotidiens à la cour, sont très prisés chez les soldats, plus encore quand de belles femmes y prennent part. Le reste de l'après-midi se passe donc à écouter chansons et récits épiques, pour le plus grand bonheur de tous. Et ils n'ont pas quitté la table que Hilda revient avec le dîner, un épais potage qui leur met l'eau à la bouche, malgré tout ce qu'ils ont ingurgité plus tôt.
La soirée file à une vitesse folle, rythmée par la musique et les contes, sous un auditoire toujours plus nombreux et fasciné. Et lorsque les derniers accords s'éteignent, Calith et ses compagnons reprennent pied dans la réalité. Severin s'est endormi sur son fauteuil, couvé par un Nyv' aux petits soins. Iezahel caresse distraitement les cheveux ébènes de son fils endormi. Et les jumeaux, la bouche en cœur, s'approchent des ménestrels. Calith secoue doucement la tête et déclare, amusé :
- Bien, je suppose qu'on ne les verra pas ce soir. Je suis épuisé, par contre, donc si vous permettez...
Iezahel se lève aussitôt et lui emboîte le pas. Ils ne se rendent pas tout de suite à l'étage, préférant d'abord faire ce fameux brin de toilette tant de fois reporté. Ils sont les premiers arrivés, dans les grands lits communs. Ils en profitent donc pour coucher Fáelán et se blottir dans les bras l'un de l'autre. Iezahel lui demande dans un murmure :
- Tu ne le revendras pas, n'est-ce pas ?
- Jamais, je t'en fais le serment. Je suis désolé pour tout à l'heure, j'ai essayé d'être drôle mais tu sais...
- Oui, tu n'es pas toujours très doué.
Calith fuit son regard amusé, conscient que cette pique est amplement méritée. Il n'ose pas se mettre à sa place, quand il a entendu ces paroles malheureuses. Iezahel lui redresse le menton, un sourire tendre sur les lèvres, et l'embrasse délicatement. Malgré la peur que Calith a fait ressurgir, malgré son manque évident de tact, Iezahel l'aime encore. Il sait qu'il devra tout faire pour le rassurer à ce sujet, mais son amant ne lui en veut plus. Alors il le serre contre lui et répond avec fougue à son baiser.
Ce n'est pas l'envie qui leur manque, mais l'heure n'est pas aux galipettes : Loundor et ses hommes peuvent surgir à tout instant et bon, ils sont dans un lit commun, avec Fáelán juste à côté. Et ils ne sont pas avides de l'autre au point de voler des moments d'intimité dans ces conditions : ils préfèrent prendre leur temps, juste tous les deux, tranquillement.
Ils restent donc serrés l'un contre l'autre, à s'effleurer, à s'embrasser, à se caresser dans la discrétion relative de la couverture. Et peu après, des pas lourds signalent l'approche de Loundor et ses hommes. Tous ses hommes, mêmes les jumeaux, déconfits. Calith étouffe son éclat de rire dans le creux de l'épaule de Iezahel. La fatigue est trop forte cependant : ils s'endorment sans commenter le retour des jumeaux.
Iduvief, chapitre 31
Loundor redresse la tête, surpris. C'est que Iezahel n'a pas franchement pour habitude d'amorcer des conversations ou de se montrer curieux. Mais Loundor apprécie et, tout en passant doucement ses mains dans les poils du louveteau, explique :
- C'était bien avant la naissance de Calith. Bon, il faut savoir que les loups-garous ont toujours été acceptés dans ce royaume, ils ne se cachaient pas et vivaient souvent au milieu des humains. Il arrivait souvent qu'une meute s'installe dans le village et soit bien accueillie. Mais pour des raisons diverses, par réelle conviction ou poussés par leurs familles, certains loups-garous s'engageaient dans l'armée.
Calith glisse sa main dans celle de Iezahel, absorbé par l'explication. Il en connaissait les grandes lignes, mais que cet événement soit raconté par Loundor ajoute une sacrée valeur au récit. Iezahel boit ses paroles, oubliant son fils qui s'amuse comme un petit fou avec les bottes du Général. Ce dernier, imperturbable, poursuit :
- Le problème, à l'armée, c'est qu'ils ne voulaient pas confier la section lycanthrope à un loup-garou. Ils reconnaissaient notre valeur, ils ne doutaient pas qu'on puisse diriger une telle section mais ils estimaient que c'était plus logique qu'un humain nous commande. Un humain capable de prendre des décisions sans être submergé par son loup, un humain capable de rester homme pendant la pleine lune. Ils avaient tenté deux ou trois fois de mettre un loup à la tête de cette section, et ça s'était mal terminé à chaque fois. Ils en avaient donc conclu que c'était une mauvaise solution. Le sergent qui nous dirigeait, quand je suis entré à l'armée, était un type correct et compréhensif, je crois qu'on le respectait tous. Mais il n'avait pas l'autorité naturelle d'un alpha. Et bon, soyons honnêtes, une bonne partie de ces loups-garous étaient des sauvages. Ils se battaient entre eux à longueur de temps, chahutaient les femmes qu'on rencontrait, taquinaient les autres soldats. Ils étaient comme des fauves sans garde-fou et sans chef. Car même si ils appréciaient le sergent, l'absence d'un alpha se faisait cruellement sentir.
Iezahel hoche régulièrement la tête, mais Calith, bien qu'au fait des coutumes lycanthropes, peine à saisir en quoi cette absence les gênaient tant. Et voyant son air perplexe, Loundor explique :
- La notion de meute n'existait pas. Tous les loups-garous étaient rassemblés, mais il n'y avait rien pour les souder, et aucun meneur pour les guider de manière instinctive. Comme il n'y avait pas d'alpha, les luttes de dominance étaient presque permanentes, ce qui nous donnait une réputation terrible. Il n'y avait pas souvent de bagarres à proprement parler, mais il y avait énormément de tensions, et la moindre petite chose pouvait mettre le feu aux poudres. Alors on était toujours envoyé à droite ou à gauche, pour mettre hors d'état de nuire des pillards, des bandits de grand chemin, et parfois, des mercenaires.
Fáelán s'est lassé de jouer avec le Général, et revient vers son père. Il escalade vaillamment ses jambes avant de se lover sur ses cuisses et de pousser un long gémissement. Le regard avide de Iezahel pousse Loundor à reprendre son histoire, malgré cette petite interruption :
- Ça faisait plusieurs semaines qu'on était sur les routes, suivant la piste de malandrins qui semaient la terreur au nord du Royaume. Quand on a réussi à les trouver, ça a tourné au désastre. Ils étaient beaucoup plus nombreux que prévu, et armés jusqu'aux dents. Notre sergent est mort pendant ce combat, ainsi qu'une demi-douzaine de loups. Nous nous retrouvions sans meneur, et l'excitation du combat nous avait contaminé : on s'est battus comme des chiffonniers, laissant encore des cadavres derrière nous. C'est ce jour-là que je suis devenu alpha de la troupe de bras cassés qui composait cette section. Ça n'a pas été facile, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on est devenu une meute. On n'est pas rentré à Pieveth tout de suite. On avait besoin de temps pour souder la meute, et à vrai dire, personne n'était pressé d'aller rendre des comptes au Général de l'époque pour qu'il nous refourgue un autre sergent. On avait trouvé notre équilibre et on voulait en profiter. Alors on a sillonné le royaume, suivant les témoignages des habitants qui nous faisaient part d'agressions, de vols, de passages d'hommes armés. En fait, on était quasiment devenu une armée de déserteurs et de renégats.
Loundor s'interrompt, les yeux perdus dans le vague, revivant cette époque comme s'il y était encore. Calith et Iezahel gardent un silence respectueux, peu désireux de mettre fin à ces souvenirs. Fáelán s'est endormi et ronfle doucement. Quelques instants passent avant que Loundor ne reprenne :
- C'est au fin fond de nulle part qu'on a retrouvé une autre escouade. Ils étaient dans une situation impossible et un peu de renforts, même venant de loups-garous, n'était pas de refus. Je m'étais présenté comme étant le responsable de la section, puisque notre sergent était mort, et c'est avec l'autre sergent que nous avons mis au point le plan d'attaque. On n'était pas bien loin de la frontière, dans une zone déserte, et un campement de mercenaires avait pris ses quartiers dans une clairière. C'était des hommes d'armes, habitués aux combats. Nos deux sections ont utilisés les points forts de chacune pour réussir à les bouter hors de la forêt et les renvoyer vers Lluse. Notre meute s'est encore plus soudée lors de cette attaque, et notre collaboration avec l'autre section s'est parfaitement bien passée. Et même mieux, on avait réussi à conjuguer nos forces, à exploiter nos avantages pour faire un minimum de blessés dans nos rangs. Et nous avons poursuivi notre collaboration jusqu'à notre retour à Pieveth. Ce furent ces rapports de missions qui ajoutèrent du poids à notre argumentaire, et le Général accepta de nous laisser travailler en collaboration. Et il accepta également que je garde la tête de la section des lycanthropes.
Loundor leur jette un regard songeur, les voyant à peine, avant de terminer :
- Ça a mis beaucoup de temps pour que d'autres escouades nous accordent leur confiance. J'ai pris du grade, l'ancien Général est parti et j'ai finalement pris sa place. Mélanger les loups-garous et les soldats était déjà plus ou moins courant, et je l'ai banalisé.
Il n'y a aucun fierté dans la voix de Loundor, aucune trace de fanfaronnade : il énonce juste des faits, sans arrogance ni prétention. Il est sur le point de rajouter quelque chose lorsqu'un bruit de pas les fait tous se retourner. L'un des jumeaux se tient bien droit sur le plancher, et annonce dans un large sourire :
- Severin a repris connaissance !
Ils se lèvent comme un seul homme, Iezahel tenant délicatement le louveteau dans ses bras. Dans la petite chambre basse de plafond, ne restent que Nyv' et Filraen. Asaukin et l'autre jumeau ont sans doute été les voir, mais ont regagné la seconde chambre ensuite. Le mage s'affaire autour du blessé fiévreux, qui observe son environnement avec de grands yeux étonnés. Toujours allongé à côté de lui, Nyv' lui caresse doucement l'épaule en le scrutant intensément.
Le regard un peu hagard de l'esclave se porte soudain sur Calith, et il lui faut quelques secondes pour comprendre ce qu'il se passe. Mais aussitôt, il tente de se relever en balbutiant des paroles incompréhensibles. Calith s'approche aussitôt et s'accroupit près du lit. Severin le suit du regard, c'est d'une voix d'outre-tombe qu'il murmure :
- Sire. Je suis désolé, Sire, j'ai échoué. Je n'ai pas été assez discret et Florain...
La suite de sa phrase se perd dans une longue quinte de toux, qui le laisse couvert de sueur et à bout de souffle. Filraen fait claquer sa langue contre le palais de désapprobation mais ne souffle pas mot. Calith, secouant doucement la tête, chuchote :
- Ne t'en fais pas. Je suis navré de t'avoir confié une mission si périlleuse. Et plus navré encore de constater les conséquences de cet acte.
Severin pince les lèvres et lève les yeux au plafond. Des yeux qui ne tardent pas à se remplir de larmes, qui laissent le roi désemparé. L'esclave laisse échapper d'une voix étranglée :
- Qu'est ce que je vais devenir ?
S'il n'était pas dans un tel état de faiblesse, Severin n'aurait sans doute jamais osé prononcer cette phrase. Sa condition lui interdit d'exprimer la moindre plainte, le moindre doute. Qui plus est devant un roi. Mais là, dans cette minuscule chambre poussiéreuse et envahie d'odeurs d'écurie, ses pensées sont portées vers son avenir. Et il les énonce à voix haute. Calith déclare, de son ton le plus royal, celui qui ne souffre pas la moindre protestation :
-Il est hors de question que tu te retrouves à errer dans le royaume, à la merci de quiconque. Tu rentres avec nous à Pieveth.
Le regard de Nyv' se rive dans celui du roi, et un léger sourire vient éclairer son visage marqué par l'inquiétude. Mais l'éclaireur reporte bien vite son attention sur Severin, qui vient de laisser échapper un sanglot. Il le serre contre lui en lui murmurant « on sera ensemble » et l'esclave lui rend son étreinte avec toutes ses maigres forces. Calith se redresse et s'écarte du lit, leur laissant un peu d'intimité. Il fait signe à Filraen de sortir. Loundor et Iezahel sur ses talons, il quitte la petite chambre, pour se rendre dans l'autre. Et à peine la porte poussée, ignorant les jumeaux et Asaukin qui feignent de jouer, il demande d'une voix assez basse pour ne pas être entendu par Nyv' et Severin :
- Est-ce qu'il sera en état de voyager d'ici demain ? Nous ne pouvons pas rester ici plus d'une nuit.
- C'est difficile à dire, Votre Majesté. Ce soir, il n'est pas en état, c'est certain. Mais peut-être qu'une bonne nuit de repos, avec quelques sorts, des infusions pour sa poitrine et sa fièvre, et... Enfin, peut-être que demain, il pourrait voyager sans risque d'aggraver son état. Mais ça ne sera pas de tout repos, et je ne pense pas que ce soit bien sain de le faire partir si vite.
- Mais rester dans cette chambre n'est pas très sain non plus. Et Lucias ne pourra pas vous garder ici le temps qu'il se rétablisse.
- Je vous l'accorde. Certes, c'est toujours mieux que dans la neige, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour une convalescence. Je pense par contre qu'il est trop faible pour faire le voyage d'une traite jusqu'à Pieveth. Il faut quoi, quatre jours de voyage ?
- Cinq jours. Avec des hommes en bonne santé.
- Dans ce cas, j'ai peur que ce soit trop. Il n'y a pas une auberge à proximité qui …
Filraen se fige soudain, bouche entrouverte. Ses joues se colorent de rose et il fixe intensément ses bottes. Et dans un murmure, il déclare :
- Nous ferons comme vous le souhaiterez Votre Majesté.
Lui qui n'est déjà pas bien grand semble se ratatiner sur lui-même, comme s'il voulait se glisser dans un trou de souris. Calith observe son manège, interloqué, avant de jeter un regard perdu à Iezahel, qui tient contre lui un Fáelán bien décidé à dévorer entièrement sa chemise. Iezahel qui, dans un sourire de connivence, s'approche de lui et l'effleure au niveau de la taille. Enfin, effleure sa bourse, surtout. Et il faut encore une poignée de secondes à Calith pour comprendre. Bien sûr, il faut payer l'auberge, surtout si Severin a besoin d'y rester plusieurs jours. Severin, qui n'a pas un sou en poche, pas même une tenue de rechange. Et Filraen n'est sans doute pas bien riche : la plupart du temps, les seigneurs de fief offrent gîte et couvert à leurs hommes de confiance et ils subviennent à tous leurs besoins. Ils les rétribuent parfois mais connaissant la situation de Filraen à Iduvief, il n'a pas dû partir avec une besace pleine d'or. Ce sera très probablement à Calith de payer les jours à l'auberge, sans compter que rien n'assure à Filraen que son roi souhaite voir un esclave passer plusieurs jours dans ce genre d'établissement. Calith passe une main dans ses cheveux avant de décider :
- Nous ferons la route ensemble jusqu'à l'Hydre qui Fume. Puis vous y resterez jusqu'à ce que Severin soit en état de voyager sans risque pour sa santé. Vous resterez, Filraen, ainsi que Nyv'.
Loundor hoche la tête d'approbation, tandis que le mage se répand en remerciements sans fin, que Calith finit par interrompre d'un léger signe de la main. Et c'est le Général qui leur offre l'échappatoire idéale en rappelant qu'il faudrait faire un brin de toilette avant le dîner.
Finalement, le mage retourne veiller sur son patient, tandis que la troupe descend jusque dans la salle à manger, où brûle un feu crépitant. Mais alors qu'ils discutent de tout et de rien en attendant que l'eau chauffe, Lucias prend la poudre d'escampette et s'éloigne de son roi, qui le met terriblement mal à l'aise.
Ils se lavent les uns après les autres, dans une petite cuvette d'étain, laissant le roi passer en premier. Puis vient l'heure du dîner, qu'ils partagent dans cette salle, discutant principalement du convalescent à l'étage, et de la joie de Nyv'. Lorsque leur maigre pitance est terminée, Filraen laisse échapper :
- Ainsi, c'est donc Thilda qui les a tous tués ? Je ne l'en aurais jamais cru capable...
- C'est vrai qu'elle ne donnait pas l'impression de pouvoir tuer de sang-froid comme elle l'a fait. Mais c'était bien elle, elle a avoué dès qu'on a trouvé le poison. D'ailleurs, à ce sujet, elle ne l'appelle pas nimhiù mais Soleil Vert. Ça vous dit quelque chose ?
- Bien sûr, Votre Altesse ! C'est l'un des surnoms de ce poison. Je suis sûr que j'ai quelques lignes à ce sujet, dans mes manuscrits !
Le mage a déjà bondi hors du banc, et s'apprête sans doute à s'élancer jusqu'à l'étage pour fouiner dans ses manuscrits jusqu'à trouver la bonne référence. Mais Calith l'arrête d'un geste de la main en déclarant :
- Laissez, Filraen, je vous crois. Nous avons juste été surpris qu'elle ne connaisse pas le nimhiù.
- Oh, vous savez, ce n'est pas rare. Il y a énormément de plantes que les gens nomment par un surnom, souvent parce que le nom réel est trop compliqué. Et souvent, aussi, parce que la plante ressemble à autre chose. Elle vient d'où, Thilda ?
- De Tragne.
- Alors c'est ça. Si mes souvenirs sont bons, il existe une légende, là-bas, directement liée à leur position géographique, qui veut que lorsque l'aube est nimbée de vert, une mort subite peut toucher tous ceux qui l'ont vu. Et c'est pour ça qu'ils ont surnommé ce poison Soleil Vert. C'est assez fascinant de voir à quel point les croyances populaires peuvent s'immiscer dans la...
Un grondement, de la part de Loundor, le fait s'interrompre l'espace de quelques secondes, avant qu'il ne demande de plus amples explications sur les actes de Thilda. Et Calith, patiemment, lui narre tout ce qu'ils ont appris sur ses motivations, sur sa manière de procéder, et sur ce qu'il va devenir d'elle. Et inlassablement, Filraen pose des questions, digresse, s'étonne et livre ses pensées. Sans aucun répit. C'est un claquement sec qui met fin à cette conversation interminable, lorsque, à trop martyriser sa cuillère pour laisser libre cours à son impatience, Loundor finit par la casser en deux. Tout penaud, le mage s'excuse longuement, puis prétexte les soins de Severin pour fuir ventre à terre. Et Loundor n'a même pas l'air coupable lorsqu'il termine sa chope de vin. Un léger sourire carnassier effleure ses lèvres lorsqu'il décrète :
- Allons nous coucher, nous aurons besoin de nos forces pour demain.
Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, dans cet espace peu propice aux groupes si importants. Chacun regagne donc le lieu où il va dormir dans un silence relatif. Après avoir installé une grande couverture à même le foin, pour éviter d'avoir encore affaire aux terribles brins, Calith et Iezahel se blottissent l'un contre l'autre. Fáelán se love contre son père, tandis que Loundor et Asaukin s'installent un peu plus loin. Et ils ne tardent pas à sombrer dans un sommeil réparateur.
La matinée est déjà bien avancée quand, après avoir pris leur petit-déjeuner, ils se rendent dans la chambre de Severin. L'esclave est adossé à de nombreux oreillers, et si sa respiration est encore sifflante, il ne semble plus avoir de fièvre. Les soins de Filraen ont été efficace. Lorsqu'il porte son regard sur les nouveaux venus, il tente à nouveau de se lever, comme s'il était indécent de rester au lit en présence de roi, quel que soit son état de santé. Mais Calith, d'un sourire et d'un geste de la main, l'apaise et s'approche de lui.
- Sire, je suis vraiment navré de...
- Ça suffit, Severin, on en a déjà parlé hier. Tu n'as pas failli à ta mission, tu n'as pas échoué, d'accord ? Je ne t'en veux absolument pas.
Calith tire une chaise à lui, et s'installe non loin du convalescent, qui semble mortifié. Alors, comme le rassurer, le roi poursuit :
- A vrai dire, je me sens responsable. Si je ne t'avais pas confié une telle mission, jamais tu ne te serais retrouvé à l'article de la mort. Et plus tu t'excuses, plus je me sens mal. Alors s'il te plaît, arrête avec ça et dis-nous plutôt comment tu te sens.
L'esclave jette un regard à Nyv', debout au pied du lit, et à Filraen, qui fouille avec application dans ses affaires. Après un court silence, d'une voix encore faible, il avoue :
- Pas très bien. Je... enfin, j'arrive mieux à réfléchir, avant, j'avais l'impression d'être dans une sorte de brouillard. Ma poitrine, mes mains et mes pieds me font encore souffrir. Mais Filraen s'occupe vraiment très bien de moi et Nyv' me veille comme une mère.
Calith esquisse un sourire en voyant les deux concernés s'empourprer et déclare d'une voix douce :
- Le plus important, c'est que tu aies repris conscience. La douleur va s'atténuer avec le temps, tu verras. Est-ce que tu te sens capable de nous raconter ce qu'il s'est passé ?
- Je pense, oui, Votre Majesté.
- Dans ce cas, nous t'écoutons. Mais n'hésite pas à nous dire si tu te sens trop fatigué.
- Merci Sire. C'était il y a …. enfin, mon dernier jour à Iduvief. Je me rendais dans les écuries, pour … euh... enfin, la leçon de raquettes avec Nyv'...
Ses joues s'empourprent soudain. D'un geste réflexe, il se triture les doigts, mais il cesse bien vite : encore bandés, recouverts d'engelures, ils sont sans doute douloureux. Filraen a trouvé ce qu'il cherchait et lui apporte un gobelet d'infusion, qu'il lui fait boire avec autorité, sans se soucier de la présence de son roi. Lorsqu'il s'écarte, Severin reprend son récit :
- En chemin, j'ai croisé un esclave que je n'avais pas encore entendu, concernant la présence de Florain dans les écuries. Alors je me suis arrêté un moment, et je l'ai interrogé. Je n'ai pas entendu Florain arriver dans mon dos. J'ai juste senti qu'il m'attrapait par le col et qu'il me traînait à sa suite. Il m'a conduit jusqu'à son bureau où il m'a jeté à terre. Et il s'est mis à me hurler dessus. Je n'ai pas nié mes recherches, ça n'aurait servi à rien, il m'avait surpris. Il voulait tout savoir, pour qui j'enquêtais, ce que je cherchais exactement, qui j'avais interrogé et ce que j'avais appris. J'ai essayé d'en dire le moins possible, mais …
- Je me doute, oui, qu'il n'allait pas se satisfaire de quelques réponses évasives. Tu lui as dit que c'était moi qui t'avait ordonné de poser des questions ?
- J'ai bien été obligé, Sire, il …
- Severin porte encore les traces des coups qu'il a reçu, intervient Filraen d'une voix douce.
- Je lui ai rappelé que j'étais sous votre protection, Sire, alors il s'est un peu calmé, poursuit Severin, ignorant l'intervention du mage comme si ça n'avait aucune importance. Il m'a laissé tranquille quelques minutes, le temps de réfléchir. Puis il m'a demandé si votre protection s'étendait aussi aux bannissements. Il connaissait parfaitement la réponse, bien sûr, mais il voulait me l'entendre dire. Et quand je lui ai confirmé que non, votre protection ne s'étendait pas à ça, il m'a attrapé par le bras et m'a annoncé que j'étais banni d'Iduvief.
Les yeux de Severin se remplissent de larmes, et sa voix s'étrangle au point de l'empêcher de poursuivre. Nyv' s'approche doucement et s'assoit près des oreillers, de manière à lui caresser la joue. Calith murmure :
- Je n'ai jamais pensée une seule seconde que Florain pouvait envisager cette solution extrême en guise de châtiment. Et ma foi, même si je suppose que Iduvief était tout ce que tu connaissais, ce n'est pas une si mauvaise chose. Tu vas rentrer à Pieveth avec nous, et tu découvriras que les esclaves n'ont pas à être autant maltraités que tu l'as été.
Severin esquisse un sourire triste et frotte doucement sa joue droite contre la main aimante de l'éclaireur. Quand il semble avoir repris ses esprits, il répond :
- Vous avez raison, Sire, mais... enfin... je laisse tant de personnes derrière moi. Enfin. Florain m'a juste remis une vieille cape, puis il m'a traîné derrière lui jusqu'au portail. J'ai bien vu que le garde n'approuvait pas cette décision, mais qu'aurait-il bien pu faire ? Il faisait déjà un froid terrible et je ne pouvais pas rester là, devant le portail. Je me doutais que le garde avait reçu comme consigne de ne pas m'ouvrir alors j'ai commencé à marcher. Je savais que je n'avais pas le choix, mais quoique je fasse, je me pensais perdu. Il fallait un miracle pour que j'arrive jusqu'à une habitation. Mais là, on aurait tout de suite vu que j'étais un esclave sans son maître. On aurait tout de suite compris que j'étais en fuite ou banni. Et dans un cas comme dans l'autre, j'aurais été immédiatement arrêté, puis exécuté. Mais je ne pouvais pas rester là, à mourir dans la neige, sous les murs du château. Alors j'ai avancé, j'ai lutté contre le froid, contre mes jambes qui peinaient tant à me porter. J'espérais que je pourrais me cacher, que je trouverais refuge quelque part. Peut-être en allant dans un autre royaume. Je ne me souviens plus très bien, mais il me semble que le soleil était levé quand je suis arrivé en bas de la pente. Mais j'étais à bout de force, je ne sentais plus ni mes pieds, ni mes mains. Je savais que je ne devais pas rester sur la route principale, mais je n'avais plus la force de continuer. J'ai essayé, pourtant, mais je me suis écroulé. Et je me suis réveillé ici, entouré par Nyv' et par Filraen.
Le silence est religieux, dans la petite chambre, alors que meurent les derniers détails de l'épreuve de Severin. Les airs sont graves, autour du lit, et c'est la voix vibrante de respect de Nyv' qui met fin à ce moment :
- Je suis incroyablement fier de toi. Et je suis heureux de ta décision d'avancer, au lieu d'accepter ton sort et de te laisser mourir de froid.
Nyv' s'interrompt, comme conscient de la maladresse de ses propos, ou de la présence des autres autour. Severin tourne difficilement la tête vers lui et tente un sourire peu convaincant. Alors Nyv' se penche vers lui et l'embrasse chastement, faisant virer les joues de l'esclave à l'écarlate. Calith reprend la discussion en main, comme si de rien n'était :
- Ce qui est fait est fait. Florain est mort désormais, je suppose qu'on te l'a appris, et de toute façon, il ne pouvait plus te nuire. Tu vas rentrer à Pieveth avec nous mais, à moins que ta santé se soit miraculeusement améliorée, on ne pourra pas faire le trajet ensemble.
Une rapide dénégation, de la part de Filraen, confirme les propos de Calith : Severin, bien qu'en meilleure forme que la veille, n'est pas apte à faire une si longue route. Le roi poursuit donc :
- Nous partirons en début d'après-midi, pour arriver ce soir à la première auberge. Mais nous n'y resterons que le temps d'une nuit, nous reprendrons la route demain jusqu'à l'autre auberge, où tu pourras te rétablir. Tu y resteras le temps qu'il faudra pour pouvoir rejoindre ensuite le château en toute sécurité. Nous ne sommes pas à une poignée de jours près, et je vous veux tous en bonne santé à votre arrivée. Par contre, et j'insiste car c'est un point très important : ne mentionnez jamais le fait que je suis le roi. Ne m'appelez pas Votre Majesté ou Sire. Ne me traitez pas différemment des autres. C'est trop risqué que je voyage en tant que roi, nous ne sommes pas assez nombreux pour assurer ma sécurité. C'est bien compris ?
Severin hoche vivement la tête, très sérieux, et Calith est convaincu que l'esclave saura tenir sa langue. Mais Filraen semble paniqué soudain, et il n'est guère compliqué de comprendre les raisons de son hésitation : il a la langue bien pendue et une gaffe est si vite arrivée... Le mage promet, et Calith devine que ça sera pour lui une véritable mission, qui va mobiliser beaucoup d'énergie. Mais il n'a que leur parole et il devra bien s'en contenter. Alors, un léger sourire sur le visage, il conclut :
- Nous avons encore beaucoup à faire. Je vous charge de préparer Severin, pour qu'il voyage dans les meilleures conditions possibles. Nous nous occupons des montures.
Filraen et Nyv' acceptent les ordres d'un simple hochement de tête, et Severin se perd en remerciements sans fin. Les laissant à leurs préparatifs, Loundor, Calith et Iezahel, portant son louveteau, se rendent dans les écuries.
Lucias s'est montré étonnamment discret, depuis qu'il a appris que le roi en personne séjournait dans son modeste relais. Par gêne et par timidité, d'après Loundor. Peut-être aussi, d'après Calith, par crainte qu'ils découvrent certains arrangements avec la légalité. Mais qu'importe, Calith n'est, de toute façon, pas là pour s'assurer que ses sujets respectent les lois, et Lucias leur offre un toit inespéré. Et il se montre très à l'écoute de leurs besoins. Severin ne pourra pas tenir seul en selle, il leur faut donc une monture assez solide pour supporter le poids de deux hommes. Et alors qu'ils exposent leur problème, Lucias leur trouve la solution la plus adaptée à leurs besoins : une selle à l'origine conçue pour les voyages en charmante compagnie, qui permet à la femme de s'installer en amazone, tandis que l'homme, derrière, chevauchant de manière traditionnelle, peut la retenir en cas de besoin. Et Lucias leur montre la monture idéale : un énorme cheval, aux pattes épaisses et au regard placide. Parfait pour transporter des charges lourdes, d'après lui, même s'il faudra veiller à ne pas trop le pousser. Loundor et Calith sont sous le charme, et admirent la ligne parfaite de son dos. Mais Iezahel, lui, tente vainement de calmer Fáelán qui s'est réfugié entre ses chevilles et tremble de peur. Ils ne s'attardent donc pas plus que nécessaire, prenant juste le temps de remercier Lucias comme il se doit. Les préparatifs se terminent à temps pour le déjeuner, qu'ils expédient assez rapidement. Puis vient le moment délicat où Severin, chancelant sur ses jambes encore faibles, s'approche du cheval. Nyv' se met en selle en premier, puis Loundor et Iezahel aident l'esclave à s'assoir. Nyv' se charge de l'emmitoufler dans une cape avant de rabattre la sienne sur leurs deux corps. Voyant qu'ils sont aussi bien installés que possible, tous montent en selle à leur tour, Fáelán lové tout contre son père dans la bande de tissu. Et après d'ultimes remerciements, ils quittent le relais de Lucias.
Le froid est pénétrant lorsqu'ils quittent l'écurie, et le soleil se réverbère sur la neige, leur faisant plisser les yeux. Nyv' resserre son étreinte autour de Severin et lui chuchote quelques mots à l'oreille. Lentement, dans un silence complet, ils se mettent en route, épiant du coin de l'œil les réactions de Severin, s'assurant que le rythme des chevaux ne le secoue pas trop. Après une bonne heure, les jumeaux se mettent soudain à discuter. La conversation n'a rien de bien passionnant, mais Filraen se joint à eux, puis Asaukin et Loundor. Très vite, les éclats de rire fusent, les plaisanteries s'enchaînent, et Calith peut voir Severin se détendre enfin.
Le soleil commence à disparaître derrière les montagnes quand ils arrivent au petit village. Ils ne gardent pas un bon souvenir de l'auberge, pas plus que de l'aubergiste d'ailleurs, mais ils rêvent tous d'un repas chaud et d'un lit. Severin, affalé sur Nyv', tremble de tous ses membres. Malgré les deux capes, il est frigorifié mais son visage est recouvert de sueur. Lorsqu'ils s'arrêtent enfin devant l'auberge, Filraen saute en bas de sa monture et se précipite vers lui, scrutant d'un air inquiet son regard vitreux.
Calith, suivi de près par Iezahel, Asaukin et les jumeaux, s'approche de la porte principale de l'auberge. Qui s'ouvre avant même qu'il n'ait pu frapper, dévoilant l'aubergiste et deux hommes aux visages rubiconds. Le propriétaire des lieux devait être en train de raccompagner ses clients jusqu'à la sortie car il cesse immédiatement ses formules de politesse en voyant l'étrange groupe posté devant son établissement. Son regard perd toute chaleur quand il demande d'une voix sèche :
- C'est pour quoi ?
- Est-ce qu'il vous reste de la place pour neuf personnes ?
Calith a parlé d'une voix indifférente, ne mettant nul espoir dans cette question : pourtant, s'il n'y a pas de place pour eux ici, ils devront chercher un autre endroit où dormir et ça s'annonce compliqué. Tandis qu'il scrute les voyageurs, l'aubergiste réclame :
- Vous avez de quoi pay... Lui, là, il est malade ?
D'une main usée par les travaux manuels, il désigne Severin. Et Calith est bien obligé de répondre :
- Il a juste pris froid, rien de grave.
- Rien de grave, hein ?
L'imposant bonhomme se rapproche de la monture de Nyv', suivi comme son ombre par ses deux clients. Et l'un d'entre eux, aviné, déclare :
- Ma femme avait pas meilleure mine, quand elle a attrapé la Peste.
- Ben j'me disais la mêm'chose ! C'était pas beau à voir et là, ma foi...
Calith pince les lèvres en entendant les deux ivrognes pérorer sur les symptômes de la Peste. L'épidémie avait frappé bien avant sa naissance, faisant des ravages dans le royaume et ceux limitrophes. La mémoire populaire, vive et tenace, s'en souvient pourtant avec une terrible précision. Maudissant les deux soiffards, il déclare d'une voix pleine d'assurance :
- Si c'était la Peste, on l'aurait laissé mourir au fond d'un fossé, ce n'est qu'un esclave. Il a juste pris froid, comme je vous le disais, et nous avons largement de quoi vous payer.
Mais l'aubergiste le toise de bas en haut, avant de cracher d'un ton dédaigneux :
- Et pourquoi est-ce que je vous croirais, hein ?
La tension monte dans la rue principale du petit village. Des clients curieux sortent de l'auberge pour satisfaire leur soif de potins. Calith n'a pas le temps de trouver une bonne répartie que Loundor s'approche de l'aubergiste et décrète :
- C'est un homme de parole, comme nous tous ici. Cet esclave n'a pas la Peste, soyez-en assurés.
L'aubergiste ricane, prenant à témoin les clients qui se massent maintenant derrière lui et clame à tue-tête :
- Et voilà le gros bras qui vient prêter main forte au freluquet qui se prend pour un nobliau !
Sa mâchoire cède dans un craquement écœurant. Le poing de Loundor est parti si vite et si fort qu'ils ont à peine eu le temps de voir le geste. Et Calith a à peine eu le temps de comprendre que c'était lui, le freluquet en question, que son Général explosait la mâchoire de l'aubergiste.
La main gauche autour de Fáelán, Iezahel repousse sa cape sur son épaule pour dégager son bras droit et s'interpose entre Calith et les clients de l'auberge. C'est le chaos soudain. Les coups fusent. Les loups-garous s'en donnent à cœur joie, très vite rejoints par les hommes de Loundor. Calith reste immobile, prêt à en découdre. Mais Iezahel ne laisse personne l'approcher, grondant et cognant sans répit. Même Fáelán, les yeux grands ouverts, les lèvres retroussées, gronde.
Si l'escorte royale a reçu quelques coups, les dommages sont bien plus importants chez les clients de l'auberge. Ceux qui en sont encore capables déguerpissent dans toutes les directions. Les autres restent à terre en gémissant.
Les moins téméraires, ceux qui sont restés près de la porte, s'approchent enfin pour venir récupérer les blessés. Et alors que Calith s'apprête à sermonner son Général pour son manque de retenue, Loundor explose :
- Ça commence à bien faire, à la fin ! Y'en a pas un pour rattraper l'autre ! Tous aussi méprisants et arrogants ! Y'en a marre ! Un peu de respect, c'est trop vous demander ?
Il éructe sa rage, et sa voix grondante résonne entre les murs des maisonnettes blotties le long de la route principale. Les volets qui s'étaient ouverts discrètement sur les curieux se referment tout aussi discrètement. Le long d'une façade, un amoncellement de neige en équilibre précaire chute dans un bruit sourd, vaincu par les vibrations du hurlement. Et soudain, un calme irréel retombe sur le village.
Iezahel rabat les pans de sa cape autour de Fáelán. Aux mouvements du tissu, Calith devine qu'il caresse le dos de son fils, tandis qu'il lui murmure des paroles rassurantes. Mais ses yeux restent en alerte, prêt à se battre à nouveau. Asaukin et les jumeaux sont toujours sur le qui-vive, prêts à suivre leur Général. Et Loundor, lui, tourne en rond, bougonnant des imprécations muettes.
D'un commun accord, sans se concerter, ils se rapprochent de Filraen et Nyv'. Severin les observe, hagard. C'est finalement Calith qui rompt le silence après s'être éclaircit la voix :
-Ce n'était sans doute pas le plus intelligent à faire.
- Et je m'en fous. La coupe est pleine. J'en ai plus qu'assez d'être traité comme un malpropre. Non mais franchement...
- Tu aurais pu nous en laisser un peu plus.
Calith le coupe dans sa tirade furieuse, et son reproche, assené avec un léger sourire, calme soudain Loundor. Ils se dévisagent un court moment, dans la lumière blafarde du crépuscule, avant que Loundor avoue :
- Bon, c'est vrai, j'aurais peut-être dû attendre qu'on soit installés pour lui casser la gueule.
Calith hoche doucement la tête, n'ayant pas le cœur à insister sur les conséquences de son acte. Et puis, à vrai dire, même s'il n'a pas pu participer, il a apprécié, ne serait-ce que pour une fois, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Sauf qu'un problème se pose désormais, et pas des moindres. L'aubergiste ne les acceptera jamais dans son établissement. Et la rumeur sur la prétendue Peste de Severin a sans doute déjà fait le tour du village. Trouver un endroit où dormir devient un sacré défi.
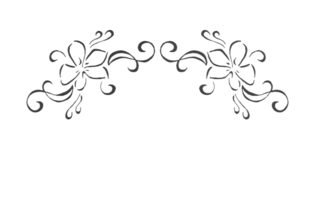
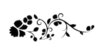


Commentaires